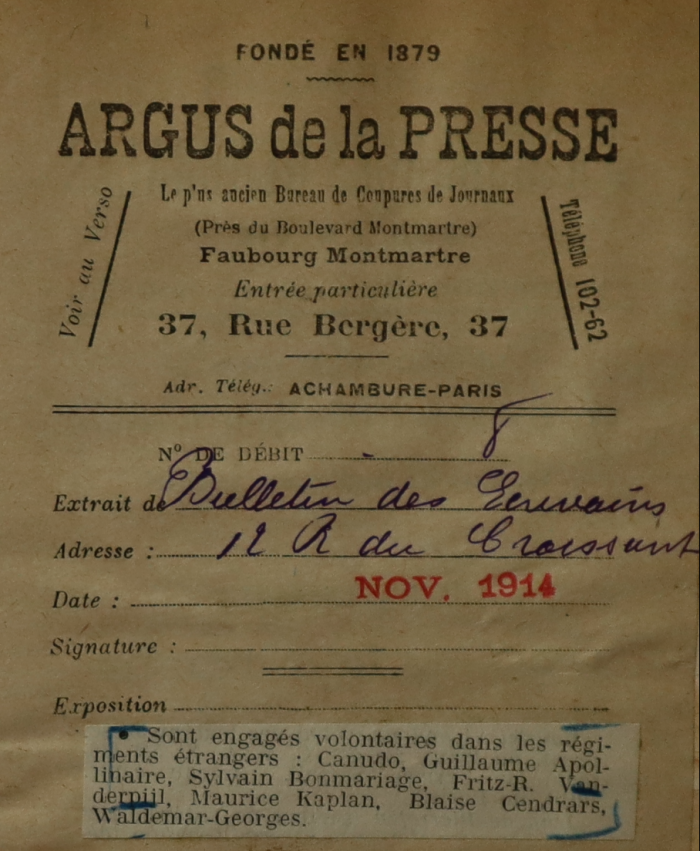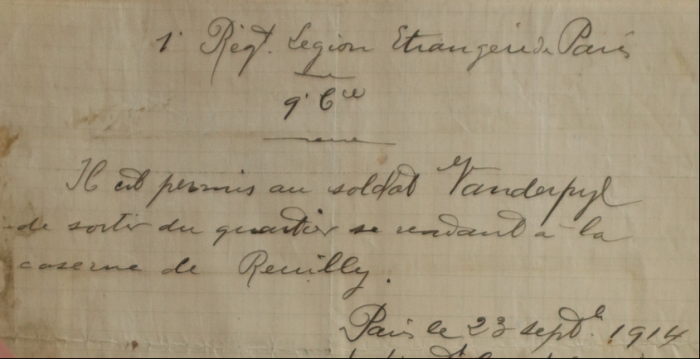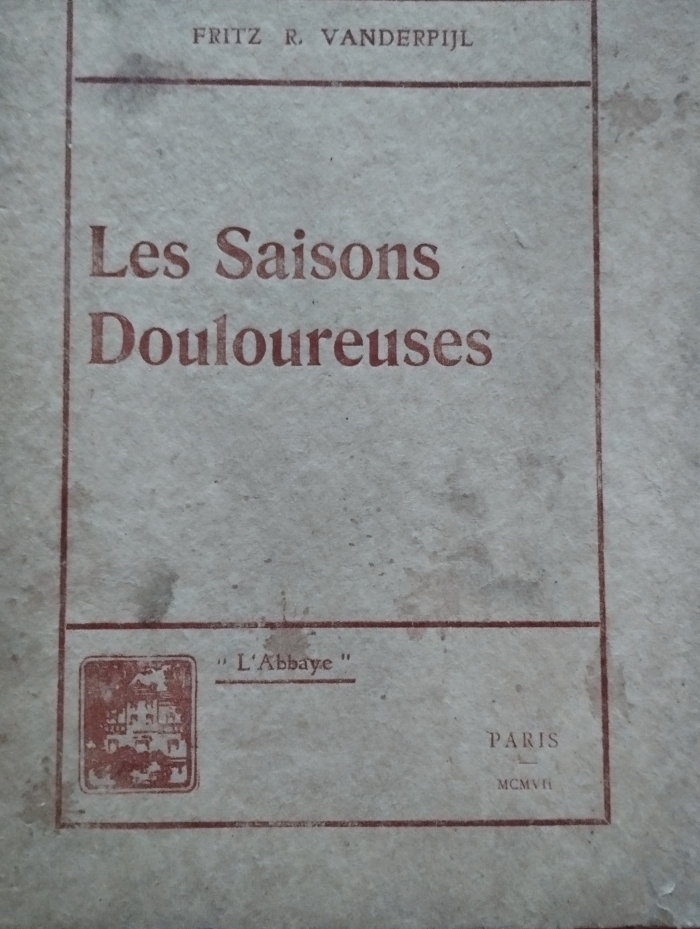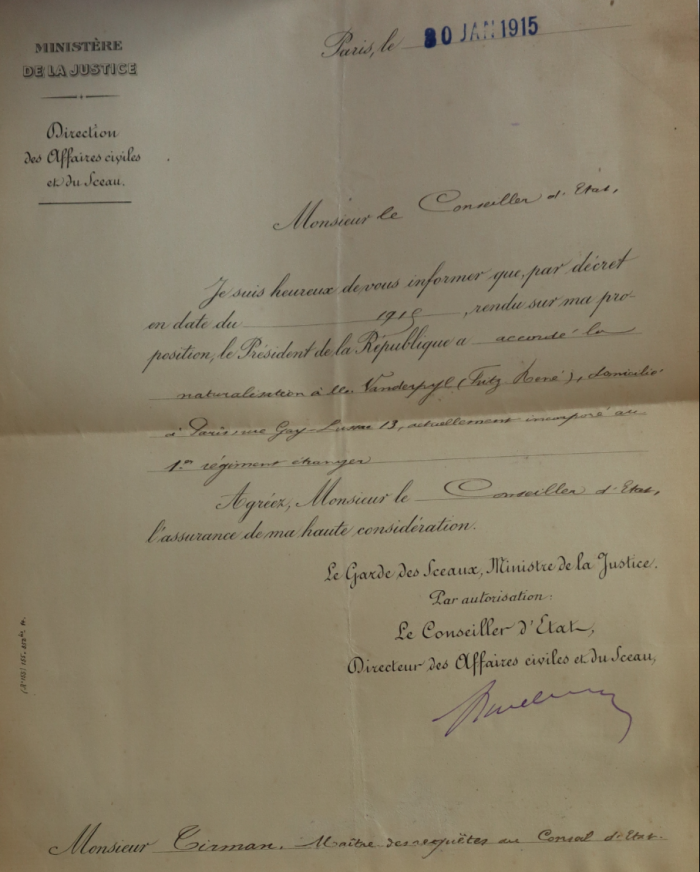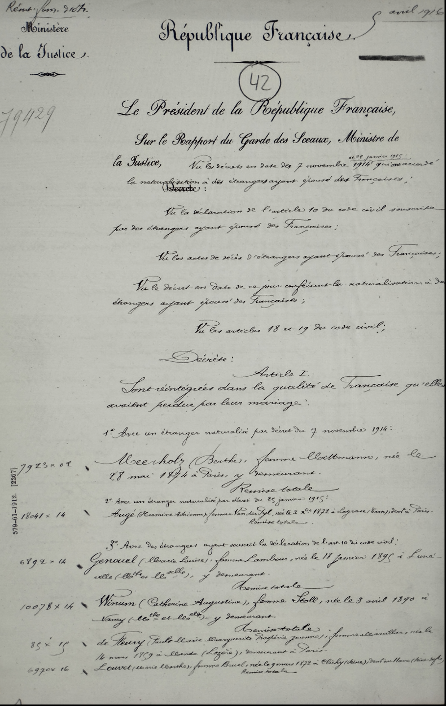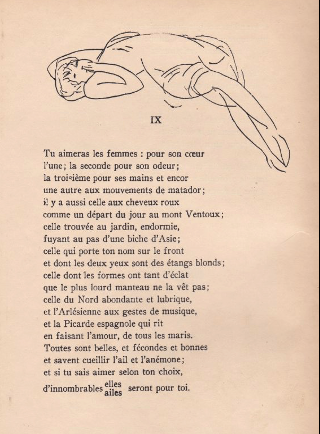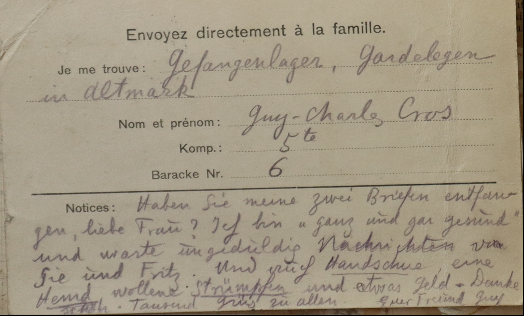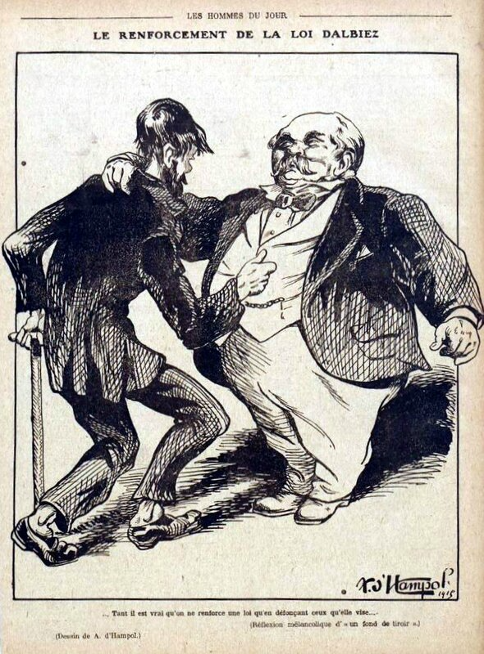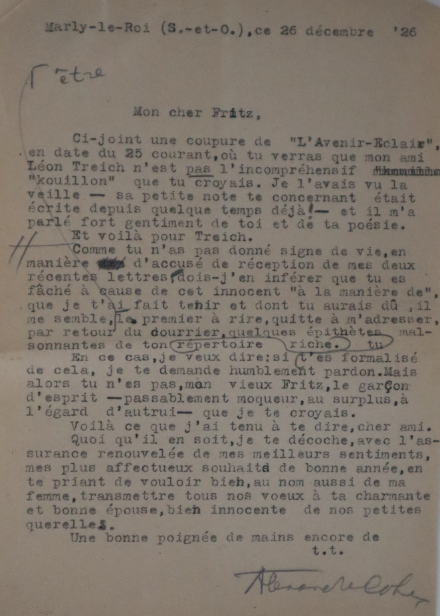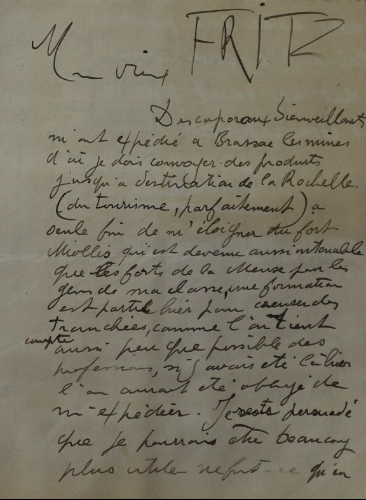UN POËTE HOLLANDAIS AU SERVICE DE LA FRANCE (23/01/2025)
PENDANT LA GRANDE GUERRE
Les paragraphes qui suivent proposent un éclairage sur les années de la guerre 1914-1918 vécues par l’écrivain franco-néerlandais Fritz-René Vanderpyl (La Haye, Hollande-Méridionale, 1876 – Lagnes, Vaucluse, 1965), en particulier sur les premiers six mois qui se sont révélés cruciaux pour lui. Son existence de soldat se marie non sans mal à celle de l’écrivain et à celle du « jeune » marié.
La plupart des citations sont empruntées aux cahiers 8 à 11 de son Journal inédit (les dates ne sont pas toujours mentionnées par l’auteur, aussi renvoyons-nous aux sources sans notes en bas de page). D’autres proviennent de son Mémorial sans dates, ses mémoires tapuscrits, pour une grande partie inédits eux aussi. Quelques coquilles, signes de ponctuation et erreurs flagrantes de français ont été corrigés dans les passages cités.
Sauf mention contraire, les documents reproduits proviennent des archives Vanderpyl. Je remercie les ayants droit de l’écrivain d’avoir mis à ma disposition les archives de leur grand-oncle par alliance. Malgré plusieurs tentatives de leur part d’obtenir le dossier de Vanderpyl auprès de la Légion étrangère, leur demande n’a pas été honorée.
Fritz R. Vanderpyl sous l’uniforme de la Légion, caserne de Reuilly, Paris, automne 1914
La déclaration de guerre
Quand la guerre éclate au milieu de l’été 1914, le poète Fritz Vanderpyl vit depuis une trentaine de mois – et son mariage avec l’Arlésienne Hermine Augé (1872-1966) – au deuxième étage du 13, rue Gay-Lussac, à une demi-encâblure du Jardin du Luxembourg. Sans être très spacieux, l’appartement parisien, que le couple occupera pendant plus d’un demi-siècle, leur permet de recevoir très souvent à leur table, ou à l’heure du thé, connaissances et amis français et étrangers, pour la plupart des poètes, des artistes, des journalistes, des politiciens, des médecins ainsi que des hommes et des femmes du monde, entre autres la baronne Frachon (1881-1983), modèle de Brancusi (1876-1957), et l’aviateur Marcel Brindejonc des Moulinais (1892-1916) qui devait périr en vol pendant le conflit. Le lundi soir, quand il le peut, Fritz tient d’ailleurs salon, une tradition qui remonte au moins à 1905 et qu’il maintiendra, bon an mal an, jusqu’au début des années soixante. Ce logement et leurs occupants ont laissé une trace dans les écrits d’auteurs renommés, en particulier ceux d’Ezra Pound (1885-1972) et de James Joyce (1882-1941), deux des personnalités anglo-saxonnes dont Vanderpyl a été proche. Quant à son camarade André Salmon (1881-1969), il a immortalisé le 43, rue des Écoles et le 12, rue Princesse où le Hollandais a vécu avant son mariage.
 Grâce à son épouse enseignante qui dispose d’un bas de laine, le Haguenois bourru et « vrombissant » jouit alors d’une certaine aisance alors que, depuis son arrivée à Paris, en septembre 1899, il avait surtout connu des années de vache maigre. Après avoir publié en juin 1913, dans sa deuxième langue, Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes – un volume sur l’art salué par Léo Larguier, auteur avec lequel il s’était lié –, il cherche à s’affirmer comme critique d’expression française ; aussi a-t-il lancé, au printemps 1914, chez l’éditeur-galeriste Léon Marseille, 16, rue de Seine, La Revue des Salons censée paraître quatre fois par an. Cependant, la guerre met rapidement fin à cette initiative. Un seul numéro de ce trimestriel consacré aux grandes expositions annuelles parisiennes voit en réalité le jour.
Grâce à son épouse enseignante qui dispose d’un bas de laine, le Haguenois bourru et « vrombissant » jouit alors d’une certaine aisance alors que, depuis son arrivée à Paris, en septembre 1899, il avait surtout connu des années de vache maigre. Après avoir publié en juin 1913, dans sa deuxième langue, Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes – un volume sur l’art salué par Léo Larguier, auteur avec lequel il s’était lié –, il cherche à s’affirmer comme critique d’expression française ; aussi a-t-il lancé, au printemps 1914, chez l’éditeur-galeriste Léon Marseille, 16, rue de Seine, La Revue des Salons censée paraître quatre fois par an. Cependant, la guerre met rapidement fin à cette initiative. Un seul numéro de ce trimestriel consacré aux grandes expositions annuelles parisiennes voit en réalité le jour.
Parallèlement à cette activité, Fritz continue de faire le cicérone polyglotte à Paris et dans différentes contrées européennes pour des clients étrangers fortunés. Il s’agit pour lui de mettre un peu de beurre dans les épinards et de ne pas laisser Hermine supporter seule les coûts du ménage. Pendant une bonne décennie, ce « métier » – dans lequel il s’est lancé en s’improvisant guide indépendant du Louvre et qui lui inspirera le roman Le Guide égaré (1939) – lui a permis de survivre et surtout de fréquenter des milieux huppés ainsi que des hôtels et des restaurants parmi les plus luxueux de la capitale et de diverses provinces dont la fascinante Touraine. Alors qu’il vient justement de sillonner cette région puis de traverser la France pour gagner la Suisse à bord d’une « brave Delaunay-Belleville (20 chevaux) » louée par des millionnaires de Chicago, il conseille à ces derniers de renoncer à leur projet : visiter l’Allemagne. En effet, la guerre menace. Fritz et le chauffeur français tiennent à faire demi-tour. Tous effectuent « en 24 heures le voyage de Zurich à Paris ». Assistant à la mobilisation helvétique, le poète a tenté de se rassurer quant à sa patrie de cœur : « La France est prête à tout ! Oui ! elle est prête, la bonne, la belle France, la France aimée… nom de Dieu, oui ! elle est prête et chacun est à son poste. »
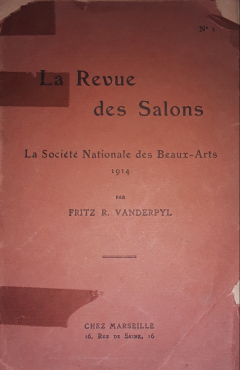 La déclaration de guerre renforce les sentiments antigermaniques du Hollandais en même temps qu’elle le bouleverse. À l’idée que le conflit était imminent, le sensible verlainien n’a-t-il pas pleuré dans sa chambre d’hôtel avant que la petite troupe ne quitte l’établissement zurichois à 4 h 45 du matin, justement le 3 août ? Tout juste rentré de Suisse, Fritz croise dans la rue son ami de longue date Georges Duhamel (1884-1966). L’écrivain-médecin lui demande son avis de « spectateur impartial » sur « la manière germaine ». Vanderpyl lui répond qu’il n’est « pas spectateur impartial », et qu’il croit que, « dans toute l’Histoire du monde soi-disant civilisé, on ne pourra pas lire une page plus désavantageuse pour aucune race que celle qui résumera la conduite de l’Allemagne envers l’Europe de 1904-1914 ». Le poète est d’autant plus désemparé que l’étranger qu’il demeure malgré lui en est réduit à l’inactivité : il déplore son « impuissance momentanée de faire quoi que ce soit pour la France, surtout contre l’Allemagne » et de devoir « supporter d’entendre dire du bien des traîtres italiens », lui qui compte pourtant bien des amis artistes et poètes toscans. Savoir que son compère le plus cher à cette époque, le poète et don Juan Guy-Charles Cros (1879-1956), a rejoint son unité dès les premiers jours du conflit, « sac au dos et pipe au bec », ne fait qu’accentuer sa tristesse.
La déclaration de guerre renforce les sentiments antigermaniques du Hollandais en même temps qu’elle le bouleverse. À l’idée que le conflit était imminent, le sensible verlainien n’a-t-il pas pleuré dans sa chambre d’hôtel avant que la petite troupe ne quitte l’établissement zurichois à 4 h 45 du matin, justement le 3 août ? Tout juste rentré de Suisse, Fritz croise dans la rue son ami de longue date Georges Duhamel (1884-1966). L’écrivain-médecin lui demande son avis de « spectateur impartial » sur « la manière germaine ». Vanderpyl lui répond qu’il n’est « pas spectateur impartial », et qu’il croit que, « dans toute l’Histoire du monde soi-disant civilisé, on ne pourra pas lire une page plus désavantageuse pour aucune race que celle qui résumera la conduite de l’Allemagne envers l’Europe de 1904-1914 ». Le poète est d’autant plus désemparé que l’étranger qu’il demeure malgré lui en est réduit à l’inactivité : il déplore son « impuissance momentanée de faire quoi que ce soit pour la France, surtout contre l’Allemagne » et de devoir « supporter d’entendre dire du bien des traîtres italiens », lui qui compte pourtant bien des amis artistes et poètes toscans. Savoir que son compère le plus cher à cette époque, le poète et don Juan Guy-Charles Cros (1879-1956), a rejoint son unité dès les premiers jours du conflit, « sac au dos et pipe au bec », ne fait qu’accentuer sa tristesse.
Vanderpyl portraituré par Jean Marchand (1915, coll. privée)
 Signe de la détresse qui habite le Batave : il ne se rase plus. « Je me fais arranger la barbe que j’ai laissée pousser depuis le 1er août », confie-t-il à son Journal le 4 septembre. Une barbe à laquelle il ne renoncera plus guère, ainsi qu’en témoignent bien des photos ultérieures et maints portraits de lui brossés par plusieurs dizaines d’artistes auxquels il a été liés : le futur légionnaire Moïse Kisling (1891-1953), Maurice de Vlaminck (1876-1958), l’Ukrainienne Sonia Lewitska (1880-1934), l’époux de cette dernière Jean H. Marchand (1882-1940), André Favory (1889-1937), Charles Blanc (1896-1966), les Provençaux Auguste Chabaud (1882-1955) et Jean-Marie Fage (1922-2024), le naïf Ferdinand Desnos (1901-1958), l’autodidacte Pierre Jouffroy (1912-2000)… Le poème « En posant… », que Fritz dédie à André Derain (1880-1954), évoque une séance dans l’atelier de ce dernier, lors d’un mois de mai encore pacifique, celui de 1914 : « le peintre a les yeux sur la toile : / je le vois mélanger du bleu et du blanc… / … me met-il de célestes voiles ? »
Signe de la détresse qui habite le Batave : il ne se rase plus. « Je me fais arranger la barbe que j’ai laissée pousser depuis le 1er août », confie-t-il à son Journal le 4 septembre. Une barbe à laquelle il ne renoncera plus guère, ainsi qu’en témoignent bien des photos ultérieures et maints portraits de lui brossés par plusieurs dizaines d’artistes auxquels il a été liés : le futur légionnaire Moïse Kisling (1891-1953), Maurice de Vlaminck (1876-1958), l’Ukrainienne Sonia Lewitska (1880-1934), l’époux de cette dernière Jean H. Marchand (1882-1940), André Favory (1889-1937), Charles Blanc (1896-1966), les Provençaux Auguste Chabaud (1882-1955) et Jean-Marie Fage (1922-2024), le naïf Ferdinand Desnos (1901-1958), l’autodidacte Pierre Jouffroy (1912-2000)… Le poème « En posant… », que Fritz dédie à André Derain (1880-1954), évoque une séance dans l’atelier de ce dernier, lors d’un mois de mai encore pacifique, celui de 1914 : « le peintre a les yeux sur la toile : / je le vois mélanger du bleu et du blanc… / … me met-il de célestes voiles ? »
La détresse du spectateur inutile
Hermine Augé-Vanderpyl, infirmière de la Croix-Rouge
 Ressortissant d’une nation neutre, Vanderpyl est autorisé à poursuivre son existence en France, mais ne peut obtenir le moindre emploi au service de sa patrie d’adoption. Vaine tentative le 7 août quand, avec le jeune poète Albert-Jean (1892-1975), il cherche à se faire inscrire comme garde civique, rue de la Poterie, aux Halles. Le même jour, sans plus de succès, il se rend « au 68, avenue de la République, chez un M. Ricardo qui invite les Hollandais à grouper leurs bonnes volontés en ce temps de miracles ». Échec également lorsqu’il va s’offrir « comme volontaire » auprès d’un autre comité néerlandais… Peu après, la Croix-Rouge – au sein de laquelle son épouse Hermine (photo ci-dessus) s’est portée volontaire pour soigner les blessés – refuse ses services, par le moyen d’un courrier du politicien Jules Auffray (1852-1916), alors que Fritz se proposait de faire office de brancardier-interprète. Sans que cela ne lui serve à quoi que ce soit, il suit « des leçons d’ambulancerie ». Malgré ces déceptions, l’idée de rentrer aux Pays-Bas ne lui paraît pas envisageable : « Retourner en Hollande serait abandonner ma femme et ma France. » Dans son impatience à se rendre utile, le Haguenois note le 8 août : « À partir du 21, on pourra se faire inscrire pour la Légion étrangère. » Une de ses connaissances, l’homme de lettres italien Ricciotto Canudo (1877-1923), fondateur de la gazette cérébrale et sensuelle Montjoie ! et promoteur de l’art cinématographique, avait lancé quelques semaines plus tôt, avec le Suisse Blaise Cendrars (1887-1961), un appel aux allochtones vivant en France afin que ceux-ci prennent les armes pour défendre le pays.
Ressortissant d’une nation neutre, Vanderpyl est autorisé à poursuivre son existence en France, mais ne peut obtenir le moindre emploi au service de sa patrie d’adoption. Vaine tentative le 7 août quand, avec le jeune poète Albert-Jean (1892-1975), il cherche à se faire inscrire comme garde civique, rue de la Poterie, aux Halles. Le même jour, sans plus de succès, il se rend « au 68, avenue de la République, chez un M. Ricardo qui invite les Hollandais à grouper leurs bonnes volontés en ce temps de miracles ». Échec également lorsqu’il va s’offrir « comme volontaire » auprès d’un autre comité néerlandais… Peu après, la Croix-Rouge – au sein de laquelle son épouse Hermine (photo ci-dessus) s’est portée volontaire pour soigner les blessés – refuse ses services, par le moyen d’un courrier du politicien Jules Auffray (1852-1916), alors que Fritz se proposait de faire office de brancardier-interprète. Sans que cela ne lui serve à quoi que ce soit, il suit « des leçons d’ambulancerie ». Malgré ces déceptions, l’idée de rentrer aux Pays-Bas ne lui paraît pas envisageable : « Retourner en Hollande serait abandonner ma femme et ma France. » Dans son impatience à se rendre utile, le Haguenois note le 8 août : « À partir du 21, on pourra se faire inscrire pour la Légion étrangère. » Une de ses connaissances, l’homme de lettres italien Ricciotto Canudo (1877-1923), fondateur de la gazette cérébrale et sensuelle Montjoie ! et promoteur de l’art cinématographique, avait lancé quelques semaines plus tôt, avec le Suisse Blaise Cendrars (1887-1961), un appel aux allochtones vivant en France afin que ceux-ci prennent les armes pour défendre le pays.
En attendant de réaliser ce souhait, Vanderpyl, dépité par la neutralité des Pays-Bas, position qu’il juge certains jours comme criminelle, rédige un article sur « Le silence de la Hollande », mais L’Écho de Paris et d’autres journaux (La Guerre sociale, L’Humanité…) ne sont pas disposés à le publier. Peu après, Le Temps en refusera un autre intitulé « Le cas de la Hollande et ce que l’on peut espérer d’elle ». Le plus souvent, cependant, l’inquiétude qui ronge le poète et prosateur l’empêche de coucher le moindre vers, la moindre ligne sur le papier, si ce n’est des considérations hâtives dans son Journal et dans sa correspondance. Déplorant le fait que des millions d’hommes s’affrontent « sans pitié, sans larmes, sans se rendre compte que le sort élémentaire de l’humanité blanche est en jeu », il redoute que, si « la fin des Huns » survenait, cela pourrait également signifier « la fin de la race franque, des races celtiques, gauloises, bataves et belges ». Cette défense de l’homme blanc – mais plus encore des particularismes régionaux –, peu exceptionnelle à l’époque, ne l’empêche pas d’avoir pour meilleur ami un homme à la peau foncée et de dénoncer la folie de sa patrie d’adoption : « Après avoir fracassé des millions de crânes nègres, le pays de la Paix, le pays de la plus haute culture, le pays dont les habitants tenaient plus que n’importe qui à leur vie et à leur bien-être, la France en un mot, se trouve obligée, pour garder son droit de rester française, à sacrifier les meilleurs de ses fils, l’essence de sa vitalité ; c’est à croire que nous ne vivons que pour tuer et être tués… »
 Le grand ami Guy-Charles Cros (archives Vanderpyl)
Le grand ami Guy-Charles Cros (archives Vanderpyl)
Ces angoisses d’Occidental quant au sort des diverses provinces européennes se doublent de craintes plus personnelles : « Quelquefois, la peur m’étreint. » Il se sent d’autant plus mal qu’il n’a d’autre choix que d’être un spectateur inutile et passif du quotidien et des changements en cours : « La rue sans tramway n’est pas bien différente de la rue en temps ordinaire. Beaucoup d’autos passent. Des jeunes gens vont au Luxembourg. Un phonographe joue un air patriotique. De loin, on entend le roulement des tramways pour ‘‘Montrouge’’ qui n’ont pas encore cessé de marcher. » Au proche Luxembourg, Fritz se rend lui aussi régulièrement : il s’y promène avec Prikken, le chien de sa femme, et s’attarde sur une chaise pour lire tantôt du Francis Carco (1886-1958), tantôt du Charles-Henri Hirsch (1870-1948), livres abandonnés par Guy-Charles Cros, lors de son départ au front, dans la chambre de bonne du sixième étage que les Vanderpyl avaient mise à sa disposition. Un jour, dans le célèbre jardin, le Hollandais aperçoit le poète d’origine hongroise Maurice Cremnitz (1875-1935) avec lequel il est en froid : « … nous faisons comme si nous ne nous voyions pas. Et j’aime mieux ça… Malgré la meilleure volonté du monde, je ne puis me confier à la clique Apollinaire-Salmon-Cremnitz, etc. » Heureusement, Fritz se rabibochera avec les auteurs en question : André Salmon redeviendra l’un de ses plus fidèles copains et il se rapprochera de l’auteur d’Alcools au cours des deux dernières années de la vie de ce dernier. Chaque jour ou presque, Marthe Roux (1890-1981), jeune femme justement éprise, plus ou moins à la même époque, de Guillaume Apollinaire (1880-1918), rend visite au Hollandais. Auprès de lui, elle s’épanche sur ses déboires amoureux. Malgré les quatorze ans qui les séparent, un indéfectible attachement les liera longtemps l’un à l’autre. L’aigreur que Fritz éprouve alors à l’égard de son compère en gastronomie Apollinaire provient sans aucun doute, pour une part, des manœuvres de séduction que celui-ci aurait déployées, sans beaucoup de scrupules, vis-à-vis de Marthe.
Exemplaire de Vanderpyl du Chass’bi de Salmon
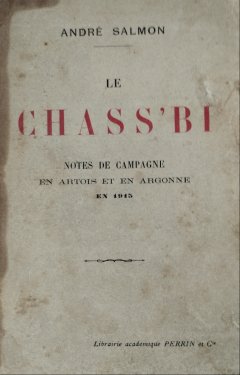 Une semaine après l’entrée en guerre de la France, Vanderpyl reçoit la visite de la police : une lettre anonyme l’a dénoncé comme espion. Il soupçonne des commères du quartier de l’avoir fait passer, en raison de ses origines septentrionales et de son irréfutable sale caractère, pour un étranger au service de la Prusse. « On sait, consigne-t-il non sans humour dans son Journal, que je fais des randonnées en auto, que je vais souvent en Allemagne (?)… j’y ai été une fois en 1910 et avec ma femme dans les Vosges en 1912. L’agent me demande si j’ai des ennemis. Je lui dis : par dizaines. » Fritz était connu pour maudire la terre entière et se fâcher avec tout le monde, y compris avec ses meilleurs amis. Malgré tout, beaucoup se réconciliaient avec lui. Par bonheur, la police le laissera tranquille. Au cours des mois en question, on a assisté dans la capitale, et sans doute ailleurs, à une espionite aiguë, laquelle a incité un certain nombre d’étrangers à s’enrôler dans les troupes françaises, histoire de n’être plus tenus en suspicion.
Une semaine après l’entrée en guerre de la France, Vanderpyl reçoit la visite de la police : une lettre anonyme l’a dénoncé comme espion. Il soupçonne des commères du quartier de l’avoir fait passer, en raison de ses origines septentrionales et de son irréfutable sale caractère, pour un étranger au service de la Prusse. « On sait, consigne-t-il non sans humour dans son Journal, que je fais des randonnées en auto, que je vais souvent en Allemagne (?)… j’y ai été une fois en 1910 et avec ma femme dans les Vosges en 1912. L’agent me demande si j’ai des ennemis. Je lui dis : par dizaines. » Fritz était connu pour maudire la terre entière et se fâcher avec tout le monde, y compris avec ses meilleurs amis. Malgré tout, beaucoup se réconciliaient avec lui. Par bonheur, la police le laissera tranquille. Au cours des mois en question, on a assisté dans la capitale, et sans doute ailleurs, à une espionite aiguë, laquelle a incité un certain nombre d’étrangers à s’enrôler dans les troupes françaises, histoire de n’être plus tenus en suspicion.
En cette période où le Taube – avion monoplan biplace germanique – survole Paris en larguant quelques bombes peu redoutables, où l’on commence à craindre un siège de la capitale, où le gouvernement interdit la vente de l’absinthe tout en se repliant à Bordeaux, où l’opinion publique est agitée par les scandales Mesureur et Gervais, où Louvain brûle, où Rome attend son nouveau pape, où Londres « boycotte la musique wagnérienne » – « C’est dommage, précise le mélomane Vanderpyl, qu’on préfère Saint-Saëns à Franck, Chopin, Berlioz, Debussy & Vincent d’Indy pour remplacer Wagner » –, le poète tue le temps en lisant nombre d’ouvrages de Balzac et de Stendhal, en faisant, sans guère d’entrain, des réussites Marie-Antoinette ou, le soir venu, des parties de bésigue ou de bridge avec sa femme et quelques amis. Habitué à dresser, dans ses heures perdues, des listes de gens, de choses et d’objets qui lui tiennent à cœur – inventaire des artistes, écrivains et personnalités qu’il a rencontrés depuis son arrivée à Paris ; des grands peintres du passé ; des œuvres d’art qu’il possède ; des vêtements et attributs que tout homme du monde se doit d’avoir dans sa garde-robe… –, le bec-fin qu’il est depuis toujours établit cette fois un catalogue impressionnant des brasseries et restaurants parisiens où, malgré les difficultés d’approvisionnement, il est encore possible de faire un dîner correct. Chaque soir, avant de se coucher, il prend quelques minutes pour indiquer sur une carte du Nord-Est du pays la position des armées belligérantes. Un jour, dans son ire anti-teutonne, il déchire, avec l’aide de son épouse, les photos qu’il possède de ses anciens amis allemands, la plupart évoluant dans la sphère artistico-littéraire : les peintres Richard Bloos (1878-1957) et Rudolf Neugebauer (1892-1961), le critique et marchand d’art Wilhelm Uhde (1874-1947), l’historien d’art Otto Grautoff (1876-1937)… : « Je ne pourrai plus, Hermine non plus, s’emporte-t-il, serrer la main à un de ces êtres qui s’avilit à être massacré ou à massacrer pour le bénéfice hypothétique (ô ! combien) de quelques milliers d’officiers. »
carte postale avec dessin de Bloos (signée également par P. Morisse), conservée par les Vanderpyl
La haine de l’impulsif Haguenois ne connaît guère de limites. Sur le papier, n’assiste-t-on pas pour ainsi dire à un appel au pogrom ? « Vidons leurs ateliers et intérieurs, vendons leurs petites ou grandes collections, leurs meubles et brûlons ce qui est invendables. Ils prêchent eux-mêmes l’exemple. Il y a deux établissements entre les boulevards Raspail et de Montparnasse où l’on pourra donner à qui de droit les adresses nécessaires, deux cafés dont l’un a même laissé son nom à une école de peinture munichoise. Il serait bon en même temps de contrôler si, sous la douce étiquette d’artiste, il ne reste pas quelques Boches cachés derrière des chevalets ou des paquets de terre glaise. » Six ans plus tard, un des hommes peut-être visés par ces lignes, Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979), publiera Voyages – premier livre lancé par la nouvelle galerie de ce marchand d’art après un long exil en Suisse où il s’était réfugié pour ne pas avoir à combattre la France sous l’uniforme teuton. Voyages réunit des poèmes français de Vanderpyl ; tirée à 107 exemplaires, cette édition de luxe est rehaussée de 25 gravures sur bois de Maurice de Vlaminck. « C’est Vlaminck qui présente Vanderpyl à Kahnweiler, lit-on dans la plaquette Daniel-Henry Kahnweiler éditeur. 1909-1939. En effet, depuis Berne, ce dernier prépare son retour à Paris et il sollicite tous ‘‘ses’’ peintres pour les futures éditions. Vlaminck sera le premier à renouer commercialement avec Kahnweiler. Pour le peintre, c’est le premier livre qu’il illustre. […] C’est le premier livre à l’adresse de la Galerie Simon, d’un grand format, et pour la première fois l’éditeur choisit de faire illustrer la couverture d’une gravure. D’aucuns prétendent que Kahnweiler aurait stratégiquement édité ce livre, collaboration de deux anciens combattants, pour répondre au nationalisme ambiant, alors qu’il préparait sa rentrée à Paris et multipliait ses interventions pour faire lever les séquestres sur son stock. » Vingt-quatre ans plus tard, les cartes, on va le voir, seront rebattues, pas vraiment en faveur des deux anciens combattants…
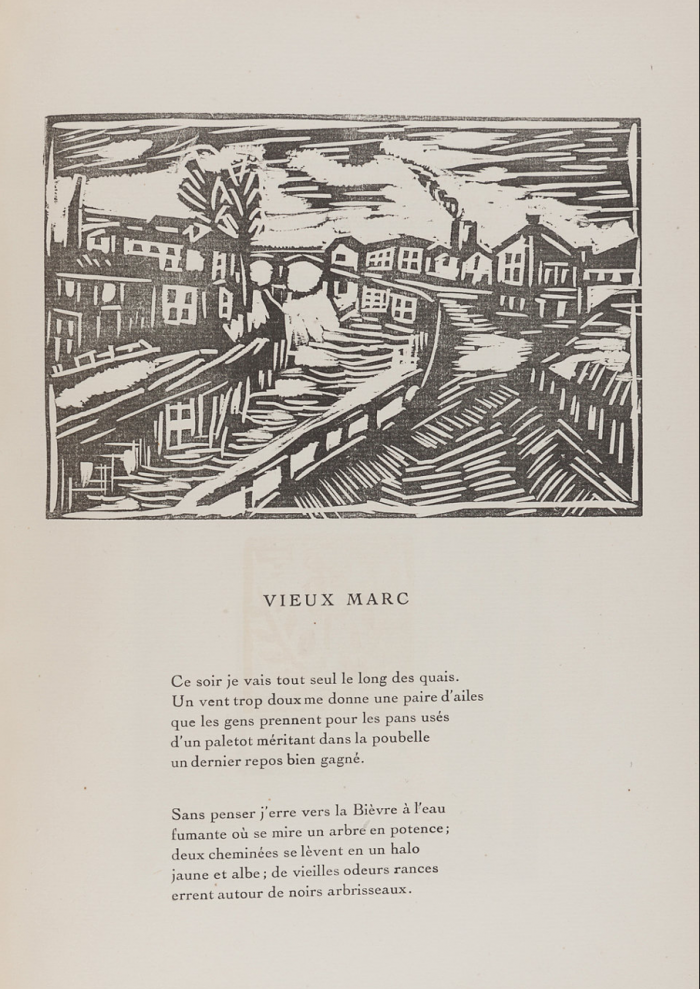 Une page du recueil Voyages illustré par Vlaminck (1920)
Une page du recueil Voyages illustré par Vlaminck (1920)
L’ajournement et le spectre du divorce
Le 18 août, Vanderpyl revient sur la possibilité de s’enrôler au service de la France : « Dans trois jours, je saurai si, oui ou non, la République française me prendra comme fantassin ou autre métier guerrier. Ce qui me paraît bizarre, c’est que le fait d’un engagement ne vous fiche pas français directement et immédiatement. Il paraît qu’il faut quand même demander sa naturalisation ? » En fait d’engagement, c’est une désillusion qui l’attend : « Suis allé ce matin aux Invalides et j’ai été ajourné ! […] Ce matin, à poil devant ces majors, j’ai pleuré (3 larmes vite réprimées) d’être refusé. Mais nom de Dieu ! qu’ils le sachent : un Hollandais ne s’enfuit pas… ne s’est jamais enfui. Merde ! […] Je veux défendre mon foyer, ma femme, la patrie que j’ai faite mienne par mon art incontestable. » Un bout de papier collé dans le Journal porte les mentions suivantes, certainement griffonnées par l’un des esculapes militaires : 1 m 65 et 86 kg (ailleurs, on trouve la mention : 1 m 64, ce qui nous fait, en cumulant puis divisant les deux : 1 m 64,5 – soit… la taille du Soldat inconnu). Le poète a eu beau mentir sur son âge : trente-six ans au lieu de trente-huit, il a manifestement été recalé en raison de son joli embonpoint. Un de ses amis, l’écrivain-voyageur britannique Jan Gordon (1882-1944), ne le surnomme-t-il pas à l’époque « Ratapouf » : Ratapouf, globular, somewhat like a Billiken… Il arrive à Ezra Pound de commencer les lettres qu’il lui adresse par « Cher Ami ventru ». Et la plupart des commentateurs ne peuvent évoquer sa personnalité sans souligner son tour de taille.
Paul Aeschimann, par Alizé
 Deux hommes de lettres dont Fritz est alors assez proche, les Suisses Fernand Roches (1882-19??) – directeur de la revue L’Art décoratif qui lui écrivait encore le 17 juillet 1914 pour lui demander un article sur le peintre Georges Michel (1763-1843) –, et Paul Aeschimann (1886-1952), sont réformés eux aussi, le dernier en raison de sa mauvaise vue. Avec celui-ci, Vanderpyl rédige d’ailleurs une lettre bientôt envoyée à L’Homme libre, le journal de Georges Clémenceau (1841-1929), organe qui ne prend pas même la peine d’en accuser réception : « Monsieur, Nous revenons des Invalides. On nous a ajournés. Cent, deux cents sont partis tête basse. Les médecins-majors faisant leur devoir écartent sans pitié les trop vieux, les myopes, les anémiques, etc. Nous nous inclinons. Pourtant, tous ces renvoyés ont plus que jamais le désir de servir la France. N’ont-ils pas droit à la préférence, lorsqu’un jour, on aura besoin d’hommes dans les services auxiliaires quels qu’ils soient ? »
Deux hommes de lettres dont Fritz est alors assez proche, les Suisses Fernand Roches (1882-19??) – directeur de la revue L’Art décoratif qui lui écrivait encore le 17 juillet 1914 pour lui demander un article sur le peintre Georges Michel (1763-1843) –, et Paul Aeschimann (1886-1952), sont réformés eux aussi, le dernier en raison de sa mauvaise vue. Avec celui-ci, Vanderpyl rédige d’ailleurs une lettre bientôt envoyée à L’Homme libre, le journal de Georges Clémenceau (1841-1929), organe qui ne prend pas même la peine d’en accuser réception : « Monsieur, Nous revenons des Invalides. On nous a ajournés. Cent, deux cents sont partis tête basse. Les médecins-majors faisant leur devoir écartent sans pitié les trop vieux, les myopes, les anémiques, etc. Nous nous inclinons. Pourtant, tous ces renvoyés ont plus que jamais le désir de servir la France. N’ont-ils pas droit à la préférence, lorsqu’un jour, on aura besoin d’hommes dans les services auxiliaires quels qu’ils soient ? »
Ajourné, Fritz se fait traiter d’étranger « qui ferait mieux de rentrer dans son pays » par la concierge de son immeuble, 13, rue Gay-Lussac, ainsi que par la mère et le gamin de la pipelette. Au désespoir, il plante le drapeau tricolore sur son balcon qui donne sur le Luxembourg et supplie Dieu de sauver la France. Lui qui aspire tant à servir ces couleurs ne peut tolérer ceux qui, parmi ses connaissances et amis, essayent d’échapper à tout enrôlement. Sans distinction d’âge ni de nationalité, il énumère, parmi d’autres, en les condamnant, Robert Delaunay (1885-1941), parti en Espagne, l’Américain Samuel Halpert (1884-1930) et Karl Edvard Diriks (1855-1930), le Norvégien auquel il a pourtant dédié le poème « Banlieue parisienne » de son recueil Les Saisons d’un poète (1911) ; à ces peintres viennent s’ajouter les auteurs Charles Morice (1860-1919), Charles Régismanset (1873-1945), Albert-Jean et Vincent Muselli (1879-1956) ; mais aussi l’éditeur Georges Crès (1875-1935) ou encore André Rouveyre (1879-1962) et Louis Dumur (1863-1933), collaborateurs des éditions du Mercure de France… Plus loin, le diariste nuance tout de même un peu son attaque : « il ne faut pas juger sans savoir ». En ce qui concerne Delaunay, il ne semble guère s’être trompé puisque ce dernier, déserteur privilégié, a fini, en faisant jouer des appuis, par échapper à tout enrôlement et donc à la boucherie.
Autoportrait de Samuel Halpert
 Au cours de ces journées, Vanderpyl croise Vincent Muselli et Albert-Jean qui, « réformés par protection font les beaux sur le boulevard, l’un tout seul, l’autre avec son chiennet jaune et sa p’tite maîtresse. Leur poësie est de même farine ». Par la parole et par la plume, Fritz ne manquera pas non plus de reprocher ce qu’il considère comme de la couardise à maints plasticiens dont il a été très proche avant le conflit mondial, en particulier Pablo Picasso (1881-1973), lui aussi dédicataire d’un poème des Saisons d’un poète, et Van Dongen (1877-1968). Ainsi, le 5 octobre 1914 rapporte-t-il ce bref échange qui vient de se dérouler dans la rue alors que lui-même porte enfin l’uniforme :
Au cours de ces journées, Vanderpyl croise Vincent Muselli et Albert-Jean qui, « réformés par protection font les beaux sur le boulevard, l’un tout seul, l’autre avec son chiennet jaune et sa p’tite maîtresse. Leur poësie est de même farine ». Par la parole et par la plume, Fritz ne manquera pas non plus de reprocher ce qu’il considère comme de la couardise à maints plasticiens dont il a été très proche avant le conflit mondial, en particulier Pablo Picasso (1881-1973), lui aussi dédicataire d’un poème des Saisons d’un poète, et Van Dongen (1877-1968). Ainsi, le 5 octobre 1914 rapporte-t-il ce bref échange qui vient de se dérouler dans la rue alors que lui-même porte enfin l’uniforme :
J’ai rencontré le peintre d’obscénités Van Dongen… il donnait le bras à un modèle très maquillé. Il avait l’air de se ficher, le pauvre garçon, de moi.
– Tu ne te fais pas soldat ?
– Pour quoi faire ? me demande-t-il.
– Pour se battre, pour se rendre utile, pour ne pas rester chez soi où l’on ne peut rien produire, tout de même…
– Je n’ai jamais autant travaillé…
Je m’éloigne vivement de peur de le gifler… ça ne lui portera pas bonheur, allez.
Que le lecteur se rassure : il existe de belles photos des deux Hollandais de naissance partageant plus de quarante ans plus tard un bon repas à l’occasion d’une exposition parisienne de Kees (ci-dessous) et une autre les montrant côte à côte, en 1962, dans l’atelier du peintre devant son célèbre portrait de Brigitte Bardot. Quant à Muselli et Albert-Jean, ils n’auront pu parader bien longtemps dans le Quartier Latin : avant même la mi-septembre, « on rappelle enfin des réformés des dernières années : Albert-Jean, Delaunay, Muselli, Robaglia and so on and so on ».
Kees van Dongen et Fritz Vanderpyl, 23 septembre 1956 (photo : Euro Civis)
En certaines occasions, alors que Vanderpyl est lui-même toujours ajourné, les militaires qui apparaissent près du Luxembourg ne font qu’accentuer un peu plus son désarroi : « Un bataillon de fantassins passe sur le boulevard Saint-Michel ; leurs fusils sont fleuris, leurs couleurs flottent comme mon drapeau sur le balcon du coin, ils chantent la Marseillaise. Ils passent… Je reste… » D’autres jours, cela lui redonne un peu le moral. Ainsi, un soir, lui et Hermine descendent dans la rue pour voir jusqu’à minuit « défiler 4 régiments entiers de zouaves… et des tirailleurs sénégalais, des turcos, puis de l’artillerie coloniale, allant de Montrouge vers le Nord… […] On donne des cigares, des cigarettes aux Noirs… puis très fatigués quelques-uns au repos pendant 5 minutes demandent à boire. On leur offre de la bière, du vin… La plupart préfèrent l’eau. Ma femme et moi, avec l’aide du bistrot qui est entre la gare de Sceaux et la rue Royer-Collard, versons du vin avec de l’eau. ‘‘Merci cousine, merci ma belle… Tu auras la tête à Guillaume…’’ Ils embrassent les jolies filles qui leur portent des raisins, des fleurs, un biscuit. C’est surtout les chefs Marocains sur leurs mulets, les Tunisiens qui ont de spirituels petits chevaux blancs, qui sont magnifiques d’ardeur et de pittoresque. Des ânes d’Afrique portent les mitrailleuses. Les officiers sont salués frénétiquement. Les Sénégalais crient : ‘‘Il y a bon… moi bouffé allemand…’’ Et pendant 4 heures le long du boulevard Saint-Michel sous l’œil blanc de la lampe du refuge en face de la rue Gay-Lussac, défilent ces troupes criantes, chantant […] aux petits drapeaux jaunes, rouges, verts venant de Sceaux, d’Antony […], ces troupes qui sont venues avec chevaux, armes et bagages des pays de l’autre côté de la Méditerranée ».
Même s’il conserve par moments un brin d’humour ou de dérision : « Le 5 o’clock-Taube n’est pas passé cet après-midi : il est vrai qu’il y avait des gendarmes-aviateurs français dans le ciel », le poète broie du noir. Le refus qu’il a essuyé le mine jusqu’à la moelle : « Mais (et j’ai honte à le reconnaître), ce que je suis las ! Ma graisse, ma pensée, ma vie-même, me gênent. Être mort, sous la chaux enterré, sur un champ de bataille, me paraît un sort enviable. » Ou encore : « Et personne ne perd courage excepté moi qui aimerait être mort pour ne pas voir la destruction de Paris, la mère du monde moderne, pour ne pas voir, ne fût-ce qu’un jour, l’abaissement de la Gaule. […] Mouillet Roux, oiseau de malheur, mari d’une Boche, vient me dire que si Paris était détruit, Berlin le serait aussi. Comme si l’un compensait l’autre !!! »
Exemplaire de Vanderpyl du Sang des autres de René Arcos
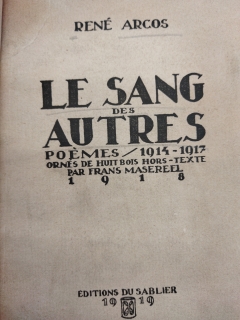 Durant les dix premiers jours de septembre 1914, Vanderpyl est au fond du trou. Hermine ne supporte plus le pessimisme de son mari. Ne tolère plus non plus qu’il critique les Méridionaux, lesquels, selon lui, par leur manière d’être et leur esprit, desservent la patrie quand ils ne sont pas « une peste pour la France ». Or, Hermine a des origines dans le Sud-Ouest (Tarn), à quoi s’ajoute le fait qu’une bonne partie de sa famille est établie à Arles et dans le Vaucluse ! Comme d’autres, elle en arrive à considérer Fritz, sous son propre toit, comme un paria. « Depuis le commencement de la guerre, je suis traité en étranger chez moi. Édouard Salafa vient me dire chez moi : les Hollandais se sont conduits comme des félons. Je lui demande ce qu’il pense des Méridionaux. Alors Hermine m’injurie… C’est presque une bataille… […] j’aime la France à en crever ! […] Je suis Français pour toujours quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense ». Il se dit prêt à donner sa peau pour sa patrie d’adoption si les privilégiés, « les bourgeois et leurs fils, du gouvernement et des ministères, donnent aussi la leur ! » À la décharge d’Hermine, il convient de dire qu’elle a été déstabilisée par le fait qu’il lui a fallu, en tant qu’épouse d’un allochtone, se faire inscrire dès le début des hostilités comme étrangère à la mairie du XIIIe arrondissement – celle où elle et lui se sont mariés en janvier 1912. Les tensions dans le couple sont telles que la quadragénaire annonce qu’elle entend divorcer. Les scènes de ménage se succèdent. Madame a qualifié Monsieur de « souteneur (ou à peu près) devant témoins (entre autres son cousin Édouard), m’a dit devant les mêmes que tout ce qui est à nous est à elle, que je n’ai rien à foutre en France… Cela a été trop dur et je l’ai bousculée, puis elle m’a mis ses griffes dans les joues. Et dire qu’on prétend que c’est moi le fou ! Je lui dis de coucher seule et je m’en vais depuis hier manger dehors ». Par moments, leurs voisins ont dû se boucher les oreilles, d’autant plus que le Haguenois avait, selon le poète René Arcos (1881-1959), camarade de l’époque de l’impécuniosité, une « voix aiguë » de « la portée d’un lebel ».
Durant les dix premiers jours de septembre 1914, Vanderpyl est au fond du trou. Hermine ne supporte plus le pessimisme de son mari. Ne tolère plus non plus qu’il critique les Méridionaux, lesquels, selon lui, par leur manière d’être et leur esprit, desservent la patrie quand ils ne sont pas « une peste pour la France ». Or, Hermine a des origines dans le Sud-Ouest (Tarn), à quoi s’ajoute le fait qu’une bonne partie de sa famille est établie à Arles et dans le Vaucluse ! Comme d’autres, elle en arrive à considérer Fritz, sous son propre toit, comme un paria. « Depuis le commencement de la guerre, je suis traité en étranger chez moi. Édouard Salafa vient me dire chez moi : les Hollandais se sont conduits comme des félons. Je lui demande ce qu’il pense des Méridionaux. Alors Hermine m’injurie… C’est presque une bataille… […] j’aime la France à en crever ! […] Je suis Français pour toujours quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense ». Il se dit prêt à donner sa peau pour sa patrie d’adoption si les privilégiés, « les bourgeois et leurs fils, du gouvernement et des ministères, donnent aussi la leur ! » À la décharge d’Hermine, il convient de dire qu’elle a été déstabilisée par le fait qu’il lui a fallu, en tant qu’épouse d’un allochtone, se faire inscrire dès le début des hostilités comme étrangère à la mairie du XIIIe arrondissement – celle où elle et lui se sont mariés en janvier 1912. Les tensions dans le couple sont telles que la quadragénaire annonce qu’elle entend divorcer. Les scènes de ménage se succèdent. Madame a qualifié Monsieur de « souteneur (ou à peu près) devant témoins (entre autres son cousin Édouard), m’a dit devant les mêmes que tout ce qui est à nous est à elle, que je n’ai rien à foutre en France… Cela a été trop dur et je l’ai bousculée, puis elle m’a mis ses griffes dans les joues. Et dire qu’on prétend que c’est moi le fou ! Je lui dis de coucher seule et je m’en vais depuis hier manger dehors ». Par moments, leurs voisins ont dû se boucher les oreilles, d’autant plus que le Haguenois avait, selon le poète René Arcos (1881-1959), camarade de l’époque de l’impécuniosité, une « voix aiguë » de « la portée d’un lebel ».
Hermine Augé-Vanderpyl, par Jean H. Marchand (1915, coll. Camau)
 Sous l’esthète et l’érudit Vanderpyl, presque toujours tiré à quatre épingles, se tapit un homme enclin à la colère ; pour un rien, il s’emporte verbalement et se montre même à l’occasion violent. Ce qu’il avoue d’ailleurs sans détour dans son Journal – que ses visiteurs ont tout loisir de feuilleter à leur gré ! –, par exemple lorsqu’il a levé la main ou le poing, avant son mariage, sur ses concubines ou encore quand il a cassé une carafe sur la tête de son ami Guy-Charles Cros. On se souvient aussi que son impétuosité a pu faire les choux gras des journalistes, en particulier en janvier 1913, à l’occasion d’un banquet littéraire. Ce qu’il reconnaît dans Mémorial sans dates, ses mémoires en grande partie inédits : « Mes accès de violence d’il y a un quart de siècle, ou plus, éclataient presqu’invariablement à table, comme à ce déjeuner Verlaine où je jetai à la tête d’un orateur mon verre de médiocre bourgogne. L’inoffensif amateur de littérature qui avait pris la parole, emporté par son éloquence, déclara au beau milieu de son discours (c’était un des frères Natanson qui fondèrent la Revue blanche) que nous appartenions tous à la même race. Il parlait de la race humaine et je l’aurais ainsi entendu si, depuis mon entrée dans la salle du banquet, je n’avais été agacé – l’absinthe aidant – par la vue de tout ce beau monde venu pour fêter cet homme si doué et si faible, faible jusques aux extrêmes conséquences de son état d’être d’exception, que fut l’auteur de Sagesse… Et qui, sans doute, s’il avait pu quitter pour quelques instants son éternité de poète, aurait ri ou proféré des injures de voir célébrer, par cette tranquille bourgeoisie lettrée, son génie d’ange tendre et maudit. J’ai appris trop tard ‘‘qu’on n’assiste pas à de pareilles réjouissances’’ ; on ne sait pas tout à 35 ans. » Pour éviter de porter son agressivité sur ses proches, il arrive même à Vanderpyl de se frapper la tête contre les murs quand il ne se matraque pas le crâne à coups de barre de fer ! Cet homme jovial, généreux, cultivé qui a impressionné bien des gens par sa faconde, qui a séduit bien des femmes par son exceptionnelle érudition et ses bons mots d’esprit, se transforme trop souvent en Hyde. Un Hyde qui a une ahurissante faculté de se fâcher avec tout le monde et une faculté tout aussi déconcertante de se raccommoder avec les victimes de ses invectives et de ses méchancetés. Dans son Journal comme dans la vie courante, il raille et insulte pour ainsi dire tous les habitants de la planète. Pourtant, certaines de ses qualités expliquent que bien des gens lui ont tout de même gardé leur estime.
Sous l’esthète et l’érudit Vanderpyl, presque toujours tiré à quatre épingles, se tapit un homme enclin à la colère ; pour un rien, il s’emporte verbalement et se montre même à l’occasion violent. Ce qu’il avoue d’ailleurs sans détour dans son Journal – que ses visiteurs ont tout loisir de feuilleter à leur gré ! –, par exemple lorsqu’il a levé la main ou le poing, avant son mariage, sur ses concubines ou encore quand il a cassé une carafe sur la tête de son ami Guy-Charles Cros. On se souvient aussi que son impétuosité a pu faire les choux gras des journalistes, en particulier en janvier 1913, à l’occasion d’un banquet littéraire. Ce qu’il reconnaît dans Mémorial sans dates, ses mémoires en grande partie inédits : « Mes accès de violence d’il y a un quart de siècle, ou plus, éclataient presqu’invariablement à table, comme à ce déjeuner Verlaine où je jetai à la tête d’un orateur mon verre de médiocre bourgogne. L’inoffensif amateur de littérature qui avait pris la parole, emporté par son éloquence, déclara au beau milieu de son discours (c’était un des frères Natanson qui fondèrent la Revue blanche) que nous appartenions tous à la même race. Il parlait de la race humaine et je l’aurais ainsi entendu si, depuis mon entrée dans la salle du banquet, je n’avais été agacé – l’absinthe aidant – par la vue de tout ce beau monde venu pour fêter cet homme si doué et si faible, faible jusques aux extrêmes conséquences de son état d’être d’exception, que fut l’auteur de Sagesse… Et qui, sans doute, s’il avait pu quitter pour quelques instants son éternité de poète, aurait ri ou proféré des injures de voir célébrer, par cette tranquille bourgeoisie lettrée, son génie d’ange tendre et maudit. J’ai appris trop tard ‘‘qu’on n’assiste pas à de pareilles réjouissances’’ ; on ne sait pas tout à 35 ans. » Pour éviter de porter son agressivité sur ses proches, il arrive même à Vanderpyl de se frapper la tête contre les murs quand il ne se matraque pas le crâne à coups de barre de fer ! Cet homme jovial, généreux, cultivé qui a impressionné bien des gens par sa faconde, qui a séduit bien des femmes par son exceptionnelle érudition et ses bons mots d’esprit, se transforme trop souvent en Hyde. Un Hyde qui a une ahurissante faculté de se fâcher avec tout le monde et une faculté tout aussi déconcertante de se raccommoder avec les victimes de ses invectives et de ses méchancetés. Dans son Journal comme dans la vie courante, il raille et insulte pour ainsi dire tous les habitants de la planète. Pourtant, certaines de ses qualités expliquent que bien des gens lui ont tout de même gardé leur estime.
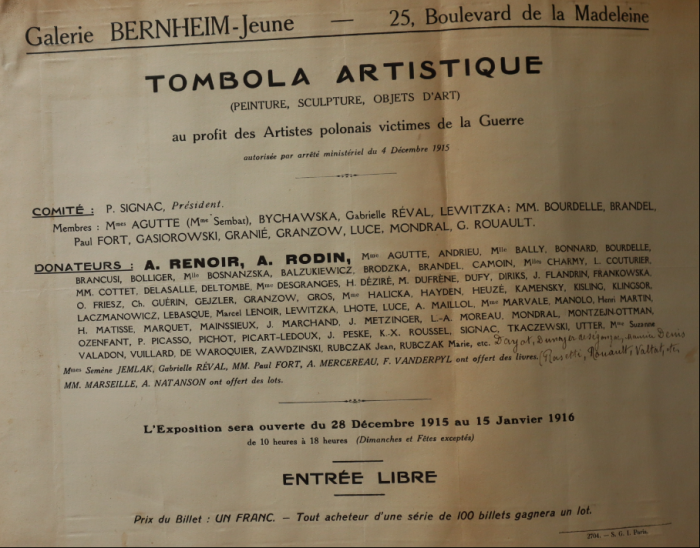 Vanderpyl et Alexandre Natanson bien surpris de se retrouver ensemble (fin 1915)
Vanderpyl et Alexandre Natanson bien surpris de se retrouver ensemble (fin 1915)
En ce début de septembre 1914, l’auteur ne voit plus d’issue. En dernier recours, il tente de se justifier : « Hermine vit une vie totalement séparée de la mienne et je me prépare à son départ psychique. Pas de vains mots ; une femme qui reproche à son propre mari le fait qu’il est étranger, qu’il n’a rien à faire en France, qu’il vit de l’argent d’une Française, etc. etc… une telle femme, on la quitte. On fait taire son cœur et on se rend compte que de rester avec une pareille personne serait s’abaisser à l’extrême. Cette femme, parce qu’elle avait un pauvre petit héritage d’une tante, n’a jamais pu s’imaginer que je l’avais épousée sans intérêt. Si ma pauvre mère mourrait – et j’espère bien que je vivrai moins longtemps que tous ceux qui pensent à me léguer quelque chose –, je dis si ma pauvre mère était morte, elle n’aurait pas pu me jeter à la tête ces ignominies ! En outre, depuis que je suis marié, à part que j’ai pas mal rapporté, je me suis toujours appliqué à gagner de l’argent ou à préparer la manière d’en gagner. Que diable ! je ne suis qu’un auteur de trente-huit ans !!! » Cinquante ans plus tard, Hermine et Fritz vivaient toujours ensemble dans ce même appartement (photo ci-dessous, années cinquante), sans plus guère de soucis pécuniaires. Ceci même si les tensions resurgissaient par moments…
La Légion étrangère
Or, contre toute attente, les choses vont s’apaiser en l’espace de quelques jours. Le 10 septembre, Vanderpyl note : « Madame Hermine, enfin, ce soir, décide de faire la paix… N’en parlons plus. Je l’aime et ça fait le compte. » Et le grand soulagement survient le surlendemain : « Ce matin, j’ai lu dans L’Écho de Paris qu’on priait tous les ajournés étrangers et autres à repasser la visite. Sans en parler à ma femme, et au lieu d’aller à mon cours d’ambulancerie, je suis allé aux Invalides. Je suis pris et de droit devient français… Une nouvelle vie courte ou longue, j’aime mieux qu’elle soit longue, commence donc pour moi… » Autorisé à s’engager, mais bien entendu pas encore naturalisé, Fritz rédige sans tarder son testament – ceci dans son Journal, dont il défend en la circonstance la publication. « Drôle de vie ! et j’ai la trouille ! Parfaitement », conclut-il.
Vanderpyl légionnaire, annonce la presse
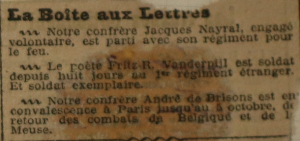 Sur-le-champ, il se fait légionnaire. Que serait-il devenu dans un pays où aucune force combattante ne recrutait les étrangers ? Dans sa rubrique « La Boîte aux Lettres » – laquelle donne des nouvelles des journalistes et des écrivains en temps de guerre –, le quotidien L’Intransigeant annonce à ses lecteurs le 22 septembre : « Le poète Fritz-R. Vanderpyl est soldat depuis huit jours au 1er régiment étranger. Et soldat exemplaire. » Le Haguenois se demande comment Fernand Divoire (1883-1951), collaborateur de ce quotidien, a été mis au courant ; ce dernier lui adresse d’ailleurs un petit mot pour lui souhaiter le meilleur : « Bonne chance, oude Fritz, et reviens-nous intact. » Dans son premier numéro, Le Bulletin des Écrivains – mensuel créé par ce même Divoire et quelques autres journalistes pour servir la mémoire des hommes de lettres morts et pour établir un lien entre les auteurs combattants – fera lui aussi part à ses lecteurs – écrivains au front, leurs amis et leur famille – de la nouvelle situation du Hollandais dont le nom figure en assez bonne compagnie : « Sont engagés volontaires dans les régiments étrangers : Canudo, Guillaume Apollinaire, Sylvain Bonmariage, Fritz-R. Vanderpyl, Maurice Kaplan, Blaise Cendrars, Waldemar-Georges. » Dans une lettre envoyée depuis le front le 30 septembre à Hermine, Guy-Charles Cros partage le soulagement de son ami : « Bravo pour Fritz dont les désirs sont ainsi exaucés ! » Dans sa correspondance, Max Jacob (1876-1944) mentionne lui aussi cet engagement : « J’ai eu des nouvelles d’Avignon par Galanis qui y était. Notre Picasso habite 14, rue saint-Bernard et fait, dit-on, les plus belles choses qu’il ait jamais faites. Guillaume Apollinaire est (à Orléans) à la Légion étrangère avec Serge et Galanis. Ils y souffrent de voisinages peu agréables. Vanderpyl y est aussi et, je crois, Canudo. Aucune nouvelle de Salmon ; Mac Orlan blessé au pied est revenu puis reparti […]. Galanis, retour d’Avignon, engagé à Orléans dans la Légion Étrangère, voisinant avec Guillaume, Serge, Vanderpyl en Canudo dans une racaille écœurante. »
Sur-le-champ, il se fait légionnaire. Que serait-il devenu dans un pays où aucune force combattante ne recrutait les étrangers ? Dans sa rubrique « La Boîte aux Lettres » – laquelle donne des nouvelles des journalistes et des écrivains en temps de guerre –, le quotidien L’Intransigeant annonce à ses lecteurs le 22 septembre : « Le poète Fritz-R. Vanderpyl est soldat depuis huit jours au 1er régiment étranger. Et soldat exemplaire. » Le Haguenois se demande comment Fernand Divoire (1883-1951), collaborateur de ce quotidien, a été mis au courant ; ce dernier lui adresse d’ailleurs un petit mot pour lui souhaiter le meilleur : « Bonne chance, oude Fritz, et reviens-nous intact. » Dans son premier numéro, Le Bulletin des Écrivains – mensuel créé par ce même Divoire et quelques autres journalistes pour servir la mémoire des hommes de lettres morts et pour établir un lien entre les auteurs combattants – fera lui aussi part à ses lecteurs – écrivains au front, leurs amis et leur famille – de la nouvelle situation du Hollandais dont le nom figure en assez bonne compagnie : « Sont engagés volontaires dans les régiments étrangers : Canudo, Guillaume Apollinaire, Sylvain Bonmariage, Fritz-R. Vanderpyl, Maurice Kaplan, Blaise Cendrars, Waldemar-Georges. » Dans une lettre envoyée depuis le front le 30 septembre à Hermine, Guy-Charles Cros partage le soulagement de son ami : « Bravo pour Fritz dont les désirs sont ainsi exaucés ! » Dans sa correspondance, Max Jacob (1876-1944) mentionne lui aussi cet engagement : « J’ai eu des nouvelles d’Avignon par Galanis qui y était. Notre Picasso habite 14, rue saint-Bernard et fait, dit-on, les plus belles choses qu’il ait jamais faites. Guillaume Apollinaire est (à Orléans) à la Légion étrangère avec Serge et Galanis. Ils y souffrent de voisinages peu agréables. Vanderpyl y est aussi et, je crois, Canudo. Aucune nouvelle de Salmon ; Mac Orlan blessé au pied est revenu puis reparti […]. Galanis, retour d’Avignon, engagé à Orléans dans la Légion Étrangère, voisinant avec Guillaume, Serge, Vanderpyl en Canudo dans une racaille écœurante. »
Passé d’abord par la caserne des Tourelles (Compagnie du 1er Régiment Légion étrangère, Paris) pour les premières formalités, Vanderpyl est affecté dès le 23 septembre – ainsi qu’en atteste une autorisation de sortie signée par le lieutenant commandant de la compagnie en question (ci-dessous, signature illisible) – à celle de Reuilly, dans le XIIe arrondissement de Paris. Le 27 mars 1915, le diariste se souvient d’une excursion de l’une à l’autre, ceci alors qu’il visite une petite église, rue de Bagnolet, qu’il a vue « pour la première fois le soir entre 6 et 7 heures, vers le milieu de septembre 1914, quand on nous faisait partir de Reuilly pour les Tourelles (sic). Je parlerai probablement un jour de cette tragique balade entre Serpieri et Hayes, portant des paquets d’effets militaires, chacun selon sa bonne volonté. Je n’en pouvais déjà plus, en haut de la rue de Charonne quand, tout à coup, de loin, j’aperçois cette église villageoise ».
Autorisation de sortie, 23 septembre 1914, caserne des Tourelles
Peu après la guerre, dans le périodique belge Pourquoi pas ?, il évoquera ce premier uniforme : « Quand les nègres auront leur Guillaume le Conquérant et que Paris sera tout à fait comme Chicago (heureuse époque !), je ne pourrai encore oublier mon premier vêtement militaire d’engagé volontaire de 1914. C’était bien la peine que ma grand-mère d’Amsterdam m’achetât, à mes vingt ans, un remplaçant pour que je me voie, à quarante, dans un accoutrement dont tel troufion de Caf’ Conc’ aurait été jaloux : un pantalon de sergent de ville, un vieux képi rouge, une veste d’artilleur et un trac… mais un trac atroce. » À Reuilly, le simple troupier occupe – grâce à ses kilos et au fait qu’il parle plusieurs langues – les fonctions de chef de l’enrôlement des volontaires étrangers. Séjournant vingt ans plus tard aux Pays-Bas, le journaliste André Delhay (1889-1962) se souvient de lui, avant, pendant et après le conflit : « Vous le rappelez-vous, jadis, polyglotte en redingote et chapeau de forme, guidant, le jour, des gens de tous pays et le soir, entre deux discours, à la Closerie des Lilas puis à l’Habitué, rue de Buci, brodant des refrains mélodieux et surprenants : ‘‘Il pleut, c’est à pleurer… et il y a des poètes qui n’ont pas de parapluie.” Le revoyez-vous, ensuite, barbichu, en capote de soldat de la Grande Guerre ; puis, en veston noir et pantalon à petits carreaux, aidant, dans la presse, les peintres d’avant-garde et régentant la table française. Quelle géniale figure, gourmande, grognonne, tendre et exaltée !... C’était le fils d’un restaurateur de La Haye… » Une page volante des « archives Vanderpyl » porte ces lignes : « Afin de se rendre indispensable dans les bureaux, il raconte à son commandant qu’il savait dix langues. On l’avait mis dans une pièce aux murs couleur anthracite où il devait tenir à jour un registre mentionnant leur nationalité, des Japonais, Croates, Polonais, Suisses, Italiens, Portugais, Américains du Sud et du Nord qui venaient s’engager. » Autrement dit, dans un bureau éloigné tout au plus de deux kilomètres de son domicile, le soldat exemplaire accueille et inscrit les hommes qui se présentent, ce dont il doit rendre compte quotidiennement au commandant. Dans un premier temps, il ressent, dans ce lieu où s’avancent des ressortissants d’une cinquantaine de pays différents, nous dit-il, une forme de bien-être comme au sein d’une rédaction « de petits journaux dans les environs des grands boulevards ». En quelque sorte, un prisonnier heureux de se rendre enfin utile.
Caserne Reuilly
Les médecins-majors ne recalant dorénavant aucun volontaire – pas même un Suisse tuberculeux –, le travail ne manque pas. Dans la caserne où prennent place les activités de quatre compagnies, Fritz retrouve son « ami le poète Aeschimann ». Il a pour collègue un certain Lévy : « C’est un embusqué type, recommandé par la Haute Finance… mais comme je viens de le dire, ce sera pour après la guerre, si je vis encore, d’en parler. Entre-temps, je ferai de mon mieux pour me brouiller avec lui. » Ce passage est à mettre en regard d’une phrase que Vanderpyl a consignée le 7 août 1914 : « Je crois que jusqu’à nouvel ordre, je ne sens plus l’antisémitisme. » En d’autres mots, il se propose de laisser au repos, en ces temps de guerre, sa virulente fibre antijuive. Ce qui ne va pas de soi. Alors que Clémenceau entend dénicher les embusqués, poursuit le légionnaire, le petit Lévy, qui appartient à l’écurie du Tigre, ne dort jamais à la caserne, ne fout rien, il est « arrogant comme seulement un petit Juif rouquin, riche et sûr de son affaire, peut l’être ». Cet antisémitisme, en même temps que la parution en 1942 de la brochure L’Art sans patrie, un mensonge : le pinceau d’Israël, que sa collaboration aux quotidiens Paris-Soir et Paris-Midi pendant l’Occupation ainsi que le placement, à la même époque, de quelques chroniques picturales dans le Pariser Zeitung, vaudront au critique de figurer, dès septembre 1944, à côté de son ami Maurice de Vlaminck et de quelques autres auteurs plus ou moins proches – Jean Ajalbert (1863-1947), Fernand Divoire, Henri Béraud (1885-1958), André Germain (1881-1971), Edmond Jaloux (1878-1949), Camille Mauclair (1872-1945), Charles Maurras (1868-1952), André Salmon –, sur la liste des hommes de lettres indésirables dressée par le Comité national des écrivains. Ce discrédit entraînera pour ainsi dire la fin de la carrière de Fritz – à près de soixante-dix ans – comme commentateur d’art et analyste gastronomique. D’autre part, il hâtera sans aucun doute l’oubli dans lequel ce « réjouissant Hollandais-méridional que tout le Quartier Latin a connu » est tombé.
Arthur Knaap
 Parmi les volontaires que le 2e classe Vanderpyl enregistre au sein de son unité – rebaptisée, fin octobre 1914, 3e Régiment de marche de Paris du 1er Étranger, lequel comprenait outre des volontaires de divers pays, des pompiers et des gendarmes français – figurent un certain nombre de ses compatriotes. Ainsi, le 31 octobre, il inscrit le Néerlandais d’origine indonésienne, Arthur Knaap (1893-1938) : « Le capitaine Fernagu dit au sergent du poste : ‘‘Vous connaissez la consigne… faut pas laisser entrer des femmes ! Il y a bien assez de cons ici…’’ Élégance d’expression toute française. Arthur Knaap, le fils du Javanais Knaap, journaliste, vient s’engager… il est aussi beau (ou presque) que sa délicieuse sœur. Qu’il sera affreux sous l’uniforme ! » Arthur Knaap a laissé de nombreuses lettres qu’il adressait à son amoureuse ; en 2014, un livre (Patria) ainsi qu’un film intitulé No Man’s Land. Au cœur des combats de la Première Guerre mondiale a été tiré de ses écrits.
Parmi les volontaires que le 2e classe Vanderpyl enregistre au sein de son unité – rebaptisée, fin octobre 1914, 3e Régiment de marche de Paris du 1er Étranger, lequel comprenait outre des volontaires de divers pays, des pompiers et des gendarmes français – figurent un certain nombre de ses compatriotes. Ainsi, le 31 octobre, il inscrit le Néerlandais d’origine indonésienne, Arthur Knaap (1893-1938) : « Le capitaine Fernagu dit au sergent du poste : ‘‘Vous connaissez la consigne… faut pas laisser entrer des femmes ! Il y a bien assez de cons ici…’’ Élégance d’expression toute française. Arthur Knaap, le fils du Javanais Knaap, journaliste, vient s’engager… il est aussi beau (ou presque) que sa délicieuse sœur. Qu’il sera affreux sous l’uniforme ! » Arthur Knaap a laissé de nombreuses lettres qu’il adressait à son amoureuse ; en 2014, un livre (Patria) ainsi qu’un film intitulé No Man’s Land. Au cœur des combats de la Première Guerre mondiale a été tiré de ses écrits.
Autre nouveau légionnaire, celui-ci à compter du 29 octobre : « un journaliste hollandais nommé Monnier ». Le 27 novembre, ce Monnier laisse un mot d’adieu à Vanderpyl car son régiment (3e régiment du 1er Étranger) part le lendemain à l’aube. Malgré ses réticences à côtoyer des Hollandais au sein de la caserne, Vanderpyl passe tout de même un peu de temps avec quelques-uns d’entre eux : ainsi, un certain Suermondt et Ebed van der Vlugt (1886-1957), le retrouvent le 28 novembre 1914 avec quelques compères pour boire un verre dans son bureau non chauffé. Le même jour, Fritz précise dans son Journal : « Il y a au régiment un nombre assez élevé de Néerlandais : des employés, des interprètes, des hommes de peine, des journalistes, des négociants, des jeunes gens riches comme ce Van der Vlugt, etc. Mais Van der Vlugt a fait énormément d’études… il s’y connaît sérieusement en photographie, paraît-il. Je n’en sais rien. Mais il dit des choses très sensées sur les préliminaires d’une paix prochaine. On laisserait faire les socialistes allemands qui arrangeraient un gouvernement républicain en Prusse. Les autres États se détacheraient des Hohenzollern… Enfin, c’est trop long à expliquer… on verra bien ! »
12 légionnaires du régiment de Vanderpyl : Moïse Kisling (croix à gauche) et E. van der Vlugt (croix à droite). Le barbu pourrait-il être Vanderpyl ? (source : https://nllegioen.eu)
Comme beaucoup de ses contemporains, Fritz imagine que le conflit ne va pas s’éterniser. À d’autres moments, toutefois, il redoute « que cette plus affreuse de toutes les guerres » traîne « infiniment ». Il lui arrive d’ailleurs de parier un dîner ou un déjeuner avec d’autres soldats sur la durée de la guerre. Ainsi le 13 décembre : « M. Vanderpyl paiera un modeste repas d’au moins 100 sous si les Boches ne sont pas chassés de France avant la fin du mois de mars 1915. » À la veille de Noël, il évoque avec admiration le lieutenant Pierre de Lupel (1880-1929) qui est en convalescence à la Légion ; cet officier français est justement un ami « de Van der Vlugt, le rentier-philosophe », ainsi que de l’auteur belge Sylvain Bonmariage (1887-1966). Ce dernier, « bien élevé, mais d’une bêtise rarissime » se montre gentil avec Fritz : il « est d’une supérieure politesse avec moâ ! » ; le Hollandais connaissait le Belge avant qu’ils ne se retrouvent sous le même uniforme ; il le considérait d’ailleurs déjà comme un « grand crétin ». Malgré cela, il colle dans son Journal trois « sonnets pour les morts » que le Belge a composés et lui a recopiés, ceci non sans préciser que le quatrième vers du premier poème est de sa main.
On évalue le nombre de Néerlandais ayant signé un contrat à la Légion étrangère « pour la durée de la guerre » entre 215 et 1400, la Légion elle-même avançant le chiffre de 222. Dans Au service de la France. Les Volontaires étrangers de 1914, M.-C. Poinsot parle de plus de trois cents Hollandais regroupés le 26 août 1914 derrière le patriote Ricordo. Beaucoup de ces hommes vivaient à Paris avant le déclanchement des hostilités. Une part assez importante de ces volontaires aurait rejoint les forces régulières de l’armée. La Légion étant uniquement composée d’unités d’infanterie, il a paru en effet utile d’en répartir, en fonction de leurs capacités, dans l’armée de Terre et l’armée de l’Air au même titre que les citoyens français. Quelques Néerlandais ont ainsi piloté des avions de guerre. Il convient de noter qu’au total, quelques milliers de Néerlandais ont combattu sous d’autres couleurs, leur pays étant resté neutre (Belgique, Australie, États-Unis, Allemagne…). Rien qu’en 1914, environ 44 000 étrangers représentant 51 nationalités se sont présentés pour s’engager dans la Légion. Dont plusieurs centaines sont donc passés devant la barbe de Vanderpyl.
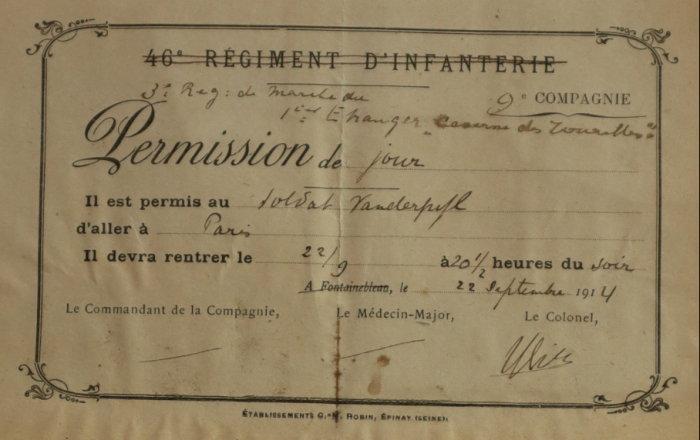 Permission dont a bénéficié Fritz à la veille de son départ de la caserne des Tourelles
Permission dont a bénéficié Fritz à la veille de son départ de la caserne des Tourelles
Distractions et désillusions du légionnaire
À la caserne, Vanderpyl côtoie d’autres connaissances, par exemple le Vallorbier Fernand Roches, le jeune Aguet – l’artiste et futur acteur William Aguet (1892-1965) ? –, neveu du député Gaston Thomson (1848-1932), ainsi que le peintre Moïse Kisling qui devait être blessé dans l’attaque au cours de laquelle Cendrars perdit un bras. Mais le plus souvent, leur compagnie lui est un motif d’irritation. N’écrit-il pas, le 11 novembre : « Il paraît qu’on va faire venir ici un bataillon du Régiment étranger d’Orléans. Pourvu qu’à côté de Roches et d’Aguet, de Bonmariage & de Kisling, l’infâme Apollinaire ne s’aboule pas ! » Ah ! pourquoi l’infâme Apollinaire redeviendra-t-il fréquentable moins de deux ans plus tard ? De toute façon, bien peu de soldats trouvent grâce aux yeux de Fritz. Parfois, il tolère la présence d’un certain Vincent Diamante – né en 1885 à Constantinople, naturalisé français le 31 décembre 1924 – qui fait rire la compagnie. À Reuilly, Paul Aeschimann semble être l’un des rares qu’il apprécie. Même si celui-ci lui communique à l’occasion des nouvelles peu fiables et peu faites pour lui remonter le moral. Ainsi, le 19 octobre : « Aeschimann, soldat de 1re classe de la 8e, me dit aujourd’hui qu’il paraît que le médecin-major Georges Duhamel a été tué par l’ennemi !! Pauvre, brave Duhamel. Albane doit être folle de chagrin. » Vanderpyl a été un proche de l’Abbaye de Créteil, cette communauté artistique utopiste des années 1906-1907 qui réunissait, à côté de Duhamel, le poète et futur galeriste Charles Vildrac (1882-1971), le flamboyant et fantasque auteur Alexandre Mercereau (1884-1945) ou encore le peintre Albert Gleizes (1881-1953), autant d’artistes qui ont joué un rôle important dans la vie du Hollandais et qui ont d’ailleurs imprimé et édité Les Saisons douloureuses, son premier recueil de vers français (couverture ci-dessous). Il a passé maints moments en compagnie de l’actrice Blanche Albane (1886-1975) et de son mari Georges Duhamel, surtout au cours des premières années de leur union. Il était d’ailleurs présent à la mémorable fête donnée à l’Abbaye de Créteil le 21 juillet 1907 au cours de laquelle les deux jeunes gens se sont rencontrés. Le 29 octobre 1914, Vanderpyl apprend par l’un de ses voisins d’immeuble que le futur académicien est en réalité toujours en vie. Après la Grande Guerre, les liens entre les deux hommes se distendront. Ils finiront même par s’ignorer totalement. Voire, qui sait, par se détester.
Premier recueil en français de Vanderpyl, 1907
Avec un antiquaire répondant au patronyme de Blaise ou avec Attilio Serpieri (1867-1924), un pianiste et compositeur sicilien, eux aussi légionnaires, Fritz prend la liberté d’aller déjeuner dans le quartier de la caserne, parfois chez un Italien, le plus souvent chez Gustave Thullier, restaurateur établi depuis un demi-siècle au 243 du faubourg Saint-Antoine, dont la femme concocte une cuisine bourgeoise excellente. À l’épouse de M. Blaise, le critique envoie un exemplaire de ses Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes. Il offre ce même essai sur l’art à un capitaine, petit-neveu du peintre Thomas Couture (1815-1879), seul officier avec lequel il semble avoir eu quelques atomes crochus et qui va le dispenser de se faire vacciner contre la typhoïde. Une piqûre qu’il redoute bien plus que d’être envoyé au front, ainsi que le révèle cette note du 15 novembre : « On va nous vacciner aujourd’hui avec du sérum anti-typhoïde ou quelque chose dans ce genre. Je déclarerai que je suis syphilitique et bilieux pour ne pas avoir mon sang pourri par une dose de saloperie dont personne encore aujourd’hui ne connaît l’efficacité ni les conséquences ! » On comprend de quel côté Vanderpyl aurait penché en pleine pandémie de Covid-19…
Après des premières semaines au cours desquelles l’enthousiasme prédominait, Vanderpyl commence à sérieusement s’ennuyer entre ses quatre murs de Reuilly. Au point d’en arriver à écrire, la veille de Noël, qu’« on s’emmerde à mort dans cette caserne ». Il faut dire qu’au fil du temps, les engagés se font de plus en plus rares. L’un d’eux parvient tout de même à l’amuser :
Un des derniers engagés qui s’amène avec son p’tit ballot et une cigarette derrière l’oreille.
– Nom… prénom… adresse… et que faîtes-vous dans le civil ?
– ?
– Quelle profession ?
– Démolisseur.
– Démolisseur !! Ah… bien… voilà comme il nous en faudrait beaucoup : des démolisseurs colosses.
La lettre aux épingles de sûreté
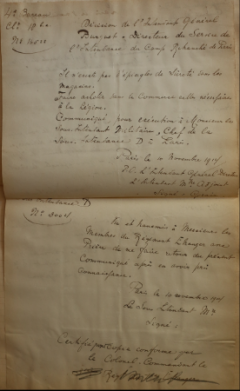 En l’absence de nouveaux volontaires, le soldat exemplaire « reste des journées entières sans presque rien faire ». Il relit le roman picaresque Gil Blas de Le Sage (1668-1747). Ce n’est pas la requête tardive de son chef de bureau – écrire une chanson en vue de la mettre en musique – qui va le galvaniser. Dans son bureau « froid, noir et puant » où il a recueilli un chien qui errait dans la cour, il n’a plus pour tâche que de recopier des lettres ennuyeuses afin de demander, par exemple, des gamelles ou d’autres ustensiles à l’Intendance. « Voilà le commandant-major qui m’appelle. Des lettres à copier qui parlent de moulins à café… Hier, c’étaient des items parlant de 9 000 épingles de sûreté !!!! […] Heureusement que j’ai une excellente gomme à encre, car j’ai tellement peur de me tromper que chaque fois, en copiant une lettre, je fais des fautes. » Face à l’ennui, il regrette de ne pas être au front. Toutefois, le sort que connaissent ses camarades éteint bien vite en lui la moindre velléité : « Ceux qui en reviennent déjà, écrit-il le 7 décembre, ceux de notre régiment que de trop longues marches forcées ont rendu inaptes à faire campagne, tremblent quand ils parlent de leur aventure. Ils manquaient de tout, les voitures étaient restées en panne, dès le premier jour. Les rhumatisants, les plus ou moins faibles, n’en pouvaient plus le lendemain. Mais je crois que c’est surtout la frousse qui les a rendus malades. » Dans son oisiveté, Vanderpyl se demande quel auteur se lèvera pour écrire, un jour, sur la guerre « les pages que la postérité exigera de nous autres, impuissants écrivains ? »
En l’absence de nouveaux volontaires, le soldat exemplaire « reste des journées entières sans presque rien faire ». Il relit le roman picaresque Gil Blas de Le Sage (1668-1747). Ce n’est pas la requête tardive de son chef de bureau – écrire une chanson en vue de la mettre en musique – qui va le galvaniser. Dans son bureau « froid, noir et puant » où il a recueilli un chien qui errait dans la cour, il n’a plus pour tâche que de recopier des lettres ennuyeuses afin de demander, par exemple, des gamelles ou d’autres ustensiles à l’Intendance. « Voilà le commandant-major qui m’appelle. Des lettres à copier qui parlent de moulins à café… Hier, c’étaient des items parlant de 9 000 épingles de sûreté !!!! […] Heureusement que j’ai une excellente gomme à encre, car j’ai tellement peur de me tromper que chaque fois, en copiant une lettre, je fais des fautes. » Face à l’ennui, il regrette de ne pas être au front. Toutefois, le sort que connaissent ses camarades éteint bien vite en lui la moindre velléité : « Ceux qui en reviennent déjà, écrit-il le 7 décembre, ceux de notre régiment que de trop longues marches forcées ont rendu inaptes à faire campagne, tremblent quand ils parlent de leur aventure. Ils manquaient de tout, les voitures étaient restées en panne, dès le premier jour. Les rhumatisants, les plus ou moins faibles, n’en pouvaient plus le lendemain. Mais je crois que c’est surtout la frousse qui les a rendus malades. » Dans son oisiveté, Vanderpyl se demande quel auteur se lèvera pour écrire, un jour, sur la guerre « les pages que la postérité exigera de nous autres, impuissants écrivains ? »
À la maussaderie s’ajoute le fait, ainsi qu’on l’a vu, que l’entente de Fritz avec les autres gratte-papier était loin d’être parfaite. À propos d’Aguet et de Fernand Roches – lequel a crayonné une ou deux caricatures de lui –, il précise, le 3 novembre : « J’ai commis une lourde gaffe en proposant Roches comme secrétaire. Il prétend du reste aujourd’hui que je n’y suis pour rien… […] En résumé, je suis toute la journée avec deux blagueurs arrogants, disant du mal de la Légion, ayant de petits secrets entre eux, me trouvant grossier, sans finesse, pas homme du monde pour un sou et surtout coléreux… le fond de leur pensée est que je les méprise… et c’est cela qui les fâche car ils le sentent bien. » Le temps est révolu où il considérait la caserne comme une prison plutôt agréable : il a dorénavant l’impression d’être dans une école, entouré « de méchants camarades » et « de professeurs injustes », ce qui est bien pire. Quand un capitaine, voyant le chien couché à ses pieds, lui demande sèchement : « Qu’est-ce que c’est que ce cabot-là ? », Vanderpyl répond : « Mon seul ami ici, mon capitaine… » L’officier de s’en aller en haussant les épaules.
Vanderpyl caricaturé par l’éditeur F. Roches (fin 1914)
 Par ailleurs, ne touchant pratiquement pas d’argent, Fritz doit puiser dans ses rares économies pour se nourrir. Sa lassitude se trouve accentuée par le fait que l’ambiance générale se dégrade à Reuilly, alors même que les soldats héritent, à l’instar des pompiers, de deux grenades sur leur capote : « Dans notre Régiment, tout ne va pas très bien. Le colonel a dit à Serpieri : ‘‘Vous volez cette capote que vous portez…’’ parce qu’il n’est pas capable de partir sur le front. C’est réellement scandaleux, aussi scandaleux que ces caporaux-pompiers qui disaient à leurs hommes : ‘‘Vous n’êtes venus ici que pour bouffer !’’ En effet, Roches, Aeschimann, Friedman, Bonmariage, Hayes, Aguet, Vanderpyl, Serpieri, Koff et mille autres, ayant ou de fortes situations financières ou des métiers rapportant largement, ou des économies largement suffisantes pour passer ces temps horribles, sont venus pour manger !! Or, on s’étonne que tant d’hommes demandent leur réforme. C’est tout de même extrêmement simple : aux Invalides, on prend tout le monde… des tuberculeux, des syphilitiques, des poitrinaires, des obèses, des myopes, des cardiaques, des asthmatiques, etc., etc., en leur promettant telle place de brancardier, d’interprète, de secrétaire, de tailleur, de cordonnier, que sais-je encore. Une fois arrivés au Régiment, on les force à faire des exercices dont ils sont absolument incapables ! mais absolument… et tombant malades tout de suite à cause (surtout pour les pauvres) d’un manque de couverture, des courants d’air, des marches et mouvements corporels forcés, de la mauvaise ou trop lourde nourriture, de l’énervement que produit sur moi comme sur d’autres la peur chronique de chefs gueulards. Ils ne sont plus bons à rien ces ajournés du 21 août, après 8 jours de caserne. Si leur présence pouvait servir à quelque chose, ce serait très bien… une vie en vaut une autre ! » (Journal, 4 novembre 1914) Autre considération dans la même veine, en date du 3 janvier 1915 : « Comme ils s’y prennent mal les officiers pour rendre des hommes mariés d’entre trente-cinq et quarante-cinq ans bons soldats. Tout dans le service militaire, au moins à Reuilly, est fait pour embêter, choquer et même insulter le soldat de bonne volonté. » On saisit mieux l’exaspération de beaucoup d’engagés. On prend aussi la mesure de ce qui sépare le légionnaire englué dans la paperasse parisienne du trouffion qui patauge dans les tranchées… quand il n’est pas déjà mort.
Par ailleurs, ne touchant pratiquement pas d’argent, Fritz doit puiser dans ses rares économies pour se nourrir. Sa lassitude se trouve accentuée par le fait que l’ambiance générale se dégrade à Reuilly, alors même que les soldats héritent, à l’instar des pompiers, de deux grenades sur leur capote : « Dans notre Régiment, tout ne va pas très bien. Le colonel a dit à Serpieri : ‘‘Vous volez cette capote que vous portez…’’ parce qu’il n’est pas capable de partir sur le front. C’est réellement scandaleux, aussi scandaleux que ces caporaux-pompiers qui disaient à leurs hommes : ‘‘Vous n’êtes venus ici que pour bouffer !’’ En effet, Roches, Aeschimann, Friedman, Bonmariage, Hayes, Aguet, Vanderpyl, Serpieri, Koff et mille autres, ayant ou de fortes situations financières ou des métiers rapportant largement, ou des économies largement suffisantes pour passer ces temps horribles, sont venus pour manger !! Or, on s’étonne que tant d’hommes demandent leur réforme. C’est tout de même extrêmement simple : aux Invalides, on prend tout le monde… des tuberculeux, des syphilitiques, des poitrinaires, des obèses, des myopes, des cardiaques, des asthmatiques, etc., etc., en leur promettant telle place de brancardier, d’interprète, de secrétaire, de tailleur, de cordonnier, que sais-je encore. Une fois arrivés au Régiment, on les force à faire des exercices dont ils sont absolument incapables ! mais absolument… et tombant malades tout de suite à cause (surtout pour les pauvres) d’un manque de couverture, des courants d’air, des marches et mouvements corporels forcés, de la mauvaise ou trop lourde nourriture, de l’énervement que produit sur moi comme sur d’autres la peur chronique de chefs gueulards. Ils ne sont plus bons à rien ces ajournés du 21 août, après 8 jours de caserne. Si leur présence pouvait servir à quelque chose, ce serait très bien… une vie en vaut une autre ! » (Journal, 4 novembre 1914) Autre considération dans la même veine, en date du 3 janvier 1915 : « Comme ils s’y prennent mal les officiers pour rendre des hommes mariés d’entre trente-cinq et quarante-cinq ans bons soldats. Tout dans le service militaire, au moins à Reuilly, est fait pour embêter, choquer et même insulter le soldat de bonne volonté. » On saisit mieux l’exaspération de beaucoup d’engagés. On prend aussi la mesure de ce qui sépare le légionnaire englué dans la paperasse parisienne du trouffion qui patauge dans les tranchées… quand il n’est pas déjà mort.
Guy-Charles Cros, prisonnier de guerre : document du ministère de la Guerre
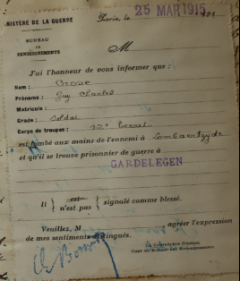 Peu après, le moral de Vanderpyl va en prendre un coup quand on l’informe que son cher Guy-Charles Cros est détenu à Gardelegen (Saxe), capturé par l’ennemi. Le fils de Charles, célèbre inventeur et auteur du tout aussi célèbre poème humoristique « Le hareng saur », passera le reste du conflit réduit à ce statut de prisonnier de guerre. Ses compagnons d’infortune le surnomment bientôt « la mitrailleuse à cause de sa volubilité de langage ». Fritz lui dédiera « Tercets pour le Nouvel An. À Guy-Charles Cros, prisonnier en Prusse », poème publié dans la livraison du Mercure de France du 1er février 1916. Dans ces vers, l’auteur retient une rime en jouant sur son propre patronyme : « strophes de concile » / « couplets de Vanderpyl ». À une date bien postérieure, le peintre Auguste Chabaud, devenu l’un de ses grands amis, choisira, pour un huitain, une rime un rien plus riche : « Vanderpyl » / « sex-appeal ». Sans doute Fritz est-il également marqué par la mort sur le champ de bataille, en décembre 1914, de Jacques Nayral (1876-1914), écrivain vosgien et beau-frère de Gleizes, auquel il avait dédié « Ballade estivale » du recueil Les Saisons d’un poète, poème dont l’ultime vers était d’une certaine façon prémonitoire : tel tombe un guerrier sans secours. Le désole aussi, certains jours, le traitement « dégueulasse » que réservent des journaux à la Légion étrangère, par exemple Le Matin à l’occasion de la fin « héroïque de Szuyski, ingénieur, rendant son drapeau perforé de 34 balles ». Władysław Szuyski (1865-1914) était le porte-étendard du 2e Régiment de marche du 1er Étranger.
Peu après, le moral de Vanderpyl va en prendre un coup quand on l’informe que son cher Guy-Charles Cros est détenu à Gardelegen (Saxe), capturé par l’ennemi. Le fils de Charles, célèbre inventeur et auteur du tout aussi célèbre poème humoristique « Le hareng saur », passera le reste du conflit réduit à ce statut de prisonnier de guerre. Ses compagnons d’infortune le surnomment bientôt « la mitrailleuse à cause de sa volubilité de langage ». Fritz lui dédiera « Tercets pour le Nouvel An. À Guy-Charles Cros, prisonnier en Prusse », poème publié dans la livraison du Mercure de France du 1er février 1916. Dans ces vers, l’auteur retient une rime en jouant sur son propre patronyme : « strophes de concile » / « couplets de Vanderpyl ». À une date bien postérieure, le peintre Auguste Chabaud, devenu l’un de ses grands amis, choisira, pour un huitain, une rime un rien plus riche : « Vanderpyl » / « sex-appeal ». Sans doute Fritz est-il également marqué par la mort sur le champ de bataille, en décembre 1914, de Jacques Nayral (1876-1914), écrivain vosgien et beau-frère de Gleizes, auquel il avait dédié « Ballade estivale » du recueil Les Saisons d’un poète, poème dont l’ultime vers était d’une certaine façon prémonitoire : tel tombe un guerrier sans secours. Le désole aussi, certains jours, le traitement « dégueulasse » que réservent des journaux à la Légion étrangère, par exemple Le Matin à l’occasion de la fin « héroïque de Szuyski, ingénieur, rendant son drapeau perforé de 34 balles ». Władysław Szuyski (1865-1914) était le porte-étendard du 2e Régiment de marche du 1er Étranger.
 Guy-Charles Cros (croix) au milieu de ses camarades dans leur camp de prisonniers
Guy-Charles Cros (croix) au milieu de ses camarades dans leur camp de prisonniers
Malgré tout, en plus de se taper la cloche à la maison Thullier, Fritz jouissait pour compenser le morne quotidien de certaines libertés. « Le soir, à 5 heures, racontera-t-il en 1919 dans l’hebdomadaire belge Pourquoi pas ?, on avait quartier libre et je prenais le tramway pour aller dîner chez moi. » Il poursuit en narrant une anecdote : « Alors, un jour, il arriva que le receveur du véhicule public, me montrant un gros homme en bourgeron bleu, me dit : ‘‘Pas la peine de sortir ton portemonnaie, mon gros… ce monsieur a payé ton billet que voici.’’ Gêné, stupide, j’essayai de voir la figure de ce philanthrope inconnu : c’était mon crémier. Mais aussi, la guerre avait si bien transformé en R.A.T. obèse et sans charmes le monsieur confortable que j’étais, que ma pauvre aïeule elle-même ne m’aurait pas reconnu. » Cet uniforme peu seyant, le légionnaire le quitte enfin le 13 décembre, certes seulement pour quelques heures : « Hier, me suis mis en civil, bien en civil… pour voir dans une glace si je vivais encore. » Il obtient quelques brèves permissions, par exemple, on l’a vu, le 22 septembre, une autre à la Toussaint pour se rendre au cimetière, une à la Noël et de nouveau 24 heures à l’occasion du Nouvel An. Mais cela ne peut suffire à l’enjouer : « Je me sens prêt à mourir plutôt que de persister en cette vie d’anxiété et de stupide, inutile esclavage », écrit-il à la toute fin de l’année. Et au début de 1915, alors qu’il a échappé, semaine après semaine, à la vaccination contre la fièvre typhoïde qu’il redoutait tant, son corps le lâche. Il tombe malade. Le 9 janvier, à l’hôpital militaire Béguin, le voilà réformé. Épuisé, il reste couché chez lui, souffrant de différents maux, surtout gastriques. « Dix jours de cure : faim, coliques effrayantes, mal partout, faiblesse extrême. » Il a tout de même assez de forces pour lire : « Que ne lit-on pas quand on est malade : du Bloy, du Wilde, du Vanderpyl même et du Cros, du Péguy, du Fournier », plusieurs ouvrages de Huysmans aussi. C’est alors qu’une bonne nouvelle arrive…
 Laisser-passer pour aller déjeuner, sans doute chez Thullier
Laisser-passer pour aller déjeuner, sans doute chez Thullier
Après la réforme, la naturalisation et quelques publications
Vanderpyl tourne le dos à la Légion (dessin F. Roches)
 Le 20 janvier 1915, Fritz note dans son Journal : « Ma femme, revenant il y a 3 jours du ministère de la Justice, m’annonce que ma naturalisation signée est envoyée à la place et de là à Reuilly. » Le décret porte la date du 25 janvier. Sa naturalisation a été semble-t-il facilitée par le fait qu’il connaissait Albert Tirman (1868-1932), maître des requêtes au Conseil d’État – et frère de l’artiste peintre Henriette Tirman (1875-1952), une amie des Vanderpyl –, auquel il a rendu visite ou s’est adressé à quelques reprises en novembre. Pour tout légionnaire, la procédure en question était de toute façon accélérée. Ses « camarades » Fernand Roches et Sylvain Bonmariage avaient ainsi été naturalisés avant lui : le premier dès le 2 décembre 1914, le second le dernier jour de la même année. Devenir citoyen de sa terre d’adoption ne faisait plus aucun doute pour l’écrivain depuis le moment où, au début du conflit, lui et Hermine avaient dû se rendre à la mairie du XIIIe pour se déclarer comme étrangers. Cette dernière ne devait être réintégrée dans sa qualité de Française, qu’elle avait perdue par son mariage, que par un décret du 5 avril 1916. Tous deux étaient alors « peinés de ne pas [s’]être faits naturaliser » plus tôt. Jusque-là, Hermine craignait que son mari ne froissât ses propres parents s’il venait à renoncer à sa nationalité néerlandaise. De son côté, à la fin de son « Essai sur moi-même. II », Fritz a expliqué peu avant la guerre, non sans une once de fatuité, pourquoi il ne songeait pas à devenir un national, bien qu’il se considérât comme un auteur d’expression française : « Je suis bien résolu à ne jamais acheter pour quelques centaines de francs un brevet de naturalisation, bon pour les gens d’affaires qui ont spéculativement besoin d’une seconde nationalité, mais indigne pour le poète ! Je suis obligé de faire mon deuil de tout droit de vote et de ceux qui s’en suivent. J’attendrai patiemment jusqu’à ce que l’Histoire inscrive mon nom dans le grand livre des gloires françaises. » Dans le brouillon d’une lettre du printemps 1938, qu’il rédige en vue de répondre à des propos tenus par le politicien Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980), il reprend des termes similaires : « Je me suis engagé en 1914, ayant toujours eu horreur de la naturalisation. Si j’ai obtenu cette dernière – après un séjour ininterrompu de seize ans à Paris – elle a été non payée, mais due à mon engagement. J’aurais d’ailleurs pu faire valoir également les origines françaises de ma mère, qui sont la première raison pour laquelle j’ai échangé en 1899 la Hollande pour la France. » Fritz ne craignait pas d’exagérer la part de sang gaulois qui coulait dans les veines de sa génitrice.
Le 20 janvier 1915, Fritz note dans son Journal : « Ma femme, revenant il y a 3 jours du ministère de la Justice, m’annonce que ma naturalisation signée est envoyée à la place et de là à Reuilly. » Le décret porte la date du 25 janvier. Sa naturalisation a été semble-t-il facilitée par le fait qu’il connaissait Albert Tirman (1868-1932), maître des requêtes au Conseil d’État – et frère de l’artiste peintre Henriette Tirman (1875-1952), une amie des Vanderpyl –, auquel il a rendu visite ou s’est adressé à quelques reprises en novembre. Pour tout légionnaire, la procédure en question était de toute façon accélérée. Ses « camarades » Fernand Roches et Sylvain Bonmariage avaient ainsi été naturalisés avant lui : le premier dès le 2 décembre 1914, le second le dernier jour de la même année. Devenir citoyen de sa terre d’adoption ne faisait plus aucun doute pour l’écrivain depuis le moment où, au début du conflit, lui et Hermine avaient dû se rendre à la mairie du XIIIe pour se déclarer comme étrangers. Cette dernière ne devait être réintégrée dans sa qualité de Française, qu’elle avait perdue par son mariage, que par un décret du 5 avril 1916. Tous deux étaient alors « peinés de ne pas [s’]être faits naturaliser » plus tôt. Jusque-là, Hermine craignait que son mari ne froissât ses propres parents s’il venait à renoncer à sa nationalité néerlandaise. De son côté, à la fin de son « Essai sur moi-même. II », Fritz a expliqué peu avant la guerre, non sans une once de fatuité, pourquoi il ne songeait pas à devenir un national, bien qu’il se considérât comme un auteur d’expression française : « Je suis bien résolu à ne jamais acheter pour quelques centaines de francs un brevet de naturalisation, bon pour les gens d’affaires qui ont spéculativement besoin d’une seconde nationalité, mais indigne pour le poète ! Je suis obligé de faire mon deuil de tout droit de vote et de ceux qui s’en suivent. J’attendrai patiemment jusqu’à ce que l’Histoire inscrive mon nom dans le grand livre des gloires françaises. » Dans le brouillon d’une lettre du printemps 1938, qu’il rédige en vue de répondre à des propos tenus par le politicien Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980), il reprend des termes similaires : « Je me suis engagé en 1914, ayant toujours eu horreur de la naturalisation. Si j’ai obtenu cette dernière – après un séjour ininterrompu de seize ans à Paris – elle a été non payée, mais due à mon engagement. J’aurais d’ailleurs pu faire valoir également les origines françaises de ma mère, qui sont la première raison pour laquelle j’ai échangé en 1899 la Hollande pour la France. » Fritz ne craignait pas d’exagérer la part de sang gaulois qui coulait dans les veines de sa génitrice.
En s’engageant dans la Légion étrangère, Vanderpyl perdait de facto sa nationalité néerlandaise. Ainsi l’édictait une loi du royaume des Pays-Bas du 12 décembre 1892 (Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap). Autrement dit, en attendant sa naturalisation, il s’est semble-t-il retrouvé un temps apatride. Après avoir servi dans cette force combattante de l’Armée de terre française, ses compatriotes qui le souhaitaient pouvaient récupérer, en principe sans trop de difficultés, leur passeport batave. Fritz a fait un autre choix : il a privilégié la nationalité française et a vécu en France jusqu’à la fin de ses jours. Il n’a cependant pu invoquer en sa faveur ni de grands services au sein de la Légion, ni une grande expérience de légionnaire. Malgré l’absence de toute action héroïque, son intégration dans cette troupe prestigieuse lui aura permis de sauver son mariage et d’acquérir le document tant convoité. Sans compter qu’elle lui a donné l’occasion de nous transmettre un petit témoignage sur les tourments d’un simple soldat et le quotidien à la caserne de Reuilly. La dernière fois qu’il s’y rend, quelqu’un prend une photo (voir ci-dessous). On le voit en civil, à gauche, en compagnie de quelques légionnaires « dans la cour de la caserne : Hopper, cycliste du commandant, Bonmariage de Cercy avec son ami le gendarme belge, et moi, très élégant, très banquier ».
Fritz et des légionnaires, caserne Reuilly, début 1915
Une nouvelle période s’ouvre pour Vanderpyl dans l’attente d’être de nouveau déclaré apte au service, mais cette fois dans les forces régulières en tant que citoyen français. Pendant ce temps – tout comme Marthe Roux qui se rendra souvent au chevet d’Apollinaire –, son épouse assume les fonctions d’infirmière au sein de la Croix-Rouge. Elle y est même chef d’un service. Là, elle est bien sûr confrontée aux atrocités de la guerre : « L’homme aux 200 trous de l’hôpital d’Hermine est mort hier », note l’écrivain dans son Journal le vendredi saint 1915. Lui-même, une fois rétabli, reprend ses habitudes, dînant souvent dehors ou chez des amis, recevant aussi à sa table Brancusi, le peintre André Dunoyer de Segonzac (1884-1974) ou encore l’aviateur Braindejonc et sa maîtresse, la romancière et illustratrice Jeanne Cals (1883-1976)… Bien vite, il se remet à visiter des expositions. Par exemple, dès le 25 janvier 1915, le galeriste Léon Marseille l’emmène en voiture au Petit Palais pour contempler œuvres et objets d’art qui vont représenter la France à une grande manifestation à San Francisco. Fritz s’est proposé pour accompagner en Californie Albert Tirman, lequel est chargé de cette mission culturelle. Mais bien que le naturalisé ait fourni à ce dernier quelques introductions auprès de personnalités de la ville des bords du Pacifique, le haut fonctionnaire refuse d’emmener le réformé rondelet dans ses bagages. Comme à son habitude, Vanderpyl s’occupe par ailleurs en dévorant des livres – il s’enivre de Balzac – et en noircissant des pages. Son roman Marsden Stanton à Paris avance. En août 1915, il annonce : « J’ai fini Marsden Stanton. Ma femme le copie sur la machine à écrire de Mme Ciolkowska qui vient d’accoucher chez les nonnes de N.-D. du Bon-Secours ! (qui me soignèrent en 1899 quand, épuisé, etc)… ». Peu après son arrivée à Paris en septembre 1899, le Haguenois avait vécu en clochard à Paris ; dans un état pitoyable et à bout de forces, il avait été recueilli par ces religieuses auprès desquelles il avait pu se retaper.
Réintégration de Hermine Augé-Vanderpyl dans la nationalité française
Ayant essuyé le refus de différents éditeurs, Fritz se satisfait de voir le périodique le Mercure de France publier Marsden Stanton à Paris en plusieurs livraisons à la fin de l’année 1916. Dans cette œuvre, la Légion étrangère apparaît fugacement. On y découvre, à côté de Stanton, jeune artiste américain qui découvre la capitale, un sculpteur confirmé d’origine québécoise, Alexandre Guiraud qui, bien que francophone et plus âgé que Vanderpyl, n’est pas sans présenter quelques points communs avec lui : il arrive à Paris sans le sou et contre l’avis paternel ; démuni et affamé, il est recueilli dans un hôpital ; il rencontre une parente de sa mère ; il s’essaie au « dessin à la glaise » comme Fritz s’est essayé à crayonner ainsi qu’à « sculpter » des vers ; il s’engage dans la Légion étrangère ; il fréquente le restaurant Thullier… On peut imaginer que l’évocation de cet établissement, de son patron et de sa patronne, restitue ce que Fritz a vécu au faubourg Saint-Antoine à la fin de l’année 1914 avec quelques camarades légionnaires, même si, dans sa fiction, il situe ce lieu à une autre adresse de la capitale. Dans un hommage qu’il rend aux Américains morts pour la France, l’auteur Pierre Mille (1864-1941) établit un parallèle entre le protagoniste du roman de Vanderpyl et le célèbre poète et légionnaire Alan Seeger (1888-1916) : « Sorti de la Harvard University, Alan Seeger était venu, en 1912, terminer ses études à Paris. Sans doute il éprouva chez nous cet enchantement, il subit cette mystérieuse et puissante emprise que caractérise dans un roman en cours dans le Mercure de France, Marsden Stanton à Paris, M. Fritz Vanderpyl. Dès les premiers jours de la guerre, Seeger s’engagea dans la Légion. Seulement, le héros de M. Vanderpyl est un peintre ; et Alan Seeger était poète. Il est tombé en poète… »
Le long poème Mon chant de guerre (1917)
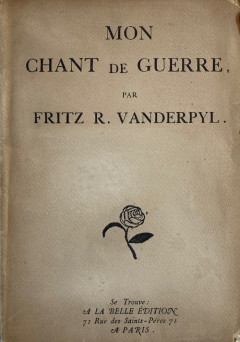 Parallèlement à l’achèvement de ce roman, Fritz travaille à Mon chant de guerre qui voit le jour en 1917. Illustré par le fidèle Segonzac, le recueil regroupe 18 poèmes français parsemés de vers anglais, italiens, allemands et néerlandais. Ces pages ne contiennent à vrai dire aucun renvoi à la conflagration en cours : « ce Chant de guerre a de particulier qu’il ne parle pas de la guerre », constate à juste titre un critique. Nombre d’images s’attardent sur la beauté de la nature et sur l’amour ; ce que l’ensemble recèle de guerrier, c’est en réalité un appel à s’engager dans une nouvelle ère, à ouvrir un monde où dieux et enfants émergeront revivifiés. En 1918, Vanderpyl va déclamer au moins une fois en public ce poème multilingue. Auparavant, en décembre 1914, il avait composé quatre strophes dans lesquelles le canon tonne bel et bien. Sans doute à l’initiative d’Ezra Pound, avec lequel l’éphémère légionnaire a sympathisé, elles paraissent en février 1916 dans le mensuel londonien The Egoist :
Parallèlement à l’achèvement de ce roman, Fritz travaille à Mon chant de guerre qui voit le jour en 1917. Illustré par le fidèle Segonzac, le recueil regroupe 18 poèmes français parsemés de vers anglais, italiens, allemands et néerlandais. Ces pages ne contiennent à vrai dire aucun renvoi à la conflagration en cours : « ce Chant de guerre a de particulier qu’il ne parle pas de la guerre », constate à juste titre un critique. Nombre d’images s’attardent sur la beauté de la nature et sur l’amour ; ce que l’ensemble recèle de guerrier, c’est en réalité un appel à s’engager dans une nouvelle ère, à ouvrir un monde où dieux et enfants émergeront revivifiés. En 1918, Vanderpyl va déclamer au moins une fois en public ce poème multilingue. Auparavant, en décembre 1914, il avait composé quatre strophes dans lesquelles le canon tonne bel et bien. Sans doute à l’initiative d’Ezra Pound, avec lequel l’éphémère légionnaire a sympathisé, elles paraissent en février 1916 dans le mensuel londonien The Egoist :
Il pèse sur la vie un poids de fer,
Il n’y a plus ni jour, ni nuit sur terre ;
Deux saisons ont passé et c’est l’hiver :
Mais qui a vu tomber la feuille à terre ?
Qui ose encor penser à sa douleur
Ou écouter le sombre bruit des heures ?
Nous avons tous un seul énorme cœur
Qui bat en vain aux cris de ceux qui meurent.
Les jardins sont déserts ; dans les maisons
Sanglote un être ancien quand le soir tombe.
Ces vieux qui s’en reviennent si las, ont
Depuis l’aube à peine claire, creusé des tombes.
Le canon tonne au loin ; sur l’horizon
S’évadent des lueurs dans la grisaille
Et silencieusement nous écoutons
Le sourd éloignement de la bataille.
Page de Mon chant de guerre illustrée par Dunoyer de Segonzac
Dans un poème postérieur, « Clair de lune », apparaît une autre évocation du conflit mondial : « Des gars de la guerre / voici les tombeaux ! un carré de chanvre / ou quelques bouleaux. // Et seule la lune / le soir à Verdun / pleurera sa larme / bleutée sur chacun. // Mais dans quelques siècles / l’homme saura-t-il / pourquoi cette terre / est aussi fertile ? » Dans un autre, intitulé « Rencontre » (publié dans Nord-Sud, août-septembre 1917, p. 13), Fritz met en scène « le soldat Vanderpyl » qu’une fille de Paris prend pour un marin. Quant au « Réveil nègre », il allude probablement aux tirailleurs sénégalais que l’auteur a vu défiler dans son quartier au début de la guerre : « (…) Brandissant leur masse à tête de serpent, / ils passent parmi les ruines / des Blancs. // Lourds comme l’obus / tombent les haros de leurs gosiers / dans les creux cerveaux. (…) »
Tuer le temps en attendant de se faire tuer ?
L’ami Segonzac, sergent
 Avant la fin du conflit, le poète va également donner quelques pages de critique picturale. À certains moments d’oisiveté, il se livre à l’une de ses occupations : envisager la création d’une revue. Ainsi projette-t-il de regrouper autour de sa personne, dans un périodique qui s’intitulerait La Vieille Revue – titre ô combien alléchant ! – les auteurs Georges Duhamel, Guy-Charles Cros, Paul Fort (1872-1960), mais aussi des plasticiens comme Sonia Lewitska, Othon Friesz (1879-1949), Tobeen (1880-1938) ou encore André Dunoyer de Segonzac… Peu après, autre idée, autre titre, autres collaborateurs en vue : La Chronique française… Et quelques jours plus tard : La Nouvelle chronique française ! En 1919, Vanderpyl se lancera dans un projet moins ambitieux en créant L’Arbitraire, revue qui ne connaîtra que deux numéros en raison d’un manque de fonds. Déjà pendant les hostilités, l’argent venait à manquer même si l’angliciste Hermine, grâce probablement à Albert Tirman, avait trouvé un nouvel emploi : « traductrice du San Francisco Examiner au ministère du Commerce et de l’Industrie ». Par la suite, le diariste écrira qu’en 1916 « ma femme et moi, nous nous trouvions près de la misère ». Certes, de la Hollande neutre parvenaient de temps en temps quelques centaines de francs paternels. Et, de San Francisco, des montants plus substantiels de l’ami Morris Herzstein (1869 ou 1870-1928), médecin réputé auquel Vanderpyl avait servi de guide à plusieurs reprises en Europe.
Avant la fin du conflit, le poète va également donner quelques pages de critique picturale. À certains moments d’oisiveté, il se livre à l’une de ses occupations : envisager la création d’une revue. Ainsi projette-t-il de regrouper autour de sa personne, dans un périodique qui s’intitulerait La Vieille Revue – titre ô combien alléchant ! – les auteurs Georges Duhamel, Guy-Charles Cros, Paul Fort (1872-1960), mais aussi des plasticiens comme Sonia Lewitska, Othon Friesz (1879-1949), Tobeen (1880-1938) ou encore André Dunoyer de Segonzac… Peu après, autre idée, autre titre, autres collaborateurs en vue : La Chronique française… Et quelques jours plus tard : La Nouvelle chronique française ! En 1919, Vanderpyl se lancera dans un projet moins ambitieux en créant L’Arbitraire, revue qui ne connaîtra que deux numéros en raison d’un manque de fonds. Déjà pendant les hostilités, l’argent venait à manquer même si l’angliciste Hermine, grâce probablement à Albert Tirman, avait trouvé un nouvel emploi : « traductrice du San Francisco Examiner au ministère du Commerce et de l’Industrie ». Par la suite, le diariste écrira qu’en 1916 « ma femme et moi, nous nous trouvions près de la misère ». Certes, de la Hollande neutre parvenaient de temps en temps quelques centaines de francs paternels. Et, de San Francisco, des montants plus substantiels de l’ami Morris Herzstein (1869 ou 1870-1928), médecin réputé auquel Vanderpyl avait servi de guide à plusieurs reprises en Europe.
Au cours de ces longs mois où des zeppelins survolent Paris, Fritz se demande parfois ce que deviennent les poètes et artistes italiens qu’il a côtoyés avant la guerre : Ardengo Soffici (1879-1964), Giovanni Papini (1881-1956), Leonetto Capiello (1875-1942), Fabius Lorenzi (1880-1964), Umberto Brunelleschi (1879-1949), Lionello Balestrieri (1872-1958), Umberto Boccioni (1882-1916), Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), Canudo… Lesquels ont été envoyés au front ? Il n’a aucune nouvelles d’eux.
Carte en allemand du prisonnier Cros aux Vanderpyl
Il en reçoit tout de même, bien entendu, de quelques copains : le prisonnier Cros auquel on expédie des colis, Aeschimann muté à la Légion à Lyon ou encore Segonzac qui, au sein d’une section de camouflage, fait surtout du jardinage dans un camp d’aviateur. Le mot que lui adresse Albert-Jean au cours de l’été 1915 lui a-t-il tiré un sourire ? « J’espère, mon vieux Vanderpyl, que cette carte te parviendra avant ton départ pour les tranchées. Tu vois que même à Brest, il y a des gars qui font les corvées de vivres. Donne-moi de temps en temps de tes nouvelles : elles ne m’intéressent pas, mais j’aime de recevoir des choses au courrier. Mes hommage à ta femme. À toi, malgré tout, bien cordialement. » Peut-être, histoire de chasser la morosité qui s’empare souvent de lui, s’est-il rendu, au cours des mêmes semaines, à une matinée de bienfaisance pour écouter l’une de ses belles-sœurs, la cantatrice Rose Elsie. Il a, quoi qu’il en soit, gardé une coupure de presse portant sur cette apparition en public de la pulpeuse chanteuse : « Mlle Rose Elsie a l’étoffe d’une grande artiste : sa belle voix de soprano dramatique, qu’elle conduit avec science, fait grande impression sur l’auditoire qui ne lui ménage pas les applaudissements et la rappelle plusieurs fois. » La cantatrice fera ses débuts à l’Opéra-Comique en 1923 avant de chanter plusieurs fois à la radio (TSF) dès l’année suivante !
Umberto Brunelleschi, l’un des amis italiens, vers 1905
 Comment passer le temps qui n’est pas consacré à l’écriture ? S’attarder, par exemple, dans l’atelier d’un plasticien. Peu de temps après sa naturalisation, Vanderpyl pose pour l’une de ses connaissances, Jean Dehoorn (1884-1937) – artiste et journaliste oublié de nos jours – puis pour son ami Jean H. Marchand, peintre qui s’apprête à exposer à Londres, ainsi que pour l’épouse de ce dernier, Sonia Lewitska, dont il place des œuvres chez des galeristes quand il n’en vend pas à des collectionneurs. En 1918, c’est pour Vlaminck qu’il posera. Début mars 1915, alors qu’Hermine est à son tour portraiturée par Marchand, le poète s’inquiète de savoir s’il va être bientôt rappelé, puis, le 15, il note : « On a retardé l’appel de la classe 1916. » Et le 28 : « On va rappeler tous les réformés. » À la mi-avril, alors qu’il mentionne que les peintres Jean Marchand et Jean Metzinger (1883-1956) sont appelés – il connaît ce dernier depuis une dizaine d’années et l’époque de l’Abbaye de Créteil –, il se fait de la bile au sujet de son propre sort : « On rappelle tous les hommes réformés n° 2 avant le 21/12 sous les drapeaux et tous ceux naturalisés depuis le commencement de la guerre. La loi est donc d’une part pour, d’autre part contre moi. J’ai peur de repartir dans cette levée en masse ; je le confesse humblement, je suis malade de peur. Pourtant, j’espère bien faire mon devoir. »
Comment passer le temps qui n’est pas consacré à l’écriture ? S’attarder, par exemple, dans l’atelier d’un plasticien. Peu de temps après sa naturalisation, Vanderpyl pose pour l’une de ses connaissances, Jean Dehoorn (1884-1937) – artiste et journaliste oublié de nos jours – puis pour son ami Jean H. Marchand, peintre qui s’apprête à exposer à Londres, ainsi que pour l’épouse de ce dernier, Sonia Lewitska, dont il place des œuvres chez des galeristes quand il n’en vend pas à des collectionneurs. En 1918, c’est pour Vlaminck qu’il posera. Début mars 1915, alors qu’Hermine est à son tour portraiturée par Marchand, le poète s’inquiète de savoir s’il va être bientôt rappelé, puis, le 15, il note : « On a retardé l’appel de la classe 1916. » Et le 28 : « On va rappeler tous les réformés. » À la mi-avril, alors qu’il mentionne que les peintres Jean Marchand et Jean Metzinger (1883-1956) sont appelés – il connaît ce dernier depuis une dizaine d’années et l’époque de l’Abbaye de Créteil –, il se fait de la bile au sujet de son propre sort : « On rappelle tous les hommes réformés n° 2 avant le 21/12 sous les drapeaux et tous ceux naturalisés depuis le commencement de la guerre. La loi est donc d’une part pour, d’autre part contre moi. J’ai peur de repartir dans cette levée en masse ; je le confesse humblement, je suis malade de peur. Pourtant, j’espère bien faire mon devoir. »
Ce n’est pas la dernière fois que Fritz sera tiraillé entre le désir de servir sa nouvelle patrie et la hantise de mourir au combat. Comme nombre d’êtres humains, il est bourré de paradoxes. Mais pour sa part à un degré extrême. Une semaine plus tard, redoutant que la guerre dure encore plusieurs années, il en appelle à Dieu pour ne pas succomber au désespoir : « Il paraît qu’on prend tout le monde comme soldat de l’active : les trop gros, les trop minces, les obèses, les poitrinaires et les tuberculeux, les intellectuels et ceux qui pourraient se rendre utiles dans les usines où l’on fabrique de la mitraille, etc. […] J’aimerais avoir les moyens de me suicider. Et je crois que des milliers d’autres hommes que moi sentent les mêmes choses et… se taisent. » L’inquiétude persiste : « Malaise et tristesse générale. Je ne fous rien… quand vais-je être rappelé ? » Il s’emporte contre les journaux, trouvant scandaleux que la presse glorifie pour ainsi dire un Français qui a tué sa femme allemande, même si lui-même reconnaît qu’il aurait été tenté de trucider sa « bocheuse », à supposer qu’il en ait épousé une. Son hypersensibilité lui joue des tours : « Je pleure à présent partout : un enterrement, la musique quotidienne au Luxembourg (concerts rouges), une Pauline qui ramène des convalescents soldats de la campagne, des petites filles qui sautent à la corde et des conscrits qui passent en chantant ! » Malgré son pessimisme, il parvient certains jours à s’exprimer avec moins de gravité : « On rapatrie les Italiens vivant en France. Ce n’est pas pour me déplaire. […] C’est dommage que Jean Moréas soit mort, on aurait pu l’envoyer chez les Grecs pour les faire marcher comme on devrait m’envoyer, moi, aux Pays-Bas. J’imagine une Hollande augmentée des provinces flamandes belges gouvernées constitutionnellement par le présent roy des Belges, Bruxelles ville libre et la Wallonie aux Français. »
Les époux Vanderpyl, 27 août 1916
 Ce n’est pas la relation qu’il entretient avec sa conjointe qui l’encourage à voir la vie un peu en rose : « Hermine ne m’aime pas, écrit-il alors qu’elle vient de rentrer d’un séjour dans le Midi. Elle me sent seulement moins facile à démolir qu’un autre. […] À mort Vanderpyl ! » Peu après, entre eux, voilà qu’il est de nouveau question de divorce : sa femme est déterminée à le quitter, sans pour autant compliquer les choses administrativement et en envisageant de donner le préavis de manière à libérer le logement début 1916. Elle vouvoie son mari : « Il est définitivement prouvé que nous ne pouvons nous entendre et que la vie commune est impossible : je serai toujours l’institutrice et vous le génie, je serai toujours née dans le Midi et aurai toujours les mêmes défauts. […] Je vous ai fait faire une faute en prenant un loyer très élevé et un train de vie qui même depuis la guerre ne fait qu’augmenter chaque jour et est arrivé à ses summums que je ne pouvais pas prévoir dès le début. » Elle est lasse de devoir emprunter de l’argent à droite et à gauche. Se séparer et trouver deux nouveaux petits logements, poursuit-elle, « peut se faire sans bruit et sans cris ; nous nous entendrons sûrement bien quand nous ne serons plus forcés de nous supporter mutuellement sans répit. C’est là tout ce que j’ai à vous dire ». À la mi-août 1915, on sent que le poète a le courage au fond des chaussettes. Alors que la loi Dalbiez vient d’être votée – laquelle redéfinit la place, la répartition et l’utilisation des mobilisés et des mobilisables dans les armées –, il confie à son Journal : « Je passe un nouveau conseil de révision. Dire qu’un vague méridional comme ce Dalbiez peut m’envoyer, moi, comme chair à canon dans les tranchées tandis que lui, fort de ses droits parlementaires, reste embusqué à la Chambre… Les parties ne sont pas égales. Je ne puis faire un soldat, obèse, néphritique à 39 ans. » Dix jours plus tard : « J’attends tous les jours mon appel pour aller au conseil d’aptitude relative. » Le 31 août, il adresse la lettre suivante à une vague connaissance :
Ce n’est pas la relation qu’il entretient avec sa conjointe qui l’encourage à voir la vie un peu en rose : « Hermine ne m’aime pas, écrit-il alors qu’elle vient de rentrer d’un séjour dans le Midi. Elle me sent seulement moins facile à démolir qu’un autre. […] À mort Vanderpyl ! » Peu après, entre eux, voilà qu’il est de nouveau question de divorce : sa femme est déterminée à le quitter, sans pour autant compliquer les choses administrativement et en envisageant de donner le préavis de manière à libérer le logement début 1916. Elle vouvoie son mari : « Il est définitivement prouvé que nous ne pouvons nous entendre et que la vie commune est impossible : je serai toujours l’institutrice et vous le génie, je serai toujours née dans le Midi et aurai toujours les mêmes défauts. […] Je vous ai fait faire une faute en prenant un loyer très élevé et un train de vie qui même depuis la guerre ne fait qu’augmenter chaque jour et est arrivé à ses summums que je ne pouvais pas prévoir dès le début. » Elle est lasse de devoir emprunter de l’argent à droite et à gauche. Se séparer et trouver deux nouveaux petits logements, poursuit-elle, « peut se faire sans bruit et sans cris ; nous nous entendrons sûrement bien quand nous ne serons plus forcés de nous supporter mutuellement sans répit. C’est là tout ce que j’ai à vous dire ». À la mi-août 1915, on sent que le poète a le courage au fond des chaussettes. Alors que la loi Dalbiez vient d’être votée – laquelle redéfinit la place, la répartition et l’utilisation des mobilisés et des mobilisables dans les armées –, il confie à son Journal : « Je passe un nouveau conseil de révision. Dire qu’un vague méridional comme ce Dalbiez peut m’envoyer, moi, comme chair à canon dans les tranchées tandis que lui, fort de ses droits parlementaires, reste embusqué à la Chambre… Les parties ne sont pas égales. Je ne puis faire un soldat, obèse, néphritique à 39 ans. » Dix jours plus tard : « J’attends tous les jours mon appel pour aller au conseil d’aptitude relative. » Le 31 août, il adresse la lettre suivante à une vague connaissance :
Monsieur, Je suis d’origine hollandaise, naturalisé depuis le mois de janvier 1915, né en 1876.
Engagé volontaire du commencement de septembre 1914 (après avoir été ajourné à la fin d’août), on m’a réformé (n° 2) le 9 janvier à l’hôpital Béguin. Auriez-vous l’obligeance, Monsieur, de me dire si je suis visé par la loi Dalbiez et en ce cas où et à quelle date je dois me présenter. Je vous serais extrêmement reconnaissant de ce renseignement qui m’évitera de courir de bureau à bureau.
D’autre part, je sais en plus du français, l’anglais, l’allemand, le hollandais et le flamand. Ayant ouï dire qu’on cherche des traducteurs pour ces 2 dernières langues, savez-vous quel serait le moyen d’être repris utilement dans les services ?
Page du Journal de Fritz, fête chez les Brunelleschi peu avant la guerre, avec D’Annunzio, etc.
 Dans son esprit, l’idée de faire office de traducteur au sein de l’armée fait de plus en plus son chemin. Bientôt, son correspondant rassure le polyglotte : « Monsieur, normalement, vous auriez dû être inscrit sur le tableau de recensement de la classe 1916, mais votre réforme comme engagé ne vous astreint pas à passer la visite de la loi Dalbiez. » Fritz recopie dans son Journal des articles de loi de naturalisation de sujets étrangers en France. Puis note le 19 septembre : « J’attends encore toujours mon appel pour paraître devant le conseil de réforme du IIIe bureau de recrutement : sera-ce demain, après demain ? […] » Le 6 octobre : « J’attends tous les jours ma feuille de convocation devant le conseil de réforme. » Le 13 : « Ça va mal. J’attends toujours mon appel. » Le 17 : « Pas de réponse encore du bureau de recrutement et voilà un mois que la loi Dalbiez est en plein fonctionnement. » Le 18 : « J’attends toujours mon appel ?! » Le stress l’incite à rédiger un nouveau testament : « Ce 19 octobre, craignant d’être sous peu incorporé dans l’armée d’active, malgré mon âge, mon poids, mes tares et mon métier purement intellectuel, moi, Fritz René Remy Vanderpyl, déclare ma femme seule héritière de tout ce qui peut m’appartenir au moment de ma mort, y compris les droits d’auteur que pourraient rapporter mes œuvres en des jours meilleurs. Comme Guy-Charles Cros est prisonnier et Frits van Hennekeler aux Indes, je nomme Frits Buekers, d’Utrecht, Jean Robaglia, de Paris et Jean Marchand, peintre, 73 rue de Caulaincourt, mes exécuteurs littéraires. » Et de poursuivre, à propos de son Journal, qu’on le détruise après en avoir extrait des fragments publiables, sauf si Hermine veut le conserver jusqu’à sa mort : « En aucun cas, je n’admets la parution de mon Journal qui n’a pas été fait pour cela : c’est en tout et pour tout un gros carnet de notes à brûler. Je demande pardon à tous ceux que j’ai insultés. Je demande pardon à la Langue française de si mal l’écrire. […] Si Jean Augé, fils de Rose Augé, le désire, je serai heureux de lui donner mon nom de famille : il s’appellera alors Jean Augé Vanderpyl. J’espère qu’il ne deviendra pas acteur. » Le 15 novembre : « Toujours rien de mon bureau de recrutement. Dois-je attendre ? Tout le monde me dit que je n’ai que ça à faire. Attendons donc. » Et le 30 : « Galliéni propose une re-révision des réformés. Vais-je y passer cette fois-ci ? »
Dans son esprit, l’idée de faire office de traducteur au sein de l’armée fait de plus en plus son chemin. Bientôt, son correspondant rassure le polyglotte : « Monsieur, normalement, vous auriez dû être inscrit sur le tableau de recensement de la classe 1916, mais votre réforme comme engagé ne vous astreint pas à passer la visite de la loi Dalbiez. » Fritz recopie dans son Journal des articles de loi de naturalisation de sujets étrangers en France. Puis note le 19 septembre : « J’attends encore toujours mon appel pour paraître devant le conseil de réforme du IIIe bureau de recrutement : sera-ce demain, après demain ? […] » Le 6 octobre : « J’attends tous les jours ma feuille de convocation devant le conseil de réforme. » Le 13 : « Ça va mal. J’attends toujours mon appel. » Le 17 : « Pas de réponse encore du bureau de recrutement et voilà un mois que la loi Dalbiez est en plein fonctionnement. » Le 18 : « J’attends toujours mon appel ?! » Le stress l’incite à rédiger un nouveau testament : « Ce 19 octobre, craignant d’être sous peu incorporé dans l’armée d’active, malgré mon âge, mon poids, mes tares et mon métier purement intellectuel, moi, Fritz René Remy Vanderpyl, déclare ma femme seule héritière de tout ce qui peut m’appartenir au moment de ma mort, y compris les droits d’auteur que pourraient rapporter mes œuvres en des jours meilleurs. Comme Guy-Charles Cros est prisonnier et Frits van Hennekeler aux Indes, je nomme Frits Buekers, d’Utrecht, Jean Robaglia, de Paris et Jean Marchand, peintre, 73 rue de Caulaincourt, mes exécuteurs littéraires. » Et de poursuivre, à propos de son Journal, qu’on le détruise après en avoir extrait des fragments publiables, sauf si Hermine veut le conserver jusqu’à sa mort : « En aucun cas, je n’admets la parution de mon Journal qui n’a pas été fait pour cela : c’est en tout et pour tout un gros carnet de notes à brûler. Je demande pardon à tous ceux que j’ai insultés. Je demande pardon à la Langue française de si mal l’écrire. […] Si Jean Augé, fils de Rose Augé, le désire, je serai heureux de lui donner mon nom de famille : il s’appellera alors Jean Augé Vanderpyl. J’espère qu’il ne deviendra pas acteur. » Le 15 novembre : « Toujours rien de mon bureau de recrutement. Dois-je attendre ? Tout le monde me dit que je n’ai que ça à faire. Attendons donc. » Et le 30 : « Galliéni propose une re-révision des réformés. Vais-je y passer cette fois-ci ? »
L’hebdomadaire libertaire Les Hommes du Jour, dirigé par Victor Méric (source : Gallica)
En décembre, par l’intermédiaire d’un officier, ami d’un ami, il essaie d’entrer au bureau de la presse (traductions) du ministère de la Guerre. Fin de l’année 1915 : « Il paraît que le ministre de la Guerre a renvoyé tous les naturalisés de son bureau ! C’est gai… ah ! les vieux dreyfusards comme Urbain Gohier, Hervé, Donnay, France, etc. etc. se vengent de l’avoir été… et les étrangers stupides paient cher de les avoir admirés ! Mais on pourrait m’employer, moi ! Je n’ai jamais été dreyfusard, ni en Hollande, ni ici. C’était même le seul trait intelligent de mon rédacteur en chef Van Marle d’avoir été (du moins de mon temps) antidreyfusard au Dagblad van Z.-H. en ’Gravenhage… seul avec moi. » Fritz évoque ici un quotidien de La Haye auquel il a donné des chroniques en 1898-1899 avant de s’établir à Paris.
La France, 11 mai 1916
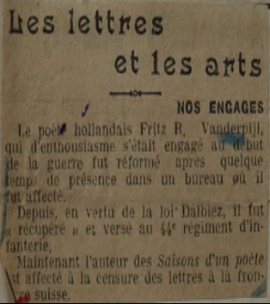 Le 31 décembre, alors qu’Hermine se rend aux obsèques d’une parente décédée à l’âge de vingt-et-un ans : « J’ai été au bureau de recrutement. J’essaie de m’engager au bureau de la presse (section étrangère) où l’on a besoin de moi. Si cela ne réussit pas maintenant que je me suis déclaré prêt à faire tout mon devoir, malgré ‘‘leurs’’ oublis et leurs hésitations, on m’enverra probably dans les tranchées avec une baïonnette et ma lâcheté légendaire. Je le saurai, j’espère, lundi matin ! » Il arrive souvent à Vanderpyl de reconnaître son manque de courage. Ainsi, bien plus tard, un jour où Hermine est malade, il écrit dans une lettre à des proches : « Moi, soldat de IIe classe, là devant elle, je me sens tout petit poète qui ne supporterait pas un centième de ses souffrances, sans formidables gueuleries ! » Début janvier 1916, le naturalisé apprend : « Je suis versé dans la classe 1917 !!!!!! Cela promet. […] Ma femme fait des démarches pour connaître au juste ma situation militaire. » Tant bien que mal, le couple a fini par se rabibocher. Lui s’impatiente, il n’a pas encore reçu sa convocation pour un conseil de réforme : « Je m’emmerde et suis affreusement nerveux. Entre-temps, le travail du Bureau de la Presse s’accumule à la section hollandaise et je ne puis rendre aucun service parce que l’ad-mi-nis-tra-tion juge cela arbitraire !!! » Sans doute sait-il cela par le traducteur Paul Eyquem (1875-1940) – rattaché à partir de cette année 1915 au Bureau de l’Information du ministère français des Affaires étrangères. Fritz a approché cet amoureux de la Hollande – qui va d’ailleurs servir dans ce pays en plein conflit comme interprète de l’armée française et représentant du service de presse du gouvernement français –, mais cet interlocuteur ne peut guère l’aider. Enfin, le 17 janvier 1916, au bout d’un an d’« oisiveté » : « Je reçois ma feuille de route et suis envoyé avec la Classe 17 dans la garnison du Jura : Lons-le-Saulnier, sans contre-visite, sans préalable avis : Bien ! Quel charmant et bienveillant traitement… Qu’est-ce qui m’attend là-bas ? Je n’en sais rien, mais je n’ai pas trop peur aujourd’hui. »
Le 31 décembre, alors qu’Hermine se rend aux obsèques d’une parente décédée à l’âge de vingt-et-un ans : « J’ai été au bureau de recrutement. J’essaie de m’engager au bureau de la presse (section étrangère) où l’on a besoin de moi. Si cela ne réussit pas maintenant que je me suis déclaré prêt à faire tout mon devoir, malgré ‘‘leurs’’ oublis et leurs hésitations, on m’enverra probably dans les tranchées avec une baïonnette et ma lâcheté légendaire. Je le saurai, j’espère, lundi matin ! » Il arrive souvent à Vanderpyl de reconnaître son manque de courage. Ainsi, bien plus tard, un jour où Hermine est malade, il écrit dans une lettre à des proches : « Moi, soldat de IIe classe, là devant elle, je me sens tout petit poète qui ne supporterait pas un centième de ses souffrances, sans formidables gueuleries ! » Début janvier 1916, le naturalisé apprend : « Je suis versé dans la classe 1917 !!!!!! Cela promet. […] Ma femme fait des démarches pour connaître au juste ma situation militaire. » Tant bien que mal, le couple a fini par se rabibocher. Lui s’impatiente, il n’a pas encore reçu sa convocation pour un conseil de réforme : « Je m’emmerde et suis affreusement nerveux. Entre-temps, le travail du Bureau de la Presse s’accumule à la section hollandaise et je ne puis rendre aucun service parce que l’ad-mi-nis-tra-tion juge cela arbitraire !!! » Sans doute sait-il cela par le traducteur Paul Eyquem (1875-1940) – rattaché à partir de cette année 1915 au Bureau de l’Information du ministère français des Affaires étrangères. Fritz a approché cet amoureux de la Hollande – qui va d’ailleurs servir dans ce pays en plein conflit comme interprète de l’armée française et représentant du service de presse du gouvernement français –, mais cet interlocuteur ne peut guère l’aider. Enfin, le 17 janvier 1916, au bout d’un an d’« oisiveté » : « Je reçois ma feuille de route et suis envoyé avec la Classe 17 dans la garnison du Jura : Lons-le-Saulnier, sans contre-visite, sans préalable avis : Bien ! Quel charmant et bienveillant traitement… Qu’est-ce qui m’attend là-bas ? Je n’en sais rien, mais je n’ai pas trop peur aujourd’hui. »
La caserne où est affecté Vanderpyl début 1916
Deuxième classe dans les services de la censure et de la propagande
Une coupure de La France du 11 mai 1916 nous apprend : « Le poète hollandais Fritz R. Vanderpijl qui, d’enthousiasme, s’était engagé au début de la guerre, fut réformé après quelque temps de présence dans un bureau où il fut affecté. Depuis, en vertu de la loi Dalbiez, il fut ‘‘récupéré’’ et versé au 44e Régiment d’infanterie. Maintenant, l’auteur des Saisons d’un poète est affecté à la censure des lettres à la frontière suisse. » Du 18 janvier au 20 avril 1916, Vanderpyl a semble-t-il servi au sein de l’unité militaire en question, à Lons-le-Saulnier, principalement dans les bureaux en charge de la censure ; puis il a été affecté au contrôle postal à Pontarlier où, ainsi qu’il l’indique dans une lettre adressée à Hermine le 6 août 1943 – alors qu’il est pour la première fois de retour dans le Doubs, en l’occurrence auprès de son ami le peintre Pierre Jouffroy –, il va faire quatre jours de trou. L’ancien deuxième classe revient sur cet épisode dans ses Mémoires : « Je ne m’attarderai pas aux casernes et aux endroits de ‘‘l’arrière’’ où, de la part des gradés, petits et grands, régnait l’unanime et sinistre entêtement dans l’application de règlements désuets que l’énorme tragédie du front n’avait pu entamer. On m’infligea quatre jours de prison pour avoir voulu expliquer à un commandant qu’avec les quatre langues que je parlais presque couramment, je pouvais me rendre plus utile qu’en restant un vague scribe aux ordres d’un adjudant. » Croqués dans cette sous-préfecture, deux portraits au crayon figurant Fritz sont conservés dans son Journal (ci-dessous).
Vanderpyl, portrait non signé
 Le lubrique naturalisé a d’ailleurs gardé quelques délicieux souvenirs de ces contrées : « John Ruskin et, avant lui, Stendhal (voir ses lettres) font un cas exceptionnel de ce petit endroit dans le Jura appelé Champagnole, endroit où naquit Alice Vuillemain, aujourd’hui Mme J. Riethmann, une des femmes les plus excitantes et les plus complètement femme d’amour que j’ai connues. J’y ai passé en 1916 et soupé, en me rendant au 44e d’Infanterie à Lons-le-Saulnier où les fillettes étaient plus chaudes encore qu’en Bretagne. » C’est sans doute cette Alice (1900 ou 1903-1990) que Fritz retrouvera plus tard à Paris, mais aussi à Montbéliard, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 28 juin 1943, il écrit à son ami le peintre Pierre Jouffroy : « Voici un mot confidentiel pour vous personnellement qui sera suivi d’une réponse à votre lettre du 24/6. Je vous avais parlé de ma promesse à une amie (la charmante amie que vous connaissez) et qui part en vacances chez ses parents à Champagnole, de l’amener pour deux, trois jours à Montbéliard. Je ne vous gênerai d’aucune façon ; elle encore moins. Je vous prie de retenir une chambre pour elle à l’hôtel dont vous m’avez parlé. Je prendrai quelques repas avec elle et rien de choquant ou de compromettant ne se passera, même aux yeux les plus orthodoxes de vos compatriotes. Je préfèrerais prendre deux chambres et, après le départ de la demoiselle, accepter votre hospitalité, comme si j’étais arrivé à l’improviste. Cette dame séjournera très peu de temps en votre jolie petite ville. »
Le lubrique naturalisé a d’ailleurs gardé quelques délicieux souvenirs de ces contrées : « John Ruskin et, avant lui, Stendhal (voir ses lettres) font un cas exceptionnel de ce petit endroit dans le Jura appelé Champagnole, endroit où naquit Alice Vuillemain, aujourd’hui Mme J. Riethmann, une des femmes les plus excitantes et les plus complètement femme d’amour que j’ai connues. J’y ai passé en 1916 et soupé, en me rendant au 44e d’Infanterie à Lons-le-Saulnier où les fillettes étaient plus chaudes encore qu’en Bretagne. » C’est sans doute cette Alice (1900 ou 1903-1990) que Fritz retrouvera plus tard à Paris, mais aussi à Montbéliard, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 28 juin 1943, il écrit à son ami le peintre Pierre Jouffroy : « Voici un mot confidentiel pour vous personnellement qui sera suivi d’une réponse à votre lettre du 24/6. Je vous avais parlé de ma promesse à une amie (la charmante amie que vous connaissez) et qui part en vacances chez ses parents à Champagnole, de l’amener pour deux, trois jours à Montbéliard. Je ne vous gênerai d’aucune façon ; elle encore moins. Je vous prie de retenir une chambre pour elle à l’hôtel dont vous m’avez parlé. Je prendrai quelques repas avec elle et rien de choquant ou de compromettant ne se passera, même aux yeux les plus orthodoxes de vos compatriotes. Je préfèrerais prendre deux chambres et, après le départ de la demoiselle, accepter votre hospitalité, comme si j’étais arrivé à l’improviste. Cette dame séjournera très peu de temps en votre jolie petite ville. »
Cette parenthèse dans l’Est durant la Grande Guerre a d’autre part laissé une petite trace dans l’œuvre du poète. Dans son numéro de mars 1917, la revue Le Double bouquet, placée sous le patronage d’André Germain, publie en effet une courte prose poétique intitulée « Printemps jurassien ». Des lignes en forme d’impressions picturales :
Près du hameau aux toits rouges, il y a un petit ruisseau ; un amandier en fleurs s’y reflète ; le gazon est doré de renoncules.
Les collines du fond sont découpées en carrés rouges, bruns et olivâtres ; de loin on distingue des semeuses.
Les peupliers de la route, sous des voilages verts, s’effacent sur un ciel où voguent d’immenses plumes blanches. Trois fillettes vont à l’école ; elles chantent : Il faut te marier, / papillon couleur de neige, / il faut te marier /par devant le vieux mûrier…
… et un papillon passe.
Une flèche baroque orne l’horizon.
Coupure sur la nouvelle affectation du « critique d’art », juin 1916
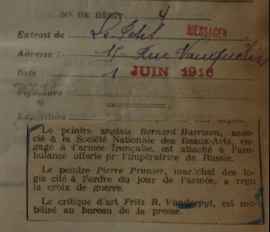 Malheureusement, à partir de cette période jurassienne et doubiste, le diariste ne nous renseigne pour ainsi dire plus sur son quotidien. En 1920, il va suivre le conseil de son ami Guy-Charles Cros : « Cros insiste pour que je recommence à tenir un journal. J’avais abandonné cette besogne depuis mon départ à Lons-le-Saulnier en janvier 1916. » En attendant, les cahiers conservés ne relatent pas, par exemple, les visites que Fritz va rendre à Apollinaire à l’hôpital, à la suite de la trépanation qu’a subie ce dernier. Ils ne nous apprennent rien non plus sur les activités de ces deux poètes au sein de la Maison de la Presse où ils vont être affectés, Fritz en juin 1916, Guillaume un an plus tard. Qu’est-ce au juste, d’ailleurs, que cet organisme qui a pour mission d’exercer une forme de censure ainsi que de la propagande en temps de guerre ? Le récent article « Presse, censure et propagande en 1914-1918 : la construction d’une culture de guerre » nous en donne une idée : « L’année 1915 voit la création du premier organisme semi-officiel, l’Office de propagande, puis, sous l’impulsion du gouvernement français, davantage conscient de l’importance de la propagande en temps de guerre, la mise en place d’une organisation coordonnatrice des services existants (privés comme gouvernementaux) : la Maison de la Presse. Cette dernière rassemble tant des journalistes, des écrivains que des universitaires et se divise en quatre sections. La première, diplomatique, se subdivise elle-même en quatre bureaux (service de réception des journalistes français et étrangers, service téléphonique et télégraphique, bureau d’étude et service des enquêtes de presse chargé de rédiger des télégrammes qui sont diffusés partout dans le monde. La deuxième section, militaire, qui remplit un rôle à peu près similaire, reçoit du GQG les informations militaires susceptibles d’être fournies à la presse pour publication et se charge d’organiser les visites des journalistes sur le front. Elle est complétée par la Section photographique et cinématographique de l’armée (SCPA), créée auparavant, qui permet la diffusion dans le monde entier des images prises à l’arrière, puis sur le front. La troisième section de ce bureau, celle de propagande, se divise selon les zones géographiques à toucher et diffuse le matériel propagandiste (livres, tracts, affiches, brochures, articles). Elle met entre autres en circulation, chez les Alliés et les neutres, les journaux de tranchées confectionnés par les soldats sur le front, dans le but avoué de donner une ‘‘fière idée du moral français’’. La dernière section, de traduction et d’analyse de la presse étrangère [celle où officie Vanderpyl, DC], fournit quant à elle, grâce au dépouillement d’environ quatre cents journaux provenant d’Europe, d’Asie et d’Amérique, la ‘‘matière documentaire’’ aux sections précédentes. Cette organisation complexe, qui offre aux journalistes des conditions de travail modernes et efficaces, ainsi que la coordination entre les différents services, permet alors de transformer finalement ce qui était au départ une information en une belle substance propagandiste. En mars 1917, la Maison de la Presse connaît ses premiers changements ; les services sont alors regroupés en deux sections : la branche de l’information et celle de la propagande. Son activité reste efficace, drainant, en décembre de la même année, la majorité des communiqués officiels lancés du Quartier général. En mai 1918, le tout nouveau Commissariat général à l’Information et à la Propagande lui succède, préservant toutefois ses principaux modes de fonctionnement. »
Malheureusement, à partir de cette période jurassienne et doubiste, le diariste ne nous renseigne pour ainsi dire plus sur son quotidien. En 1920, il va suivre le conseil de son ami Guy-Charles Cros : « Cros insiste pour que je recommence à tenir un journal. J’avais abandonné cette besogne depuis mon départ à Lons-le-Saulnier en janvier 1916. » En attendant, les cahiers conservés ne relatent pas, par exemple, les visites que Fritz va rendre à Apollinaire à l’hôpital, à la suite de la trépanation qu’a subie ce dernier. Ils ne nous apprennent rien non plus sur les activités de ces deux poètes au sein de la Maison de la Presse où ils vont être affectés, Fritz en juin 1916, Guillaume un an plus tard. Qu’est-ce au juste, d’ailleurs, que cet organisme qui a pour mission d’exercer une forme de censure ainsi que de la propagande en temps de guerre ? Le récent article « Presse, censure et propagande en 1914-1918 : la construction d’une culture de guerre » nous en donne une idée : « L’année 1915 voit la création du premier organisme semi-officiel, l’Office de propagande, puis, sous l’impulsion du gouvernement français, davantage conscient de l’importance de la propagande en temps de guerre, la mise en place d’une organisation coordonnatrice des services existants (privés comme gouvernementaux) : la Maison de la Presse. Cette dernière rassemble tant des journalistes, des écrivains que des universitaires et se divise en quatre sections. La première, diplomatique, se subdivise elle-même en quatre bureaux (service de réception des journalistes français et étrangers, service téléphonique et télégraphique, bureau d’étude et service des enquêtes de presse chargé de rédiger des télégrammes qui sont diffusés partout dans le monde. La deuxième section, militaire, qui remplit un rôle à peu près similaire, reçoit du GQG les informations militaires susceptibles d’être fournies à la presse pour publication et se charge d’organiser les visites des journalistes sur le front. Elle est complétée par la Section photographique et cinématographique de l’armée (SCPA), créée auparavant, qui permet la diffusion dans le monde entier des images prises à l’arrière, puis sur le front. La troisième section de ce bureau, celle de propagande, se divise selon les zones géographiques à toucher et diffuse le matériel propagandiste (livres, tracts, affiches, brochures, articles). Elle met entre autres en circulation, chez les Alliés et les neutres, les journaux de tranchées confectionnés par les soldats sur le front, dans le but avoué de donner une ‘‘fière idée du moral français’’. La dernière section, de traduction et d’analyse de la presse étrangère [celle où officie Vanderpyl, DC], fournit quant à elle, grâce au dépouillement d’environ quatre cents journaux provenant d’Europe, d’Asie et d’Amérique, la ‘‘matière documentaire’’ aux sections précédentes. Cette organisation complexe, qui offre aux journalistes des conditions de travail modernes et efficaces, ainsi que la coordination entre les différents services, permet alors de transformer finalement ce qui était au départ une information en une belle substance propagandiste. En mars 1917, la Maison de la Presse connaît ses premiers changements ; les services sont alors regroupés en deux sections : la branche de l’information et celle de la propagande. Son activité reste efficace, drainant, en décembre de la même année, la majorité des communiqués officiels lancés du Quartier général. En mai 1918, le tout nouveau Commissariat général à l’Information et à la Propagande lui succède, préservant toutefois ses principaux modes de fonctionnement. »
Eugène Montfort, directeur de la revue Les Marges, voisin de Fritz à la Maison de la Presse
Au moins, les Mémoires de Vanderpyl nous fournissent-ils quelques éléments sur sa nouvelle affectation et sur le quotidien, certes peu enthousiasmant, qu’il mène à la Maison de la Presse, sise 3, rue François-Ier. L’écrivain est admis dans cet organisme après son retour à Paris, ceci, nous explique-t-il, grâce à son obésité : « Mon ventre me sauva de la tranchée. » Le journal L’Intransigeant du 1er juin 1916 l’annonce : « M. Fritz Vanderpyl est au service de la propagande. » Autre coupure, de la même date : « Le critique d’art Fritz R. Vanderpyl est mobilisé au bureau de la presse. » Il y passera le reste de la guerre. Chargé de travaux « dans le secteur des traducteurs de langues étrangères du ‘‘IIe Bureau’’ […] – précise-t-il dans son Mémorial sans dates en restituant l’atmosphère qui régnait autour de lui –, j’étais le seul à n’être ni agrégé, ni licencié, ni même bachelier. […] Me voici donc, moi et mon ignorance, devant la fine fleur du professorat. Inquiet de nature, apercevant irrémédiablement les dangers même imaginaires que courent ceux que j’aime et moi-même, ne montant jamais dans un train sans me rendre compte du peu de malchance qu’il faudrait pour que je sois réduit en bouillie, je me sentais, dans ce qu’on avait baptisé ‘‘La Maison de la Presse’’, comme un tout petit garçon en classe. Et je retrouvais mes inquiétudes d’enfant. » Cette composition élitiste de l’administration en question est confirmée par un attaché à l’ambassade d’Italie à Paris : « Le personnel d’étude est composé d’officiers blessés, d’interprètes et d’hommes de troupe du service auxiliaire ; les deux tiers sont membres de l’enseignement supérieur ou secondaire. Pour le recrutement de ce personnel, le chef de bureau s’adresse à l’École normale supérieure qui lui indique ses anciens élèves blessés ; la direction de l’infanterie les met ensuite à la disposition du bureau pour une période de deux, trois mois (renouvelables), à moins qu’ils soient déclarés définitivement impropres à faire campagne, auquel cas ils sont attachés définitivement au bureau. » Dans ces locaux où ses collègues ne vont pas tarder à goûter à ses sautes d’humeur, le poète rencontre un autre Hollandais naturalisé, l’ancien anarchiste Alexandre Cohen (1864-1961). Jusqu’en décembre 1917, ce journaliste sera le correspondant en France du quotidien néerlandais le plus important de l’époque, le pro-français De Telegraaf, avant d’en rester le collaborateur pendant quelques années de plus. Dans ses mémoires intitulés Van anarchist tot monarchist (D’anarchiste à monarchiste, 1936), cet ancien rebelle, l’un des condamnés du fameux Procès des Trente, se rappelle, non sans glisser une ou deux imprécisions : « Peu après mon retour de Hollande, j’ai obtenu un emploi à la Maison de la Presse où, environ un mois plus tôt, j’avais fait connaissance avec mes prédécesseurs dont le Haguenois Frits van der Pijl, poète, romancier et gastronome qui, résidant depuis des années en France, s’était engagé dans l’armée française dès la déclaration de la guerre – non pas animé par une ardeur guerrière débridée, mais, plus beau que ça ! par conscience de ses devoirs à l’égard de sa patrie d’adoption. » Le Juif frison et l’antisémite haguenois vont nouer des liens d’amitié ainsi que le prouvent deux lettres de 1926 et 1927 conservées dans les archives du second. Mais ces missives, rédigées en français par le premier, montrent aussi que le contact entre ces deux forts tempéraments, enclins à s’échauffer pour la moindre peccadille, n’a pas été sans produire maintes étincelles.
Lettre d’A. Cohen à Vanderpyl, 26 décembre 1926
Dans son Mémorial sans dates, Vanderpyl poursuit l’évocation de ses nouveaux bureaux. Des lignes qui confirment, s’il le fallait, sa faculté à se fâcher avec autrui et qui ne témoignent guère d’un réel acharnement au travail : « Considéré aussitôt presque après mon entrée, d’une inutilité absolue, je me tins coi. Il n’y avait d’ailleurs pas de papa pour me punir à la maison de mes mauvaises notes. Je me mis à écrire pour moi. Et on me laissait faire. Quand mes collègues allaient un peu trop fort dans leur manière toute jésuitique de me narguer, je leur jetais à la face ce que je prenais pour des idées anti-sorbonniennes. Par exemple : ‘‘Voltaire n’est que le Boileau du XVIIIe siècle’’, ou : ‘‘Le grand destructeur de nos cathédrales, c’est Descartes’’, ou encore : ‘‘Il n’existe pas de grandes nations européennes qui ne soient nées d’un chantage au mariage et à l’héritage ou de manœuvres de capitalistes américains : Dieu n’a créé ni l’Angleterre, ni la Russie, ni l’Allemagne, ni l’Autriche (par prudence, je n’ajoutais pas la France à la série), mais l’Écosse, la Provence, la Bavière, les Flandres, la Hongrie, l’Ukraine, la Bretagne, le Pays de Galles, l’Alsace, l’Irlande, la Bohème, la Bourgogne, etc., etc.’’ Cette dernière tirade eut l’heur de plaire à mon voisin chargé de lire la presse espagnole : ‘‘Moi, je suis Catalan, me confia-t-il. Si je suis ici, c’est que je ne tiens pas à me faire fusiller. Et vous… vous feriez mieux de vous taire.’’ Mais un Polonais naturalisé vint m’embrasser. De vives protestations amenaient souvent un planton du capitaine Vendryes, notre chef à tous, priant ces messieurs de parler un peu moins fort. Heureusement, je n’étais pas pris au sérieux… et cela encore moins lorsque je me mêlais de poésie et avançais, par exemple, que le XVIIe siècle, à quelques petits poèmes de Corneille près, était une période dénuée de lyrisme. Ou quand on s’excitait sur Baudelaire : ‘‘Mais, gueulais-je, si l’auteur des Fleurs du mal et, après lui, Mallarmé, avaient eu le sens profond de ce qu’est la musique des mots, auraient-ils jamais essayé de traduire les poèmes de Poe ? Mettre Le Corbeau en français est exactement une entreprise de prof et de prosateur. Verlaine veut ‘de la musique avant toute chose’.’’ Cependant, si la plupart des doctes savants qui m’entouraient finirent pas m’ignorer, quelques-uns acceptaient de déjeuner chez moi lorsque ma femme m’envoyait un de ses bons petits colis de son Midi natal. »
Mot de Segonzac (juin 1915), habitué de la table de Vanderpyl
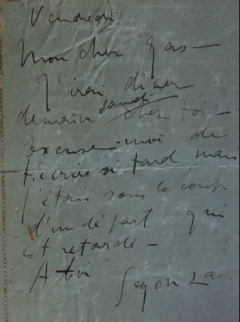 Ainsi, durant les premiers mois de sa prise de fonction « mangent et boivent » chez Fritz : Eugène Montfort (1877-1936), « directeur des Marges qui est à la section italienne de la Maison de la Presse et mon voisin », Paul Eyquem, chef de la section hollandaise, un certain Schmitt, chef de la section allemande, Jean Amade (1878-1949), chef de la section espagnole – sans doute le Catalan dont il est question plus haut –, un dénommé Martin, chef de la section anglaise, et Grappin, chef de la section polonaise… À ces convives viennent parfois s’ajouter Édouard Renoir, neveu du célèbre peintre, lui aussi semble-t-il rattaché à ces bureaux de la censure, l’épouse du journaliste Jean Ernest-Charles (1875-1953), et bien des auteurs dont André Billy (1882-1971), Guillaume Apollinaire, Paul Morisse (1866-1946), Arnold Van Gennep (1873-1957), Paul Léautaud (1872-1956), Louis Dumur… À la Maison de la Presse, Fritz a également fait la connaissance d’un grand amateur d’art, critique et collectionneur comme lui, Henri Fritsch-Estrangin (1872-1959), un oncle, nous dit-il, de la femme de lettres Louise de Vilmorin (1902-1969). Une missive d’Édouard Renoir, datée du 31 août 1917, à entête de la Maison de la Presse, atteste des tensions qui ont pu régner entre confrères et fournit un exemple du désir qu’avaient certaines personnes de se réconcilier avec le colérique gourmet : « Mon cher Fritz, Je veux faire la paix avec toi. J’ai eu avec mon beau-père une explication qui a très bien réussi. Je serai aussi heureux avec toi, n’est-ce pas ? J’ai voulu te faire boire un dé de maladie, tu y as vu, par une faute je tiens à le reconnaître, un tonneau de fiel. Ce que je voulais te dire était gros comme une pelure d’ongle, pas plus. Pardonne-moi. Tu es un poète, et moi, un petit garçon qui t’aime. »
Ainsi, durant les premiers mois de sa prise de fonction « mangent et boivent » chez Fritz : Eugène Montfort (1877-1936), « directeur des Marges qui est à la section italienne de la Maison de la Presse et mon voisin », Paul Eyquem, chef de la section hollandaise, un certain Schmitt, chef de la section allemande, Jean Amade (1878-1949), chef de la section espagnole – sans doute le Catalan dont il est question plus haut –, un dénommé Martin, chef de la section anglaise, et Grappin, chef de la section polonaise… À ces convives viennent parfois s’ajouter Édouard Renoir, neveu du célèbre peintre, lui aussi semble-t-il rattaché à ces bureaux de la censure, l’épouse du journaliste Jean Ernest-Charles (1875-1953), et bien des auteurs dont André Billy (1882-1971), Guillaume Apollinaire, Paul Morisse (1866-1946), Arnold Van Gennep (1873-1957), Paul Léautaud (1872-1956), Louis Dumur… À la Maison de la Presse, Fritz a également fait la connaissance d’un grand amateur d’art, critique et collectionneur comme lui, Henri Fritsch-Estrangin (1872-1959), un oncle, nous dit-il, de la femme de lettres Louise de Vilmorin (1902-1969). Une missive d’Édouard Renoir, datée du 31 août 1917, à entête de la Maison de la Presse, atteste des tensions qui ont pu régner entre confrères et fournit un exemple du désir qu’avaient certaines personnes de se réconcilier avec le colérique gourmet : « Mon cher Fritz, Je veux faire la paix avec toi. J’ai eu avec mon beau-père une explication qui a très bien réussi. Je serai aussi heureux avec toi, n’est-ce pas ? J’ai voulu te faire boire un dé de maladie, tu y as vu, par une faute je tiens à le reconnaître, un tonneau de fiel. Ce que je voulais te dire était gros comme une pelure d’ongle, pas plus. Pardonne-moi. Tu es un poète, et moi, un petit garçon qui t’aime. »
Autre conflit, cette fois entre Vanderpyl et Apollinaire. Le premier rapporte l’incident dans ses Mémoires, une scène qui eut lieu six semaines avant la mort du lieutenant de Kostrowitzky. Avant une réconciliation : « Le lendemain on se raccommoda à la Maison de la Presse à laquelle nous étions détachés tous deux. » Une autre scène mémorable avait eu lieu peu avant au domicile de Fritz, un soir où Guillaume et son épouse Jacqueline étaient venus manger alors qu’Hermine était probablement en vacances auprès de sa famille. C’est Michel Décaudin (1919-2004) qui rapporte la scène après avoir rendu visite au vieil homme le 30 juillet 1963 : Leur hôte « est avec une petite blonde. Dîner. Puis les deux s’isolent dans la chambre. Cris de la fille. J[acqueline] va voir tandis qu’A[pollinaire] se marre doucement. Elle trouve V[anderpyl] à poil, le chapeau sur la tête et le martinet à la main. Attaque V[anderpyl], jette le martinet par la fenêtre. V[anderpyl] : ‘‘Apollinaire, emmenez-la ou je la baise !’’ »
Lettre de Vanderpyl à Apollinaire, 23 mars 1917 (source : Gallica)
 Bien entendu, Fritz et ses confrères de la Maison de la Presse parlèrent de leur confrère et poète après sa disparition. Un esculape avait fait circuler le bruit selon lequel il aurait refusé de soigner Guillaume « parce que celui-ci avait, à plusieurs reprises, maltraité le chat du dit médecin ». Anecdote qui inspire le commentaire suivant au Haguenois de naissance : « C’est de l’Apollinaire pur, non pas de flanquer des coups de pied à un animal, mais de faire dire pareille énormité à un guérisseur des Mille et Une Nuits. On n’en crut pas un mot à la Maison de la Presse, car nous savions à quel point tout avait été fait pour sauver le poète. »
Bien entendu, Fritz et ses confrères de la Maison de la Presse parlèrent de leur confrère et poète après sa disparition. Un esculape avait fait circuler le bruit selon lequel il aurait refusé de soigner Guillaume « parce que celui-ci avait, à plusieurs reprises, maltraité le chat du dit médecin ». Anecdote qui inspire le commentaire suivant au Haguenois de naissance : « C’est de l’Apollinaire pur, non pas de flanquer des coups de pied à un animal, mais de faire dire pareille énormité à un guérisseur des Mille et Une Nuits. On n’en crut pas un mot à la Maison de la Presse, car nous savions à quel point tout avait été fait pour sauver le poète. »
Éternel ronchon, éternel insatisfait, Vanderpyl n’acceptait pas de rester simple troufion : « Utilisé à la section des traducteurs du IIe Bureau, j’avais, en vain, sollicité le grade provisoire d’‘‘interprète stagiaire’’, qui comportait une bande de velours bleu autour d’un képi d’officier et une solde intéressante. Or, troupier de deuxième classe des services auxiliaires de la réserve de l’armée territoriale, donc ‘‘inapte à monter à dos de cheval, de mulet et de chameau’’, ainsi que me l’apprit la formule qui me refusait l’avancement auquel je pensais avoir droit, je découvris plus tard que le règlement du corps des interprètes du conflit mondial de 1914 datait de la Campagne d’Égypte : ‘‘C’est pourquoi, m’expliqua le collègue plus heureux qui me renseigna, nos boutons sont à tête de sphinx…’’ » Un article de l’époque fait écho aux revendications de l’ancien légionnaire : on refuse aux mobilisés interprètes les grades auxquels ont droit les interprètes du service armé, ce qui fait qu’ils sont, à côté de leur travail, « astreints à des servitudes de caserne ». Pourquoi ne pas les nommer adjudant ? se demande le journaliste. Restait au simple troupier à se parer des galons de gastrolâtre que lui accordaient certains de ses correspondants. Ainsi du peintre Jean Marchand qui lui envoie une carte de Chinon le 5 juillet 1918 : « À Monsieur F.-R. Vanderpyl, soldat épicurien – section néerlandaise maison de la presse 3, rue François-Ier, Paris ‘‘j’ai bu du bon vin à ta santé immortelle vieux bouc’’. » Et à se consoler en passant du bon temps. Muni d’une autorisation, il peut ainsi se rendre au théâtre le 25 septembre 1916. Et dès qu’il le peut, il reçoit et héberge des camarades moins bien lotis que lui lorsque ceux-ci bénéficient d’une permission. Ainsi d’Aeschimann, du sous-lieutenant Charpillon qu’il a connu à Lons-le-Saulnier et de plusieurs amis peintres.
Début d’une lettre du soldat Jean H. Marchand à Fritz, 1916
Un armistice, mais pour quelle paix ?
Après la Grande Guerre, Vanderpyl entretient des contacts avec de rares camarades de régiment, par exemple le cacochyme J. Boulanger, joailler, rue du Dragon, Liégeois et « copain de la guerre de 1914 », qu’il voit régulièrement jusqu’à la mort de ce dernier en 1951 : « je suis allé pendant neuf ans [lui] rendre visite une ou deux fois par semaine : on n’a jamais su ce qu’il avait au juste, mais un abcès succédait à l’autre et cela de 1942 à 1951 ! Léautaud, qui le connaissait lui aussi, avait perdu patience au bout de quatre ans ! » Dans son Journal littéraire, ce dernier rapporte quelques anecdotes que lui a contées Boulanger au sujet de son expérience au front. Vanderpyl parle-t-il d’un autre « copain » ou du même dans une lettre du 18 décembre 1958 qu’il adresse à Berthe Combe (1891-1974), l’épouse de Vlaminck ? Il remet en mémoire à sa correspondante qu’il a, un jour, « fait cadeau à un camarade de la guerre de 14 » d’une petite toile de son célèbre mari !
Les guéguerres de la Closerie des Lilas
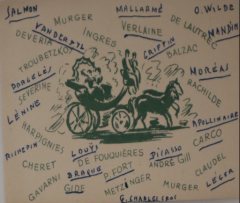 Le 22 janvier 1951, soit avec plus de trois décennies de recul, Fritz portera un regard plus que dubitatif sur son engagement dans la Légion : « C’est en feuilletant (car je ne pourrais pas le lire) le Journal de Gide (qui engueule pas mal de monde avec raison, ce qui ne l’empêche pas d’être un effroyable littérateur) que je pense à mon geste de 14, lorsque je me suis engagé dans l’armée. D’abord, si j’avais su que c’était dans la Légion étrangère, je serais resté chez moi, la conscience tranquille. C’était pour la première fois que je me trouvais devant un devoir, car l’un des deux, ou j’étais français de cœur et de conviction et – du côté de ma mère – par ma naissance, ou je ne l’étais pas. Je prétendais l’être, comme homme et comme poète. Je n’avais donc pas le choix et ne pouvais pas laisser aller tous les copains à la bataille et aux armées sans faire comme eux qui avaient mon âge : Segonzac, Salmon, Guy-Charles Cros, Camille Charasson, Mercereau, des neveux du côté de ma femme et la moitié des habitués des mardis de la Closerie (Franconi entre autres). Autrefois, avant août 14, je n’avais jamais pensé au ‘‘devoir’’, même pas en me mariant. Ma vie était en jeu en 1914 et c’était sérieux. Mes devoirs d’enfant et d’écolier ne m’avaient, en aucune circonstance, préoccupé. Mes devoirs d’enfant et de fils aîné vis-à-vis de mes parents encore moins. Mon père me faisait peur et mes maîtres d’école aussi. La peur supprime le sens du devoir. En 14, je n’avais pas peur ou, plutôt, j’avais moins peur d’être soldat que de rester chez moi. L’atmosphère était au devoir et au ‘‘démerde-toi’’ ensuite. »
Le 22 janvier 1951, soit avec plus de trois décennies de recul, Fritz portera un regard plus que dubitatif sur son engagement dans la Légion : « C’est en feuilletant (car je ne pourrais pas le lire) le Journal de Gide (qui engueule pas mal de monde avec raison, ce qui ne l’empêche pas d’être un effroyable littérateur) que je pense à mon geste de 14, lorsque je me suis engagé dans l’armée. D’abord, si j’avais su que c’était dans la Légion étrangère, je serais resté chez moi, la conscience tranquille. C’était pour la première fois que je me trouvais devant un devoir, car l’un des deux, ou j’étais français de cœur et de conviction et – du côté de ma mère – par ma naissance, ou je ne l’étais pas. Je prétendais l’être, comme homme et comme poète. Je n’avais donc pas le choix et ne pouvais pas laisser aller tous les copains à la bataille et aux armées sans faire comme eux qui avaient mon âge : Segonzac, Salmon, Guy-Charles Cros, Camille Charasson, Mercereau, des neveux du côté de ma femme et la moitié des habitués des mardis de la Closerie (Franconi entre autres). Autrefois, avant août 14, je n’avais jamais pensé au ‘‘devoir’’, même pas en me mariant. Ma vie était en jeu en 1914 et c’était sérieux. Mes devoirs d’enfant et d’écolier ne m’avaient, en aucune circonstance, préoccupé. Mes devoirs d’enfant et de fils aîné vis-à-vis de mes parents encore moins. Mon père me faisait peur et mes maîtres d’école aussi. La peur supprime le sens du devoir. En 14, je n’avais pas peur ou, plutôt, j’avais moins peur d’être soldat que de rester chez moi. L’atmosphère était au devoir et au ‘‘démerde-toi’’ ensuite. »
Le Mémorial sans dates nous apprend encore que l’ancien légionnaire n’a pas assisté aux manifestations de joie qui ont éclaté lors de l’Armistice : « Et la vie normale – ou du moins ce qu’on entend par là – revint avec son patriotisme d’autant plus ardent que le danger de le devoir payer avec sa peau se trouvait momentanément écarté. Je ne me souviens que d’un seul incident au cours des parades, cavalcades, cortèges et autres manifestations de la victoire dont je ne vis strictement rien. Je n’en fus donc pas le témoin. Une femme, patriote enragée, me raconta l’affaire, en pleurant à chaudes larmes. C’était près de la place de la Concorde ; elle en revenait. La voiture, contenant entre autres le président Wilson, déboucha du pont dans le sens de la Chambre des Députés où l’on attendait la visite du stadhouder des États-Unis. La foule salue du chapeau, du mouchoir, de la voix : ‘‘Vive l’Amérique !’’, etc… Au premier rang, presque devant celle à laquelle je dois ce récit, un seul homme resta obstinément couvert : ‘‘Enlevez votre chapeau !’’ cria-t-on derrière lui et de tous côtés. Il ne bougea point. Soudain, un coup de poing, venu de derrière, lui enfonça son melon jusqu’aux yeux. D’un mouvement irrésistible, le malheureux aveuglé réussit à se retourner : il n’avait plus de bras. ‘‘Il n’était même pas décoré’’, ajouta mon informatrice que j’avais rencontrée sur le trottoir de ma rue, encore toute bouleversée. »
Lettre de Salmon à Vanderpyl, guerre d’Espagne, 7/10/1936
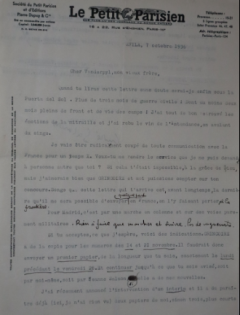 Dans une lettre du 25 mai 1955, André Salmon écrit à son vieux copain – ils se connaissent depuis plus d’un demi-siècle – que, malgré les aléas de la vie, « rien donc n’aura rien pu contre notre amitié. Ce que je dis de toi, c’est selon cette amitié et selon la justice. On m’assure qu’il restera quelque chose de mon livre. Ne te crois pas quitte. Il y aura une suite ; on te reverra, et même en militaire, chapitre 1914 ». Par ces lignes, en plus d’évoquer une amitié qui a résisté à tout, l’auteur de La Négresse du Sacré-Cœur fait allusion au premier volume de ses mémoires que venait de publier Gallimard : Souvenirs sans fin. Première époque (1903-1908). Vanderpyl y apparaît en poète qui reçoit et déclame dans sa mansarde de la rue des Écoles. Il figurera également dans le troisième volume couvrant les années 1920-1940, cette fois à propos de sa rencontre, bien antérieure à ces dates, avec Kees van Dongen. En revanche, il n’est malheureusement pas question de lui – ni en civil ni en militaire – dans le deuxième qui couvre pourtant la période 1908-1920. Ce qui amène Fritz à écrire dans son Journal : « Salmon, dans le deuxième volume de ses Souvenirs sans fin, lui qui a été si convenable avec moi dans le premier, a complètement supprimé mon nom, probablement sur l’ordre de ses éditeurs. » Il se demande si c’est lâcheté de sa part, à l’époque de la disgrâce de Fritz. Pour autant, il ne lui en voudra pas. Les deux hommes sont restés liés jusqu’à la fin. Ainsi, le 16 février 1962, depuis sa résidence de Sanary, André écrit aux Vanderpyl qui fêtent leurs noces d’or : « Je lève pour vous ma coupe. À mon rosé du Var, je joins l’essence de nos vins de jeunesse. Je suspends, tel qu’en songe, une branche fleurie de mon amandier au balcon de la rue Gay-Lussac en me souvenant des bouquets printaniers de la rue des Écoles et de la rue Princesse. »
Dans une lettre du 25 mai 1955, André Salmon écrit à son vieux copain – ils se connaissent depuis plus d’un demi-siècle – que, malgré les aléas de la vie, « rien donc n’aura rien pu contre notre amitié. Ce que je dis de toi, c’est selon cette amitié et selon la justice. On m’assure qu’il restera quelque chose de mon livre. Ne te crois pas quitte. Il y aura une suite ; on te reverra, et même en militaire, chapitre 1914 ». Par ces lignes, en plus d’évoquer une amitié qui a résisté à tout, l’auteur de La Négresse du Sacré-Cœur fait allusion au premier volume de ses mémoires que venait de publier Gallimard : Souvenirs sans fin. Première époque (1903-1908). Vanderpyl y apparaît en poète qui reçoit et déclame dans sa mansarde de la rue des Écoles. Il figurera également dans le troisième volume couvrant les années 1920-1940, cette fois à propos de sa rencontre, bien antérieure à ces dates, avec Kees van Dongen. En revanche, il n’est malheureusement pas question de lui – ni en civil ni en militaire – dans le deuxième qui couvre pourtant la période 1908-1920. Ce qui amène Fritz à écrire dans son Journal : « Salmon, dans le deuxième volume de ses Souvenirs sans fin, lui qui a été si convenable avec moi dans le premier, a complètement supprimé mon nom, probablement sur l’ordre de ses éditeurs. » Il se demande si c’est lâcheté de sa part, à l’époque de la disgrâce de Fritz. Pour autant, il ne lui en voudra pas. Les deux hommes sont restés liés jusqu’à la fin. Ainsi, le 16 février 1962, depuis sa résidence de Sanary, André écrit aux Vanderpyl qui fêtent leurs noces d’or : « Je lève pour vous ma coupe. À mon rosé du Var, je joins l’essence de nos vins de jeunesse. Je suspends, tel qu’en songe, une branche fleurie de mon amandier au balcon de la rue Gay-Lussac en me souvenant des bouquets printaniers de la rue des Écoles et de la rue Princesse. »
Tombe de Salmon, Sanary-sur-Mer (photo D. Cunin)
 Malgré des guéguerres, les deux compères avaient toujours fini par conclure la paix. Fritz avait été heureux de retrouver André après l’Armistice, lui « que les années de tranchée n’avaient point vieilli. […] Nous avions tous lu ses notes de campagne en Argonne et en Artois, document irrécusable, édité sous le titre du Chass’bi ». Et Vanderpyl de poursuivre dans ses Mémoires, en rendant hommage à son ami et en convoquant d’autres guerres que celles qui nécessitent de revêtir un uniforme, en d’autres mots ses conflits intérieurs : « Salmon. Il est dans ma vie depuis plus de quarante ans. Surtout à cause de ces longues périodes où mes bouderies de garçon à mauvais caractère me tenaient éloigné de lui, j’ai fini par découvrir de l’ange-gardien en Salmon. Si quelqu’un, de la façon la plus désintéressée, m’a témoigné de l’amitié, c’est bien Salmon, une amitié tenace ne tenant jamais compte d’une façon de me conduire (voire de rimer) qui, souvent et souverainement, déplaisait dans des milieux où, encore très jeune, il avait déjà la parole. Je pense moins de mal de moi-même que, peut-être, il semble. Je me prenais jusqu’à il y a peu de temps, pour le seul à connaître mes batailles, livrées alors presque quotidiennement. Dénué du moindre grain d’habileté, je luttais contre une infériorité financière en accrochant des étrangers aux portes des musées ; contre une infériorité sociale en contrant du mépris pour toute situation établie ; contre une infériorité d’élocution que je croyais cacher sous une gouaille sans mesure. Je jouais ma comédie d’outcast, de déclassé pour laquelle je ne trouvais point de dernier acte. Le seul sous la main – mon retour d’enfant prodigue au bercail hollandais –, je le savais indigne de mon drame. Là est le secret entre Salmon et moi. Il a été probablement l’unique à saisir ce qui se passait en moi et que mon tempérament me refusait tout dénouement auquel j’aspire. »
Malgré des guéguerres, les deux compères avaient toujours fini par conclure la paix. Fritz avait été heureux de retrouver André après l’Armistice, lui « que les années de tranchée n’avaient point vieilli. […] Nous avions tous lu ses notes de campagne en Argonne et en Artois, document irrécusable, édité sous le titre du Chass’bi ». Et Vanderpyl de poursuivre dans ses Mémoires, en rendant hommage à son ami et en convoquant d’autres guerres que celles qui nécessitent de revêtir un uniforme, en d’autres mots ses conflits intérieurs : « Salmon. Il est dans ma vie depuis plus de quarante ans. Surtout à cause de ces longues périodes où mes bouderies de garçon à mauvais caractère me tenaient éloigné de lui, j’ai fini par découvrir de l’ange-gardien en Salmon. Si quelqu’un, de la façon la plus désintéressée, m’a témoigné de l’amitié, c’est bien Salmon, une amitié tenace ne tenant jamais compte d’une façon de me conduire (voire de rimer) qui, souvent et souverainement, déplaisait dans des milieux où, encore très jeune, il avait déjà la parole. Je pense moins de mal de moi-même que, peut-être, il semble. Je me prenais jusqu’à il y a peu de temps, pour le seul à connaître mes batailles, livrées alors presque quotidiennement. Dénué du moindre grain d’habileté, je luttais contre une infériorité financière en accrochant des étrangers aux portes des musées ; contre une infériorité sociale en contrant du mépris pour toute situation établie ; contre une infériorité d’élocution que je croyais cacher sous une gouaille sans mesure. Je jouais ma comédie d’outcast, de déclassé pour laquelle je ne trouvais point de dernier acte. Le seul sous la main – mon retour d’enfant prodigue au bercail hollandais –, je le savais indigne de mon drame. Là est le secret entre Salmon et moi. Il a été probablement l’unique à saisir ce qui se passait en moi et que mon tempérament me refusait tout dénouement auquel j’aspire. »
L’entre-deux-guerres une fois commencé, la Légion qui va dorénavant attendre Fritz-René Vanderpyl, c’est la Légion d’honneur. Il en sera fait chevalier par le président de la République Gaston Doumergue en septembre 1927. À ce moment-là, le critique d’art et poète gastronome est cependant loin d’avoir livré ses derniers combats.
Daniel Cunin
 Fritz Vanderpyl, par Ferdinand Desnos, 1950 (collection et photo : Tamara Poniatowska)
Fritz Vanderpyl, par Ferdinand Desnos, 1950 (collection et photo : Tamara Poniatowska)
Au mur : son portrait à la canne peint par Charles Blanc (1933) ; son portrait au chapeau jaune et à la pipe peint par son copain Maurice de Vlaminck en 1918 ; le troisième portrait représente sans doute le grand-père paternel de Vanderpyl, à savoir Jan van der Pijl (1810-1889), fondateur du célèbre restaurant Van der Pijl de La Haye, d’après un portrait peint par Maurits Verveer (1817-1903).
Œuvres de Fritz Vanderpyl (1876-1965)
Van geluk dat waan is…, La Haye, N. Veenstra, 1899 (poésie).
Les Saisons douloureuses, Paris/Créteil, L’Abbaye, 1907 (poésie).
Les Saisons d’un poète, Paris, Eugène Figuière, 1911 (poésie).
Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes, Paris, Georges Crès, 1913 (essai sur l’art).
Mon chant de guerre, Paris, La Belle édition, 1917 (poésie, illustrations d’André Dunoyer de Segonzac).
Quelques poèmes des saisons, Paris, François Bernouard, 1919 (poésie, 5 bois de Jean H. Marchand).
Voyages, Paris, Galerie Simon, 1920 (poésie, 25 gravures sur bois de Maurice de Vlaminck).
L’Américain, Paris, Grasset, 1923 (roman non diffusé, publié en 6 livraisons fin 1916 dans le Mercure de France sous le titre Marsden Stanton à Paris).
Des gouttes dans l’eau. Poèmes 1916-1923, Paris, Léon Marseille, 1926 (poésie).
Antoine Wiertz, Bruxelles, Cahiers de Belgique, série « Peintres et sculpteurs belges », n° 3, 1931 (essai sur l’art).
Peintres de mon époque, Paris, Librairie Stock, 1931 (essais sur l’art).
Le Guide égaré, Paris, Mercure de France, 1939 (roman).
L’Art sans patrie, un mensonge : le pinceau d’Israël, Paris, Mercure de France, 1942 (brochure sur l’art juif).
Poèmes 1899-1950, Nantes, Le Cheval d’écume, 1950 (poésie, anthologie rehaussée d’un bois de Maurice de Vlaminck).
De père inconnu, Paris, Éditions du Scorpion, 1959 (roman).
Tombe de l’ancien légionnaire Kisling (ancien cimetière de Sanary-sur-Mer, photo D. Cunin)
Revues et écrits non publiés
F.-R. Vanderpyl a créé deux revues : La Revue des Salons (un numéro, 1914) et L’Arbitraire (deux numéros, 1919). Il a collaboré à la création de quelques autres, par exemple La Vie (1904-1905) autour de plusieurs membres du futur phalanstère artistique l’Abbaye de Créteil. Entre 1898 et 1963, le Franco-néerlandais a publié, outre les ouvrages susmentionnés, des milliers d’articles (quelques dizaines en néerlandais et en anglais, voire dans une autre langue, le reste en français) sur les lettres, les arts et la gastronomie, ainsi que la préface de plusieurs plaquettes d’exposition. Il a laissé un Journal manuscrit en 15 cahiers (fin 1903-courant 1963), le tapuscrit de ses mémoires (Mémorial sans date, 1949), d’un roman et de quelques essais/nouvelles. Une étude de sa main sur le Vaucluse, un ou deux romans ainsi qu’un livre sur Rembrandt n’ont pas été retrouvés ; à notre connaissance, seules les dernières pages du dernier ont paru (dans le périodique Le Goéland). Ses articles de 1914 non publiés, « Le silence de la Hollande » et « Le cas de la Hollande et ce que l’on peut espérer d’elle », figurent dans son Journal.
Rose Elsie, cantatrice, l’une des quatre belles-sœurs de Vanderpyl
Autres sources consultées
René Arcos, « Georges Duhamel au temps de l’Abbaye », dans Écrivains et poètes d’aujourd’hui. Georges Duhamel, Paris, Le Capitole, 1927, p. 59-98.
Arias, « Notules », La Petite République, 16 mars 1920, p. 2.
T. A. van Bavel, « Nederlandse vrijwilligers in Franse krijgsdienst 1914-1918 Een reconstructie », MARS et Historia, 1993, p. 307-314.
Michaël Bourlet, « Des normaliens dans les services de renseignement du ministère de la guerre (1914-1918) », Revue historique des armées, n° 247, 2007, p. 31-41.
Bulletin des Écrivains, n° 1, novembre 1914.
Eliott Cardet, Alexandre Illi & Catherine Tabatabay, Daniel-Henry Kahnweiler éditeur. 1909-1939, Genève, L’Exemplaire / Illilibrairie, 2021.
Alexandre Cohen, Van anarchist tot monarchist, Amsterdam, De Steenuil, 1936.
Jérôme Coutard, « Presse, censure et propagande en 1914-1918 : la construction d’une culture de guerre », Bulletin d’Histoire politique, hiver 2020, p. 150-171. Au sujet de la Maison de la Presse, cet auteur renvoie à Jean-Claude Montant, « L’organisation centrale des services d’information et de propagande du Quay d’Orsay pendant la Grande Guerre », dans Jean-Jacques Becker & Stéphane Audoin-Rouzeau (dir.), Les société européennes et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque organisé à Nanterre et à Amiens du 8 au 11 septembre 1988, Paris, Publications de l’Université de Nanterre, 1990.
Daniel Cunin, « ‘‘Je n’écris pas, je gueule !’’ Premiers pas en compagnie de Fritz Vanderpyl », en ligne.
Daniel Cunin, « Nature morte. Une composition d’Arthur Honegger sur un poème de Fritz Vanderpyl », en ligne.
Daniel Cunin, « Apollinaire, Durand et Dupont », en ligne.
Daniel Cunin, « Le démon Vanderpyl. Fritz Vanderpyl à travers les yeux de Max Jacob », en ligne.
Daniel Cunin, « De bonte hond in het Quartier Latin. De vergeten Hagenaar Fritz R. Vanderpyl (1876-1965) », en ligne.
Daniel Cunin, « Fritz Vanderpyl, un infréquentable bon vivant parmi la bohème artistique parisienne », en ligne.
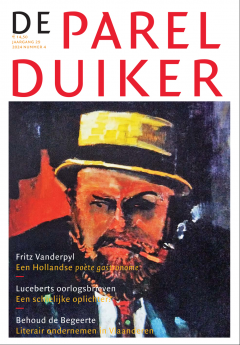 Daniel Cunin, « ‘‘C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier.’’ D’une rencontre et d’une amitié autour de Richard Anacréon : Gérard Conoir (1933-2023) et Fritz Vanderpyl (1876-1965) », en ligne.
Daniel Cunin, « ‘‘C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier.’’ D’une rencontre et d’une amitié autour de Richard Anacréon : Gérard Conoir (1933-2023) et Fritz Vanderpyl (1876-1965) », en ligne.
Daniel Cunin, « Een ongenietbare levensgenieter. Fritz Vanderpyl: een Hollandse poète gastronome in Parijs », De parelduiker, n° 4, 2024, p. 22-39.
Daniel Cunin, « Een zoektocht : Een Nederlandse vriend van Guillaume Apollinaire: de dichter Fritz Vanderpyl (Den Haag, 1876 - Lagnes, 1965) of de zoektocht naar een vergeten Nederlandse schrijver in de Provence en elders », en ligne.
Michel Décaudin (Fonds MD, Bibliothèque historique de la Ville de Paris), Cote 4-MS-FS-18-0808.
André Delhay, « Hollande hivernale. Un peu de neige sur La Haye », L’Ère nouvelle, 10 janvier 1934, p. 3.
www.francearchives.gouv.fr/ (décret de naturalisations d’engagés du 25 janvier 1925, Fritz René Vanderpyl, cote 8041 X 14 (numéro du dossier à consulter en sous-série BB/11 et décret de réintégrations de femmes d’étrangers du 5 avril 1916, cotes 18041 X 14).
Max Jacob, Correspondance, par François Garnier, t. 1., 1876-1921, Éditions de Paris, pp. 97 et 100.
Le site de Frans Janssen sur les Néerlandais dans la Légion étrangère : https://nllegioen.eu/.
Rende van de Kamp, « Nederlandse vrijwilligers in het Franse Vreemdelingenlegioen », en ligne.
Léo Larguier, « Le coin des libraires », Le Petit Provençal, 11 août 1913.
Paul Léautaud, Journal littéraire. XV, Paris, Mercure de France, p. 276-277.
Victor Méric, « De Tout un Peu. Un concours », Les Hommes du Jour, 24 avril 1909, p. 5.
Pierre Mille, « Les Américains morts pour la France », Le Temps, 4 novembre 1916, p. 3.
M.-C. Poinsot, Au service de la France. Les Volontaires étrangers de 1914, Paris, Dorbon-Aîné, 1915.
Ezra Pound, The Cantos, New York, New Directions Pub. Corp., 1993, p. 530 (« Fritz still roaring at treize rue Gay de Lussac / with his stone head still on the balcony ? »). Fritz est également mentionné ailleurs, par exemple p. 25.
André Salmon, « La Damnation bourgeoise », Vers et Prose, avril 1910 et Souvenirs sans fin. 1903-1940, nouvelle édition préfacée par Pierre Combescot, Paris, Gallimard, 2004.
Fritz Vanderpyl, « Essai sur moi-même. II », Revue des Nations, décembre 1913, p. 87-91.
Fritz Vanderpyl, « Lettre à Pierre Jouffroy » (28 juin 1943) (ces lettres sont conservées par les héritiers du peintre).
X., « Les auxiliaires employés comme interprètes », La Lanterne, 6 juin 1916, p. 1.
X., « Fritz Vanderpyl », Pourquoi pas ?, 19 septembre 1919, p. 647.
Relevons que l’éditeur-galeriste Léon Marseille, avec lequel Vanderpyl a été lié, semble avoir été oublié dans le volume de Claude Schvalberg (dir.), Dictionnaire de la critique d’art à Paris, 1890-1969, préface de Jean-Paul Bouillon, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
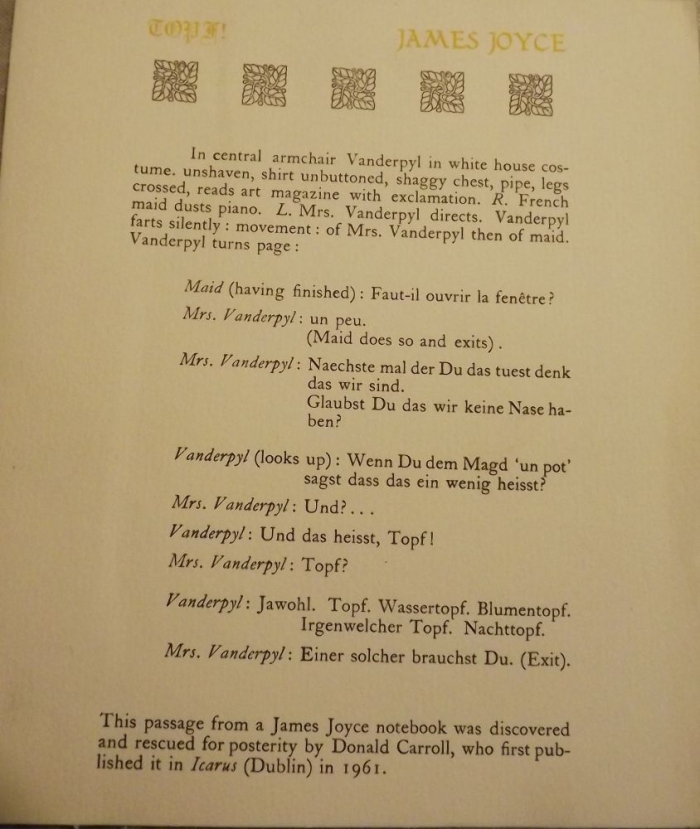 Fantaisie de James Joyce sur les Vanderpyl dans leur appartement parisien
Fantaisie de James Joyce sur les Vanderpyl dans leur appartement parisien
14:26 | Lien permanent | Tags : vanderpyl, guerre 14-18, légion étrangère, censure, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |