ALEXANDRE COHEN
LES ANNEES ANARCHISTES (1)
Taille : 1m65. Visage : ovale. Front : haut. Yeux : bleus. Nez : petit. Bouche : petite. Menton : rond. Cheveux : d’un blond foncé. Sourcils : idem. Signes particuliers : mauvaise vue. Langue maternelle : hollandais (1). Il est « de petite taille, malingre, l’air souffreteux. Il était toujours vêtu d’un complet, limé par l’usure, et d’un pardessus à capuchon ; il se coiffait d'un feutre mou dont il laissait la calotte droite. Il portait la barbe blonde en collier, et un lorgnon restait sondé à son nez. Très peu soigné de sa personne, il vivait depuis deux mois avec une jeune femme de très petite taille “plus sale que lui” (...) “L'un et l'autre descendaient les six étages, vingt, trente fois par jour, pour demander à la loge s’il n’était rien venu à leur adresse. Le fait est que des paquets de journaux recouverts entièrement par la bande, pour en cacher les titres, arrivaient presque tous les jours (...). Il veillait très tard la nuit et il empêchait le locataire de dessous de dormir. Il recevait en outre pendant la nuit, des visites de camarades. Ces visites commençaient à minuit. Elles se produisaient isolément, de sorte que pour l’entrée comme pour la sortie j’étais obligé de tirer cinq et six fois le cordon. J’ai fini par me fâcher. Il n’est pas permis à un locataire du sixième de troubler dix fois la nuit, et cela trois ou quatre fois la semaine, le sommeil d’un brave homme. Nous nous sommes chamaillés dur, et comme mon adversaire est très savant, qu’il connaît cinq ou six langues, il m’a injurié un peu dans toutes.” » (2) C’est sous ces traits peu avantageux qu’apparaît Alexandre Cohen au détour d'un document de l’administration pénitentiaire néerlandaise et du témoignage de son concierge confié à la presse quelques jours après son arrestation, survenue le 10 décembre 1893. Ce n’est pourtant pas suite aux nuisances suscitées par ce citoyen hollandais, ni à l'issue d'une rixe avec son voisinage, que la police a été amenée à intervenir. Les habitants d’un quartier populaire de Paris n’ayant pas encore rompu avec toute ruralité étaient certainement habitués à endurer d’autres gênes et à souffrir des spectacles plus outranciers que de simples scènes de tapage nocturne ou des échanges de propos peu courtois, d’autant qu’ils vivaient à quelques enjambées du Moulin Rouge et au cœur de la bohème parisienne.
Aux yeux des autorités et en particulier à ceux du fameux Préfet de police Lépine, Alexandre Cohen compte parmi la racaille délinquante de la pire espèce : il est anarchiste. Et il le proclame haut et fort dans les articles qu’il rédige ou dans les propos qu’il tient devant des groupes plus ou moins étoffés. L’écriture et la parole vont de pair chez ce polyglotte, toujours à la recherche d’une occasion de discourir, soucieux d’affirmer son point de vue et de mettre les points sur les i, à coups de plume ou à coups de gueule selon l’humeur et selon les circonstances. (3)
Les premières armes
 Adolescent déjà, il ne se mord guère la langue. Il ne sait pas encore qu’il gagnera sa vie - plutôt mal que bien ! - comme publiciste et traducteur, mais ses assertions, calquées sur son comportement, s’avèrent tranchantes. Turbulent, faisant l’école buissonnière bien longtemps avant l’introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire (1901), il forme son esprit à l’abri des regards et des reproches en dévorant des livres, perché sous le faîte du toit de la maison familiale, à Leeuwarden, en Frise. Certes, M. Cohen père, juif orthodoxe, ne désire point laisser ce fils agir à sa guise, mais Alexandre a bien souvent, et quoi qu’il lui en coûte, le dernier mot : quand le moment de la prière a sonné, Alexandre joue le jeu, mais sous couvert de lire les textes sacrés il se nourrit des pages du Max Havelaar (4) ; lorsque le conseil de famille décide de faire de lui un mousse, il fuit le port avant même l’embarquement pour la bonne et simple raison qu’il éprouve de l’antipathie à l’égard du capitaine. En laissant son petit commerçant de père à ses illusions, l’enfant fugueur, l’élève renvoyé des écoles, l’apprenti tanneur rebelle qui gifle son patron, rompt avec sa famille, nie le bien fondé des opinions du patriarche et se défait des derniers fantômes de toute observance. De telles dispositions conduisent souvent un jeune homme à connaître le milieu carcéral, à endosser l’uniforme ou encore à mener la vie de bohème. Alexander Cohen va emprunter ces différentes voies.
Adolescent déjà, il ne se mord guère la langue. Il ne sait pas encore qu’il gagnera sa vie - plutôt mal que bien ! - comme publiciste et traducteur, mais ses assertions, calquées sur son comportement, s’avèrent tranchantes. Turbulent, faisant l’école buissonnière bien longtemps avant l’introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire (1901), il forme son esprit à l’abri des regards et des reproches en dévorant des livres, perché sous le faîte du toit de la maison familiale, à Leeuwarden, en Frise. Certes, M. Cohen père, juif orthodoxe, ne désire point laisser ce fils agir à sa guise, mais Alexandre a bien souvent, et quoi qu’il lui en coûte, le dernier mot : quand le moment de la prière a sonné, Alexandre joue le jeu, mais sous couvert de lire les textes sacrés il se nourrit des pages du Max Havelaar (4) ; lorsque le conseil de famille décide de faire de lui un mousse, il fuit le port avant même l’embarquement pour la bonne et simple raison qu’il éprouve de l’antipathie à l’égard du capitaine. En laissant son petit commerçant de père à ses illusions, l’enfant fugueur, l’élève renvoyé des écoles, l’apprenti tanneur rebelle qui gifle son patron, rompt avec sa famille, nie le bien fondé des opinions du patriarche et se défait des derniers fantômes de toute observance. De telles dispositions conduisent souvent un jeune homme à connaître le milieu carcéral, à endosser l’uniforme ou encore à mener la vie de bohème. Alexander Cohen va emprunter ces différentes voies.
Il a dix-sept ans quand une première porte de cellule se referme sur lui. Il est arrêté à Anvers pour vagabondage. De la prison de Bruxelles où il est interné durant une dizaine de jours, la police le transfère à Maastricht ; là, les gendarmes, au lieu de le retenir en attendant de le remettre à un membre de sa famille, le laissent libre de visiter la ville et le traitent comme un prince. Quelques mois plus tard, le jeune juif frison demande à être incorporé dans l'armée des Indes Néerlandaises avant l'âge requis : bien que ses pleins et ses déliés ne soient pas parfaits, il est reçu au concours de commis aux écritures. Cette fonction d’ « écrivain-soldat » (5) venait d'être créée par le Ministère des Colonies et supposait l'accomplissement d’une période de six années sous les drapeaux.
Avant même que le bâtiment Princesse Wilhelmine ne lève l’ancre le 6 septembre 1882 pour un voyage de plus d’un mois, Alexandre Cohen échappe de peu à une première sanction disciplinaire : il s’était laissé aller à déféquer dans sa chambrée.
Une fois à Sumatra, l’intellectuel en herbe et poète de circonstance (on lui demande d’écrire et de déclamer des vers à l’occasion de l’anniversaire d’un gradé), à peine remis d’une grave maladie, écope de quatre jours de trou et se retrouve muté à Lahat, un coin perdu sur la côte est où, après quelques semaines d’une vie paisible, son impertinence, sa ténacité et sa soif de justice le poussent à mettre en branle tout l’édifice judiciaire de l’armée coloniale. Une querelle avec le médecin de la garnison est à l’origine de l'affaire, le premier médecin irascible, mais non le dernier, que Cohen croisera durant sa longue existence. Le docteur, un polonais
se promène toujours en civil, aussi bien pendant ses visites dans la salle des malades que lorsqu’il n’est pas en service. Je ne lui en fais pas du tout grief ! Ce que je ne peux pas avaler, c’est qu’il ne rende jamais les saluts que je lui adresse. Si je salue – tel est mon raisonnement –, c’est pure politesse de ma part. Car je ne suis pas tenu de saluer un officier en costume de ville. La première fois, je pense que le docteur ne m’a certainement pas vu ou bien qu’il est distrait, ce qui peut arriver à tout le monde après tout. Mais voilà que, à peu de jours d’intervalle, la chose se reproduit. Bien que je commence à être irrité, je me promets de lui laisser une dernière chance. Jamais deux sans trois ! Quelques semaines, peut-être un mois plus tard, je le croise de nouveau. Je le salue de la manière la plus correcte qui soit – « la main droite tendue contre le calot, et dans le même temps, le regard fièrement et respectueusement dirigé vers mon supérieur » – avec toujours le même résultat négatif : il ne répond pas à mon salut. Ça suffit comme ça, voilà ce que je me dis, il peut aller crever ! Et que je crève, moi, si jamais je le salue de nouveau, à moins que, par exceptionnel, il ne soit en uniforme.
Un beau soir, quelque temps après, je rencontre le docteur sur la grand-route. Comme à son habitude, il est en civil. Nous nous croisons, distants l’un de l’autre d’un mètre. Je le regarde droit dans les yeux – pour rien au monde je ne voudrais qu’il croie que je ne le vois pas ou qu’il me pense plongé dans mes pensées – et ne le salue pas. Tout à sa surprise, il me dévisage à la manière de quelqu’un qui n'en croit pas ses yeux ; il en reste coi. Mais à peine me suis-je éloigné de lui de quelques pas qu’il m’interpelle :
- Fusilier !... Fusilier !
Je ne tourne pas la tête, et continue de marcher. Je ne suis pas fusilier ! Je suis commis aux écritures ! Non que je me pique de ma position de commis aux écritures. Oh ! mon Dieu non. Si pour me flatter il avait crié : “Général ! Général !”, je n’aurais pas eu un autre comportement. Mais je ne suis pas fusilier, un point c’est tout ! Il hurle encore deux ou trois fois: “Fusilier !... Fusilier ! ”, puis finit par revenir sur ses pas, me dépasse, se place devant moi et m’adresse la parole :
- Tu n’as pas entendu que je t'appelais ?
- Non !
- Tu ne vas pas me faire croire que tu ne m'as pas entendu crier ?
- Ce n’est pas ça ! Je vous ai bien entendu crier...
- Alors pourquoi as-tu continué de marcher ?
- Vous avez crié : “fusilier !”, et moi, je ne suis pas fusilier.
- Tu n’es pas fusilier ? T’es quoi alors ?
- Je suis commis aux écritures.
- Alors comme ça, c’est pour cela que tu ne t’es pas arrêté ?
- Oui !
- Bien !... Mais dis-moi maintenant, commis aux écritures, tu ne sais pas qui je suis peut-être.
- Si ! je le sais.
- Je suis qui alors ?
- Le médecin.
- Donc, tu le savais ! Pourquoi ne m’as-tu pas salué dans ce cas ?
- Parce que rien ne m’y oblige !
- Tu n’es pas obligé de me saluer ?
- Non ! Je ne suis pas tenu de vous saluer quand vous êtes en civil.
- Ah ! Tu crois ça ?
- Non ! je ne le crois pas. J’en suis certain !
- Eh bien moi, je vais t’apprendre le contraire !
- Non ! vous ne le ferez pas. Je ne suis pas obligé de saluer un officier en civil... Et pour ce qui est de vous justement, il se trouve que je vous ai salué à plusieurs reprises. Mais vous ne m’avez jamais rendu mes saluts. Vous ne le faites jamais. C’est pourquoi vous m’avez offensé...
- Ah oui ! J’ai ainsi offensé monsieur le commis aux écritures ? C’est tout à fait regrettable !
- Oui, vous avez ainsi offensé monsieur le commis aux écritures. Je faisais montre de politesse, ce à quoi je n’étais pas tenu, et cette attention vous laisse froid ! Dorénavant, je ne vous salue plus !
;
- T’entendras parler de moi, toi !
- J’en suis fort aise ! (6)
En révolte, publié en 1932
 « Huit jours de salle de police pour t’être abstenu de saluer un supérieur. Tu peux disposer ! » Voilà la courte harangue qui siffle aux oreilles d’Alexandre Cohen le lendemain matin au rapport. Cette peine purgée, le commis aux écritures dépose une réclamation auprès du commandant de Palembang. Réclamation qui, estimée non fondée, lui coûte deux semaines de la même punition (vaquer la journée à son travail et passer la nuit et les dimanches enfermé dans une remise sordide). Deux semaines plus tard, Alexandre Cohen demande qu’on s'en remette au Conseil de Guerre. Dans l’attente de la décision de cette instance, il est consigné et les séjours au cachot se multiplient au moindre prétexte. Le Conseil de Guerre déclare enfin « la réclamation du commis aux écritures Cohen, n° de matricule 15527, à l’encontre de la peine de deux semaines de salle de police à lui infligée par l’adjudant de garnison de la côte est de Sumatra, non fondée, et lui inflige une peine de trois semaines de salle de police... » (7)
« Huit jours de salle de police pour t’être abstenu de saluer un supérieur. Tu peux disposer ! » Voilà la courte harangue qui siffle aux oreilles d’Alexandre Cohen le lendemain matin au rapport. Cette peine purgée, le commis aux écritures dépose une réclamation auprès du commandant de Palembang. Réclamation qui, estimée non fondée, lui coûte deux semaines de la même punition (vaquer la journée à son travail et passer la nuit et les dimanches enfermé dans une remise sordide). Deux semaines plus tard, Alexandre Cohen demande qu’on s'en remette au Conseil de Guerre. Dans l’attente de la décision de cette instance, il est consigné et les séjours au cachot se multiplient au moindre prétexte. Le Conseil de Guerre déclare enfin « la réclamation du commis aux écritures Cohen, n° de matricule 15527, à l’encontre de la peine de deux semaines de salle de police à lui infligée par l’adjudant de garnison de la côte est de Sumatra, non fondée, et lui inflige une peine de trois semaines de salle de police... » (7)
Le condamné se présente bien entendu trois semaines plus tard au rapport en exigeant cette fois de l’adjudant de garnison qu’il transmette son cas devant la plus haute juridiction militaire des Indes Néerlandaises, à savoir la Haute Cour Militaire (Het Hoog Militair Gerechtshof). Et c’est les larmes aux yeux que le réclamant entend en 1884 le commandant lui lire l’arrêt de cette instance : sa demande est reçue et toutes les peines infligées depuis la plainte formulée par le médecin polonais sont déclarées nulles et non avenues. Alexandre Cohen n’en est pas pour autant quitte : les diverses représailles qu’il a endurées avant le prononcé de cette décision favorable l’ont incité à faire preuve d’insubordination.
Mes états d’âme sont ceux d’un enragé. Plus on me sanctionne, plus la sanction est lourde – cellule, cachot : chaque jour au régime eau-riz ou le jour suivant au régime eau-riz-fers, c’est-à-dire la main droite et le pied gauche ou le pied droit et la main gauche reliés l’un à l'autre par une courte chaîne –, et plus je deviens indifférent à toute peine. Je me fiche d'être aux arrêts, je quitte le campement, vais dans le bois lorsque l’envie m’en vient. Moi qui ne bois pas – non par probité mais parce que je n’aime pas le genièvre –, me voilà traîné au rapport par je ne sais quel subalterne sycophante pour état d’ébriété ; j’ai beau protester contre cette imputation mensongère, on me punit de nouveau. Une fois les quatre jours de cellule purgés, je vais à la cantine située hors du campement – ceci bien que je sois toujours aux arrêts – m’enivre alors et avale avec des hauts le cœur deux godets de 10 centilitres de genièvre ; je percute ensuite de façon délibérée le lieutenant. “Eh bien ! mon lieutenant, vous pouvez à présent me sanctionner pour état d’ébriété. Je suis vraiment saoul cette fois !” (...) Dans le local où l’on me garde aux arrêts, je casse tout : les tréteaux de ma couchette, la couchette elle-même, la serrure de mes menottes, mes menottes. J'enfonce la porte en bois munie de barreaux. Quand je pars pour Palembang en mai ou juin 1884 pour comparaître devant le Conseil de Guerre, je suis redevable d’environ 60 florins à la Patrie et ai à coup sûr le casier judiciaire le plus chargé de toute l’armée des Indes Néerlandaises.
J’ai payé cher mon triomphe. Mais au moins, je ne me suis pas laissé marcher dessus ! (8)
Triomphe cher payé en effet puisque le Conseil de Guerre de Pamelang le condamne dans la foulée à six mois et deux fois un an de détention pour trois actes d’insubordination verbale caractérisée. En juin 1884, il est transféré à la prison du fort Prince d'Orange où il côtoie des détenus purgeant de longues peines et où on le destine à la confection de calots. Mais bien vite, suite à de nouvelles manifestations de rébellion, il passe le plus clair de son temps dans un réduit qualifié de cachot où il a un boulet pour fidèle compagnon. Les outrages dont il se rend coupable par ses propos lui valent par ailleurs, en guise de châtiment corporel, trois séries de dix ou vingt coups de triques. Toutefois, les jours ne sont pas intégralement sombres : monté sur la toiture d’un bâtiment, « de juin 1884 à décembre 1886, tous les soirs, je regardais la mer – la liberté. Pas une seule fois je n’y ai manqué – lorsque je n’étais pas au cachot – beau temps, pluie, tempête, déluge, avec boulet, sans boulet – les autres eux, avec leur boulet, ne s’y risquaient pas. » (9) De plus, Cohen possède la faculté de rire et de faire rire dans les situations les plus inattendues comme dans les plus compromises. Ne sera-t-il pas connu quelques mois plus tard dans les cercles révolutionnaires comme « l’homme qui a fait rire Domela », la grande figure du socialisme hollandais de ce temps, un ancien pasteur indéridable ? (10) C’est peut-être cette capacité à s’amuser de tout et à se jouer du sort qui dissuadera Cohen de déserter comme l’avait fait quelques années plus tôt un soldat de la même armée, un certain sieur Rimbaud. (11)
gravure de Georges Rohner illustrant In Opstand
 Le 25 décembre 1886, Alexandre Cohen fête sa libération. Il fait d’une pierre deux coups puisque son comportement a encouragé ses supérieurs à le déclarer « totalement inadaptable ». Le 27 mars 1887, de retour sur le sol natal, il est rendu à la vie civile alors qu’il a déjà décidé de tenter sa chance dans les milieux journalistiques. (12) Et six mois jour pour jour après ce Noël mémorable, l’intraitable rebelle fait son entrée dans la presse. Du 25 juin au 13 août 1887, le Groninger weekblad (L’Hebdomadaire de Groningue) (13) publie en sept livraisons un de ses textes sous le titre Naar Indië (Aux Indes Néerlandaises). Le gouvernement néerlandais opérait alors une campagne de recrutement pour renforcer son armée coloniale chahutée sur le terrain ; Cohen réagit sans attendre et le journal radical accepte d’ouvrir ses colonnes aux premiers élans du talentueux polémiste. Dans les pages en question, il décortique la brochure ministérielle, s’appuie sur sa propre expérience pour en dénoncer l’aspect « criminel » et conclut en en appelant à la violence pour faire triompher la volonté populaire. En traitant d’un thème et d’une région du monde qui ont rendu célèbre Multatuli, en maniant un style foisonnant et vif – certes pas encore toujours maîtrisé – sans éprouver de gêne à se mettre en avant, il marche sur les traces de son modèle. (14)
Le 25 décembre 1886, Alexandre Cohen fête sa libération. Il fait d’une pierre deux coups puisque son comportement a encouragé ses supérieurs à le déclarer « totalement inadaptable ». Le 27 mars 1887, de retour sur le sol natal, il est rendu à la vie civile alors qu’il a déjà décidé de tenter sa chance dans les milieux journalistiques. (12) Et six mois jour pour jour après ce Noël mémorable, l’intraitable rebelle fait son entrée dans la presse. Du 25 juin au 13 août 1887, le Groninger weekblad (L’Hebdomadaire de Groningue) (13) publie en sept livraisons un de ses textes sous le titre Naar Indië (Aux Indes Néerlandaises). Le gouvernement néerlandais opérait alors une campagne de recrutement pour renforcer son armée coloniale chahutée sur le terrain ; Cohen réagit sans attendre et le journal radical accepte d’ouvrir ses colonnes aux premiers élans du talentueux polémiste. Dans les pages en question, il décortique la brochure ministérielle, s’appuie sur sa propre expérience pour en dénoncer l’aspect « criminel » et conclut en en appelant à la violence pour faire triompher la volonté populaire. En traitant d’un thème et d’une région du monde qui ont rendu célèbre Multatuli, en maniant un style foisonnant et vif – certes pas encore toujours maîtrisé – sans éprouver de gêne à se mettre en avant, il marche sur les traces de son modèle. (14)
(14) Voir cette référence à Multatuli par exemple dans J. Gans, « Alexandre Cohen tegen de macht », Het Pamflet, Weekblad tegen het publiek, integrale fotografische herdruk, P. van der Velden, Amsterdam, 1980 p. 89. Ou encore dans H. van Straten, Toen bliezen de poortwachters, proza en poëzie van 1880 tot 1920, Querido, Amsterdam, 1964, p. 60.

 Deux paradoxes dominent la vie de celle en qui Alexandre Cohen a vu une « styliste délicieuse » : alors que la politique n’était pas sa tasse de thé – elle a écrit qu’elle avait toujours refusé la lutte des classes et la haine qu’éprouvaient les « rouges » à l’égard d’une partie des hommes –, elle sera pendant quelques années membre du parti communiste (Sociaal Demokratische Partij) en raison de ses positions anticolonialistes avant d’opter pour un socialisme « religieux » proche de ce que défendait Hendrik de Man ; d’autre part, si elle cherche dans ses livres à comprendre l’âme javanaise, elle le fera en employant une prose d’un grand raffinement, inspirée du symbolisme, et selon un cadre de pensée tout à fait occidental. L’essentiel pour elle n’était pas tant de « comprendre » les Indes néerlandaises que d’en donner, dans un souci esthétique, une vision « pleine de rêverie romantique pour le pays et sa population autochtone » (A. Romein-Verschoor). Il ne fait aucun doute qu’elle a porté un grand amour et à la nature et aux gens de l’archipel.
Deux paradoxes dominent la vie de celle en qui Alexandre Cohen a vu une « styliste délicieuse » : alors que la politique n’était pas sa tasse de thé – elle a écrit qu’elle avait toujours refusé la lutte des classes et la haine qu’éprouvaient les « rouges » à l’égard d’une partie des hommes –, elle sera pendant quelques années membre du parti communiste (Sociaal Demokratische Partij) en raison de ses positions anticolonialistes avant d’opter pour un socialisme « religieux » proche de ce que défendait Hendrik de Man ; d’autre part, si elle cherche dans ses livres à comprendre l’âme javanaise, elle le fera en employant une prose d’un grand raffinement, inspirée du symbolisme, et selon un cadre de pensée tout à fait occidental. L’essentiel pour elle n’était pas tant de « comprendre » les Indes néerlandaises que d’en donner, dans un souci esthétique, une vision « pleine de rêverie romantique pour le pays et sa population autochtone » (A. Romein-Verschoor). Il ne fait aucun doute qu’elle a porté un grand amour et à la nature et aux gens de l’archipel. Quelques-uns de ses textes ont été traduits en français : la nouvelle « De Jager » (« Le chasseur ; histoire javanaise », trad. A.D.L. Mague, La Revue de Hollande, I, 1915-1916) et le court roman Orpheus in de dessa (Orphée au village, trad. E.J. Van Hasselt & Isabelle Rivière, La Revue hebdoma- daire, n° 27-28, 7et 14 juillet 1928). Dans Le Monde nouveau, Paul Eyquem a lui aussi transposé quelques pages de la nouvelliste (« Histoire du Joueur de flûte et de la belle danseuse »). En anglais, six de ses proses ont été réunies sous le titre Island India (1923).
Quelques-uns de ses textes ont été traduits en français : la nouvelle « De Jager » (« Le chasseur ; histoire javanaise », trad. A.D.L. Mague, La Revue de Hollande, I, 1915-1916) et le court roman Orpheus in de dessa (Orphée au village, trad. E.J. Van Hasselt & Isabelle Rivière, La Revue hebdoma- daire, n° 27-28, 7et 14 juillet 1928). Dans Le Monde nouveau, Paul Eyquem a lui aussi transposé quelques pages de la nouvelliste (« Histoire du Joueur de flûte et de la belle danseuse »). En anglais, six de ses proses ont été réunies sous le titre Island India (1923).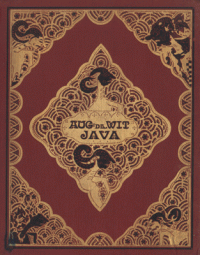 Verborgen bronnen (Sources cachées),
1899 (nouvelles tra- duites en allemand par Else Otten : Feindschaft. Das höchste Gesetz, 1903).
Verborgen bronnen (Sources cachées),
1899 (nouvelles tra- duites en allemand par Else Otten : Feindschaft. Das höchste Gesetz, 1903). Gods goochelaartjes (Les Petits Prestidigitateurs de Dieu),
1932 (récits poétiques sur les naturalistes et les papillons).
Gods goochelaartjes (Les Petits Prestidigitateurs de Dieu),
1932 (récits poétiques sur les naturalistes et les papillons).


 Adolescent déjà, il ne se mord guère la langue. Il ne sait pas encore qu’il gagnera sa vie - plutôt mal que bien ! - comme publiciste et traducteur, mais ses assertions, calquées sur son comportement, s’avèrent tranchantes. Turbulent, faisant l’école buissonnière bien longtemps avant l’introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire (1901), il forme son esprit à l’abri des regards et des reproches en dévorant des livres, perché sous le faîte du toit de la maison familiale, à Leeuwarden, en Frise. Certes, M. Cohen père, juif orthodoxe, ne désire point laisser ce fils agir à sa guise, mais Alexandre a bien souvent, et quoi qu’il lui en coûte, le dernier mot : quand le moment de la prière a sonné, Alexandre joue le jeu, mais sous couvert de lire les textes sacrés il se nourrit des pages du
Adolescent déjà, il ne se mord guère la langue. Il ne sait pas encore qu’il gagnera sa vie - plutôt mal que bien ! - comme publiciste et traducteur, mais ses assertions, calquées sur son comportement, s’avèrent tranchantes. Turbulent, faisant l’école buissonnière bien longtemps avant l’introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire (1901), il forme son esprit à l’abri des regards et des reproches en dévorant des livres, perché sous le faîte du toit de la maison familiale, à Leeuwarden, en Frise. Certes, M. Cohen père, juif orthodoxe, ne désire point laisser ce fils agir à sa guise, mais Alexandre a bien souvent, et quoi qu’il lui en coûte, le dernier mot : quand le moment de la prière a sonné, Alexandre joue le jeu, mais sous couvert de lire les textes sacrés il se nourrit des pages du « Huit jours de salle de police pour t’être abstenu de saluer un supérieur. Tu peux disposer ! » Voilà la courte harangue qui siffle aux oreilles d’Alexandre Cohen le lendemain matin au rapport. Cette peine purgée, le commis aux écritures dépose une réclamation auprès du commandant de
« Huit jours de salle de police pour t’être abstenu de saluer un supérieur. Tu peux disposer ! » Voilà la courte harangue qui siffle aux oreilles d’Alexandre Cohen le lendemain matin au rapport. Cette peine purgée, le commis aux écritures dépose une réclamation auprès du commandant de  Le 25 décembre 1886, Alexandre Cohen fête sa libération. Il fait d’une pierre deux coups puisque son comportement a encouragé ses supérieurs à le déclarer « totalement inadaptable ». Le 27 mars 1887, de retour sur le sol natal, il est rendu à la vie civile alors qu’il a déjà décidé de tenter sa chance dans les milieux journalistiques.
Le 25 décembre 1886, Alexandre Cohen fête sa libération. Il fait d’une pierre deux coups puisque son comportement a encouragé ses supérieurs à le déclarer « totalement inadaptable ». Le 27 mars 1887, de retour sur le sol natal, il est rendu à la vie civile alors qu’il a déjà décidé de tenter sa chance dans les milieux journalistiques.