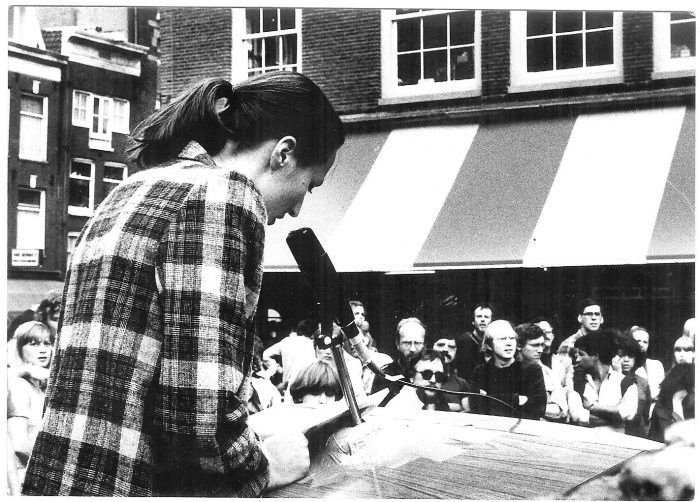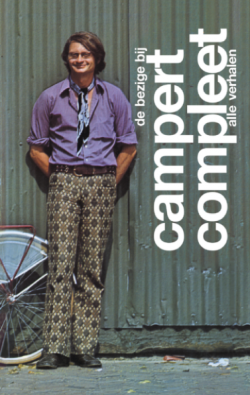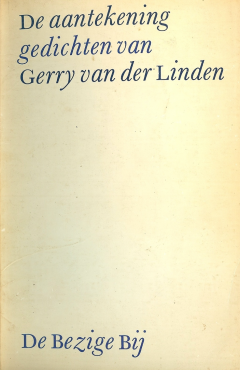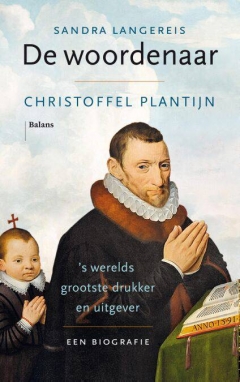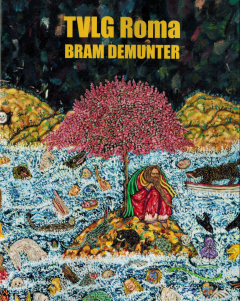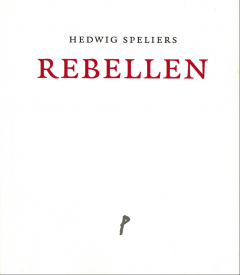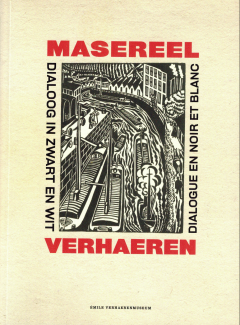MINIATUURTJES
EEN TOEVLUCHT BIJ VERMEER
miniatuurtjes van Roland Ladrière
vertaald door Benno Barnard
Roland Ladrière, L'Harmonium, Vanderkinderestraat 293, Ukkel, februari 2016 (foto MHC)
De blik is gedachte.
Herberto Helder
vooraf
Soms bevind ik me te midden van een rumoer waaraan ik me niet kan onttrekken. Mijn redding is dan dat ik me zo goed mogelijk concentreer op mijn intiemste weten. Omdat ik geen documentatie bij de hand heb, kan ik enkel vertrouwen op mijn herinneringen. Met andere woorden, ik vertrouw op de naglans van mijn netvlies. Deze miniatuurtjes zijn niet geleerd of poëtisch. Ze vallen samen met mijn ervaring op zulke ogenblikken: een antidotum tegen het razen.
De ruimte trilt van een kleurige warmte, waarin het strogeel overheerst, leeg genoeg om je blik als vanzelf op de jonge vrouw te richten. Ze is bezig haar toilet te voltooien en houdt de linten van het halssnoer dat ze wil omdoen voor altijd tussen wijsvinger en duim van haar beide handen. Ze monstert in de spiegel het effect van haar opschik... Het gebroken wit van de muur doet haar silhouet nadrukkelijk uitkomen; niet de minste wandversiering die zich tussen haar en haar weerkaatsing kan wringen. Haar blik verliest zich in een leegte die hem opzuigt. Het onvatbare vloeit voort uit de onbepaalde betekenis van haar houding. Maar vast betreft het de loutere vreugde van een mooi meisje dat weet dat ze mooi is.
 Een zuchtje ontbloeit op de karmijnrode, halfopen lippen van het Meisje met de parel en de blik in haar bruine ogen komt van zo ver... en haar gezicht steekt af tegen het donkere fond, waarin even weinig te onderscheiden valt als in de tijd zelf, met een door niets aangetaste frisheid. Het is een schitterend werkstuk, want Vermeer schildert geen model, hij schildert zijn bewondering en liefde voor een innerlijke kern.
Een zuchtje ontbloeit op de karmijnrode, halfopen lippen van het Meisje met de parel en de blik in haar bruine ogen komt van zo ver... en haar gezicht steekt af tegen het donkere fond, waarin even weinig te onderscheiden valt als in de tijd zelf, met een door niets aangetaste frisheid. Het is een schitterend werkstuk, want Vermeer schildert geen model, hij schildert zijn bewondering en liefde voor een innerlijke kern.
De parel is een zinnebeeld van schoonheid, maar ook van ijdelheid, die het verderf van wereldse goederen betekent wanneer die aanzetten tot hovaardigheid. Vanitas was een populair genre in het calvinistische Holland van de zeventiende eeuw. Op een stilleven zie je etenswaren of kostbare voorwerpen naast een ontvleesde schedel die aan de ijdelheid van alle leven herinnert.
In die geest moeten we ongetwijfeld ook kijken naar Vrouw met weegschaal. De halssnoeren, die de vorm van het juwelenkistje en de golving van de nachtblauwe stof volgen, dienen niet om het tafereeltje te verfraaien maar om de betekenis ervan te accentueren. De vrouw weegt de dingen die zij in haar leven heeft gedaan ten overstaan van datgene wat de valse waarde ervan vertegenwoordigt. Het lijkt erop dat ze geen enkele parel aan een inspectie onderwerpt, want geen enkele afzonderlijke parel ligt te wachten. De schaaltjes zijn leeg; ze wegen onstoffelijke en onzichtbare zaken. En als je erover nadenkt: dit is het enige tafereel waarop de gordijnen gesloten zijn. Vanwaar deze uitzondering bij een schilder die gespecialiseerd was in symbolen? Het is alsof dit alles geheim moet blijven, alsof we ons bevinden in een ruimte waar ons de toegang bij voorbaat ontzegd is. Een zonnestraal raakt voorbij de dikke gordijnstof die haar van de wereld scheidt. Die straal onderzoekt de donkere kamer, zoals zijzelf misschien in de diepte van haar ziel tuurt.
 Rond Vermeer is er een stralenkrans van koel water waar een milde zon in sluimert. Dat licht is als gefilterd, nooit agressief. Het verleent zijn harmonie aan die ongrijpbare personages die Vermeer betrapt in hun bezigheden: een jonge vrouw aan het virginaal draait haar frisse gezichtje naar ons toe; een andere jonge vrouw, gekleed in gele zijde en hermelijn, speelt gitaar; een derde, helemaal in het blauw, leest de brief die een geliefde haar gestuurd heeft; en dan is er nog een jonge vrouw met halfopen lippen en een buitenmaatse parel in haar oor, die en trois quarts haar tijdeloze blik laat zien. Het is alsof zij uit de diepte van de tijd te voorschijn komt. En hier is een hoge trapgevel. Een naaister is vlak achter de drempel verdiept in haar werk. Twee kinderen zitten zoet te spelen op de stoep. Deze muur verbergt een wereld en het is aan de verbeelding daarin binnen te dringen.
Rond Vermeer is er een stralenkrans van koel water waar een milde zon in sluimert. Dat licht is als gefilterd, nooit agressief. Het verleent zijn harmonie aan die ongrijpbare personages die Vermeer betrapt in hun bezigheden: een jonge vrouw aan het virginaal draait haar frisse gezichtje naar ons toe; een andere jonge vrouw, gekleed in gele zijde en hermelijn, speelt gitaar; een derde, helemaal in het blauw, leest de brief die een geliefde haar gestuurd heeft; en dan is er nog een jonge vrouw met halfopen lippen en een buitenmaatse parel in haar oor, die en trois quarts haar tijdeloze blik laat zien. Het is alsof zij uit de diepte van de tijd te voorschijn komt. En hier is een hoge trapgevel. Een naaister is vlak achter de drempel verdiept in haar werk. Twee kinderen zitten zoet te spelen op de stoep. Deze muur verbergt een wereld en het is aan de verbeelding daarin binnen te dringen.
 Het Gezicht op Delft laat niets zien van de commerciële en buitengaatse drukte die Holland tot een koningin van de zeeën kroonde. Een paar wandelaars maken bij het ochtendgloren een praatje op de kaaien, waar aangemeerde boten liggen te dutten. Het water is een diepte waarin je je verliest. Op de achtergrond rekt de stad de schaduwbeelden van haar daken en torens uit, terwijl de dag plotseling een hele stadswijk aan de rechterkant in zijn goud dompelt. De dakpannen variëren van karmijnrood, vermengd met een zandkleur, tot blauw met een fonkeling van diamant en geel met een zweem van oranje. Het is tien over zeven op de wijzerplaat van de Stadspoort…
Het Gezicht op Delft laat niets zien van de commerciële en buitengaatse drukte die Holland tot een koningin van de zeeën kroonde. Een paar wandelaars maken bij het ochtendgloren een praatje op de kaaien, waar aangemeerde boten liggen te dutten. Het water is een diepte waarin je je verliest. Op de achtergrond rekt de stad de schaduwbeelden van haar daken en torens uit, terwijl de dag plotseling een hele stadswijk aan de rechterkant in zijn goud dompelt. De dakpannen variëren van karmijnrood, vermengd met een zandkleur, tot blauw met een fonkeling van diamant en geel met een zweem van oranje. Het is tien over zeven op de wijzerplaat van de Stadspoort…
Dergelijke beelden wekken eindeloze dromen. Je moet ze lang bekijken, met je ogen soms half gesloten, om de contrasten beter te kunnen onderscheiden. Het zijn hoogsels, gekleurde lagen die maken dat de dichtheid overal op het doek verschilt; doorschijnende cirkels (spijkers, stoelen met leeuwenkopjes, glazen en aardewerk) die uit de camera obscura zijn komen opduiken. Deze taferelen, voor altijd verloren en toch bewaard gebleven, zijn het beste van de huivering. Of zoals Bonnefoy zegt: ‘De fuga, het onachterhaalbaar meegevoerde, is het moment waarop de wereld poëzie wordt.’
 oorspronkelijk gepubliceerd in
oorspronkelijk gepubliceerd in
AFIN QUE L’OMBRE ÉCLAIRE.
Sur la poésie de Roland Ladrière,
sous la direction de Judith Alvarado-Migeot et François Migeot, L’Atelier du Grand Tétras, 2025, p. 87-100.
Benno Barnard, Parijs, juni 2019 (foto AV)