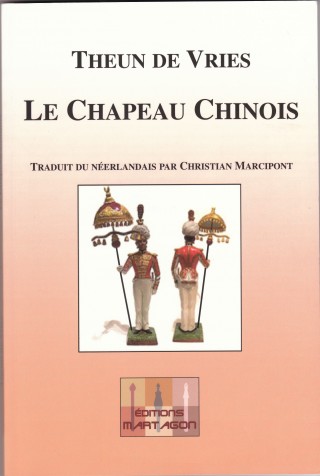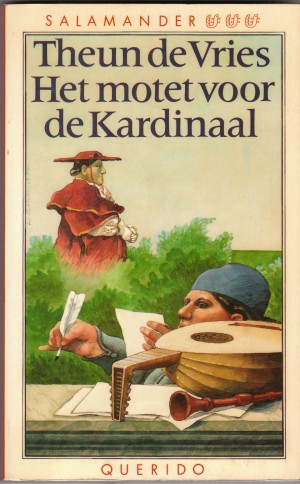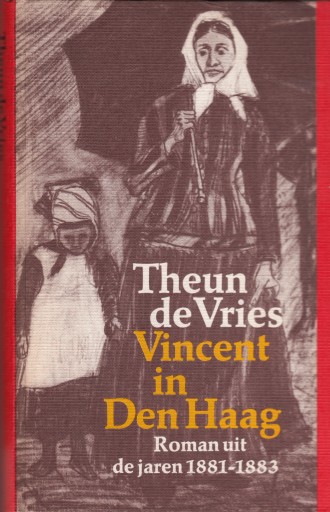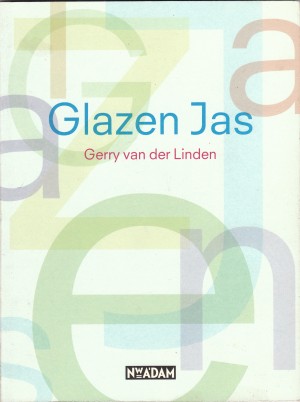L’enfant qui vous fait naître
L’Enfant ombre, de P.F. Thomése
« Conçu le matin de Pâques 1957 et né à Doetichem le 23 janvier 1958 comme descendant fortuit d’une vieille lignée pour ainsi dire éteinte. Père distrait, mère folle. » C’est en ces termes que Pieter Frans Thomése se présente sur son site avant de préciser : « Le nom Thomèse vient de France ; il appartenait entre autres à l’orfèvre Maître Albert de Thomése, protestant qui, après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, dû fuir ; ayant trouvé refuge à La Haye, il devint, grâce à ses œuvres de facture classique, un fournisseur attitré de la Cour. »
Thomése est l’auteur d’une dizaine de livres (romans, nouvelles, « autobiographies »…). Un de ses romans est basé sur l’histoire d’Etta Palm, baronne d’Aelders. Son dernier titre : J. Kessels : The novel (Contact, 2009), moitié road novel , moitié roman pulp hilarant.
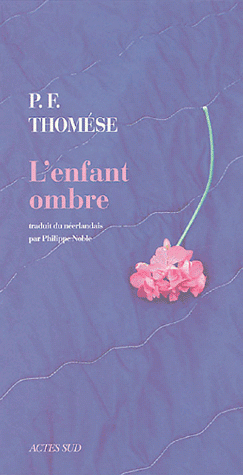
L’Enfant ombre, trad. Ph. Noble, Actes Sud, 2004
En près de cinquante passages, de 3 à 4 lignes pour les plus courts et de plus de deux pages pour les plus longs, le romancier P.F. Thomése tente de combler par l’écriture – tentative qu’il sait vouée à l’échec – la béance laissée par la mort de sa petite fille âgée de quelques semaines.
Pour une part, ces évocations fragmentaires restituent un peu des circonstances qui ont précédé le décès de l’enfant (naissance, hospitalisation…) et des scènes qui l’ont suivi (la chambre vide de l’enfant, les vêtements et autres objets inutiles…). Mais ni la chronologie ni les données factuelles ne sont le souci réel de l’auteur : on n’apprend que bien peu de choses sur le déroulement des événements. D’ailleurs, le prénom de l’enfant est l’une des rares données concrètes dont nous disposions. Ce qui importe bien plus ici, c’est ce qui reste à un père écrivain à qui il ne semble finalement rien rester, pas même la foi en l’œuvre d’art ; encore subjugué par la naissance de sa fille – une « révélation » – qui l’a en réalité fait naître lui, il doit encaisser sa disparition. Non pas imaginer l’impossible, mais le vivre, l’endurer. Endurer la mort de celle qui venait à peine de le faire naître, de celle qui lui a donné un nouveau regard sur la vie. Vivre la mort qui échappe à tout, y compris aux mots, car, à la différence du reste, la mort échappe à la répétition.
 Dans une langue soignée, belle, épurée par endroits, Thomése brosse un tableau aussi complet que possible des sentiments qui l’habitent, de ceux aussi qui l’ont habité dès la naissance de Lisa. Bonheur radicalement nouveau, incompréhension, refus de voir la fatalité en face, désespérance… Son monde intérieur parle, nous parle d’autant plus que c’est là que l’enfant devait « vivre » tant qu’elle n’était pas en âge de comprendre : le papa s’était en effet préparé à tout observer, à tout écouter pour le bébé qu’elle était de manière à pouvoir lui raconter tout cela un jour. Lui qui s’apprêtait sans doute à écrire pour sa fille tout ce qu’elle vivait sans en être encore consciente, à écrire pour elle tout ce qu’elle permettait de vivre à ses parents transfigurés, le voilà condamné à écrire pour que la petite défunte lui échappe un tout petit peu moins vite, alors qu’elle s’est déjà échappée, alors que dans sa douleur, il en arrive à douter qu’elle a jamais été. Elle, celle qui n’aura été qu’une ombre.
Dans une langue soignée, belle, épurée par endroits, Thomése brosse un tableau aussi complet que possible des sentiments qui l’habitent, de ceux aussi qui l’ont habité dès la naissance de Lisa. Bonheur radicalement nouveau, incompréhension, refus de voir la fatalité en face, désespérance… Son monde intérieur parle, nous parle d’autant plus que c’est là que l’enfant devait « vivre » tant qu’elle n’était pas en âge de comprendre : le papa s’était en effet préparé à tout observer, à tout écouter pour le bébé qu’elle était de manière à pouvoir lui raconter tout cela un jour. Lui qui s’apprêtait sans doute à écrire pour sa fille tout ce qu’elle vivait sans en être encore consciente, à écrire pour elle tout ce qu’elle permettait de vivre à ses parents transfigurés, le voilà condamné à écrire pour que la petite défunte lui échappe un tout petit peu moins vite, alors qu’elle s’est déjà échappée, alors que dans sa douleur, il en arrive à douter qu’elle a jamais été. Elle, celle qui n’aura été qu’une ombre.
L’évocation profite parfois d’une citation pour approfondir un thème (sens d’une vie aussi brève, naissance/mort, le silence, les parents/le reste du monde…). Thomése convie ainsi en passant la mythologie ou encore plusieurs artistes, écrivains ou musiciens qui ont retenu comme motif ou thème la mort d’un fils ou d’une fille. Et qui à l’instar d’un Flaubert, d’un Goethe n’ont pas toujours su être authentiques. Un « nous » s’immisce parfois dans le texte qui restitue de manière émouvante ce qui lie le couple. Thomése explore aussi la façon dont il vit cette expérience du deuil en revenant sur le décès de son père, décès qu’il avait vécu de manière radicalement différente.
Ce livre sur la mort est d’autant plus poignant qu’il laisse voir combien la naissance d’un enfant fonde le père et la mère. Même si l’on sent ce père à vif, même si la blessure est béante, même si chaque mot ensevelit un peu plus le petit cadavre, on découvre un texte très mesuré.
Tout en travaillant à ce livre, P.F. Thomése a écouté J.S. Bach (Das wohltemperierte Klavier), Bill Evans (Waltz for Debby), Paul Bley (Open, to love), Federico Mompou (Musica callada), Charlie Parker (With Strings).



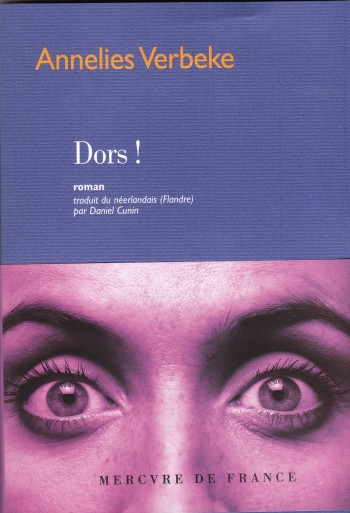
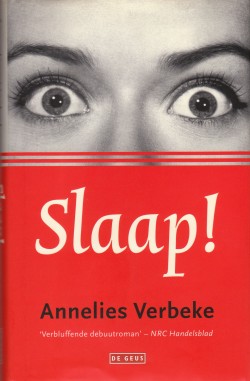 Tout au long de son premier roman, Annelies Verbeke a recours en alternance à deux narrateurs, Maya et Benoît. Chacun évoque à son tour son malaise, ce qu’il vit, parfois aussi une partie de son passé, comme dans le chapitre 2 où Benoît brosse un tableau de son enfance à la fois cruel et somptueux. L’auteur réussit en fait à coupler deux personnages (qui figuraient à l’origine, l’un dans une nouvelle, l’autre dans un scénario), l’alternance des chapitres illustrant l’aspect ambigu de leur relation : ils sont certes un soutien l’un pour l’autre, mais en même temps, ce qu’ils vivent ensemble repose sur une méconnaissance totale de l’autre.
Tout au long de son premier roman, Annelies Verbeke a recours en alternance à deux narrateurs, Maya et Benoît. Chacun évoque à son tour son malaise, ce qu’il vit, parfois aussi une partie de son passé, comme dans le chapitre 2 où Benoît brosse un tableau de son enfance à la fois cruel et somptueux. L’auteur réussit en fait à coupler deux personnages (qui figuraient à l’origine, l’un dans une nouvelle, l’autre dans un scénario), l’alternance des chapitres illustrant l’aspect ambigu de leur relation : ils sont certes un soutien l’un pour l’autre, mais en même temps, ce qu’ils vivent ensemble repose sur une méconnaissance totale de l’autre.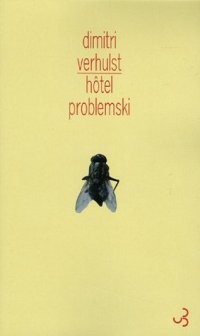
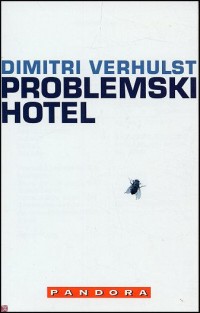 Parmi les personnages évoqués, on relève Igor, le « boxeur » ukrainien avec qui Bipul Masli partage sa chambre bien malgré lui : il craint que ce taciturne ne le tue un jour dans un accès de colère ; Maqsood qui vient du Cachemire et qui cherche par tous les moyens à rencontrer une femme belge afin de l’épouser et d’ainsi obtenir le droit de rester en Europe ; Sedi qui vient du pays où il fait le moins bon vivre, le Sierra Leone ; Martina qui accouche d’un enfant qu’elle ne veut pas garder car il a été conçu le jour où elle a été violée par trois Albanais : il faut que l’accouchement se passe à l’insu de l’administration, un Albanais a été chargé (contre de l’argent et des cigarettes) d’éliminer le bébé, mais c’est finalement la mère qui sera la seule à avoir le courage d’étrangler le nouveau-né ; Shaukat, le musulman dont la femme a demandé à être placée dans un autre centre afin d’échapper à son mari machiste et violent ; Lidia, une adolescente devenue la maîtresse de Bipul, qui tente le tout pour le tout à la Noël en s’échappant du centre pour tenter de gagner l’Angleterre dans un container…
Parmi les personnages évoqués, on relève Igor, le « boxeur » ukrainien avec qui Bipul Masli partage sa chambre bien malgré lui : il craint que ce taciturne ne le tue un jour dans un accès de colère ; Maqsood qui vient du Cachemire et qui cherche par tous les moyens à rencontrer une femme belge afin de l’épouser et d’ainsi obtenir le droit de rester en Europe ; Sedi qui vient du pays où il fait le moins bon vivre, le Sierra Leone ; Martina qui accouche d’un enfant qu’elle ne veut pas garder car il a été conçu le jour où elle a été violée par trois Albanais : il faut que l’accouchement se passe à l’insu de l’administration, un Albanais a été chargé (contre de l’argent et des cigarettes) d’éliminer le bébé, mais c’est finalement la mère qui sera la seule à avoir le courage d’étrangler le nouveau-né ; Shaukat, le musulman dont la femme a demandé à être placée dans un autre centre afin d’échapper à son mari machiste et violent ; Lidia, une adolescente devenue la maîtresse de Bipul, qui tente le tout pour le tout à la Noël en s’échappant du centre pour tenter de gagner l’Angleterre dans un container…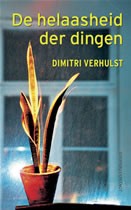 Dans une brève postface, l’auteur nous dit qu’il a passé quelques jours dans un centre de réfugiés en Flandre et que si la moitié des histoires qu’il raconte sont inventées, aucune ne contient le moindre mensonge. Pour rendre la misère et la violence qui sont le quotidien de ces gens ne parlant pas le néerlandais, n’ayant pas de quoi se vêtir, vivant dans la plus grande promiscuité avec des individus venant d’un autre monde, d’une autre culture, il a choisi de se glisser dans la peau d’un personnage (Bipul Masli) qui vit et observe de l’intérieur, et non sans humour, le sort de ces gens qui n’ont plus qu’une chose à laquelle se raccrocher : le mot England.
Dans une brève postface, l’auteur nous dit qu’il a passé quelques jours dans un centre de réfugiés en Flandre et que si la moitié des histoires qu’il raconte sont inventées, aucune ne contient le moindre mensonge. Pour rendre la misère et la violence qui sont le quotidien de ces gens ne parlant pas le néerlandais, n’ayant pas de quoi se vêtir, vivant dans la plus grande promiscuité avec des individus venant d’un autre monde, d’une autre culture, il a choisi de se glisser dans la peau d’un personnage (Bipul Masli) qui vit et observe de l’intérieur, et non sans humour, le sort de ces gens qui n’ont plus qu’une chose à laquelle se raccrocher : le mot England.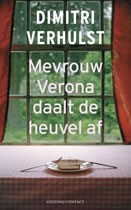 somalien proche de la mort ; il sentait qu’il était à deux doigt de réussir une photo qui allait faire le tout du monde, encore fallait-il qu’une mouche se pose sur le visage du moribond. À la fin du livre, c’est lui qui doit cette fois se soumettre aux caprices d’un photographe : dans sa piteuse chambre du centre de réfugiés, un journaliste venu faire un reportage souhaite le prendre en photo devant la fenêtre ; il n’appuiera sur le bouton de son appareil qu’au moment où une mouche viendra se poser sur le visage de Bipul Masli.
somalien proche de la mort ; il sentait qu’il était à deux doigt de réussir une photo qui allait faire le tout du monde, encore fallait-il qu’une mouche se pose sur le visage du moribond. À la fin du livre, c’est lui qui doit cette fois se soumettre aux caprices d’un photographe : dans sa piteuse chambre du centre de réfugiés, un journaliste venu faire un reportage souhaite le prendre en photo devant la fenêtre ; il n’appuiera sur le bouton de son appareil qu’au moment où une mouche viendra se poser sur le visage de Bipul Masli. Écrire pour ne pas oublier –
Écrire pour ne pas oublier –
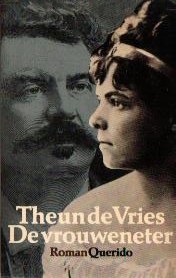 domaine, sa production pléthorique ne peut être comparée qu’à celle de son ami
domaine, sa production pléthorique ne peut être comparée qu’à celle de son ami