Lézardes immémoriales
Le romancier
Karel Schoeman
 Karel Schoeman est sans conteste l’un des plus grands écrivains africains. Il a été tour à tour bibliothécaire (à Amster- dam), infirmier (à Glasgow) et archiviste (au Cap). Le lecteur qui n’est pas familier de l’afrikaans a aujourd’hui accès à un certain nombre de ses œuvres de fiction en français : il s’agit, outre En étrange pays (traduit par Jean Guiloineau à partir de la traduction anglaise), de quatre romans ainsi que de trois nouvelles traduits par Pierre-Marie Finkelstein. L’amateur d’histoire pourra se reporter aux titres que l’écrivain a écrits en anglais. L’œuvre majeure de Schoeman est sans doute Die laaste Afrikaanse boek, un document autobiographique de 700 pages dans lequel l’auteur explore son parcours intellectuel, artistique et spirituel ainsi que son époque. Relevons que le Sud-Africain a donné des romans au cœur desquels il a placé de grandes figures de l’art européen : Shakespeare, Rembrandt, Beethoven et Le Titien.
Karel Schoeman est sans conteste l’un des plus grands écrivains africains. Il a été tour à tour bibliothécaire (à Amster- dam), infirmier (à Glasgow) et archiviste (au Cap). Le lecteur qui n’est pas familier de l’afrikaans a aujourd’hui accès à un certain nombre de ses œuvres de fiction en français : il s’agit, outre En étrange pays (traduit par Jean Guiloineau à partir de la traduction anglaise), de quatre romans ainsi que de trois nouvelles traduits par Pierre-Marie Finkelstein. L’amateur d’histoire pourra se reporter aux titres que l’écrivain a écrits en anglais. L’œuvre majeure de Schoeman est sans doute Die laaste Afrikaanse boek, un document autobiographique de 700 pages dans lequel l’auteur explore son parcours intellectuel, artistique et spirituel ainsi que son époque. Relevons que le Sud-Africain a donné des romans au cœur desquels il a placé de grandes figures de l’art européen : Shakespeare, Rembrandt, Beethoven et Le Titien.
En 2002, Retour au pays bien-aimé a fait l’objet d’une adaptation cinématographique signée Jason Xenopoulos : Promised Land.
À l’occasion de la parution chez Phébus du roman Des voix parmi les ombres, Karel Schoeman, homme très discret, a donné un entretien à la revue Transfuge (n° 81). C’est ce roman que commente pour nous Pierre Monastier.
Une lecture de Des voix parmi les ombres
(pdf)
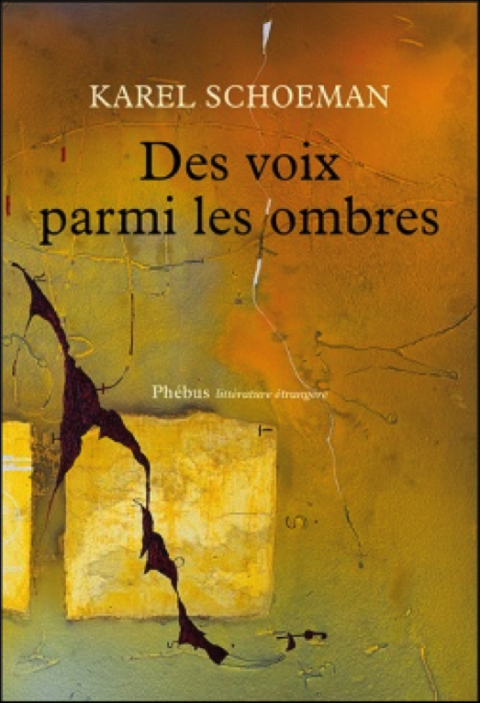
traduit de l'afrikaans par Pierre-Marie Finkelstein, Phébus, 2014
Puisque la mode est aux prix littéraires en tous genres, j’y ajoute sans complexe le mien : Karel Schoeman se voit attribuer le « Prix Monastier de la découverte 2014 ». Il succède ainsi, dans mon « pangraphon » si personnel, à l’Allemand Ernest Wiechert (2013) et au Français Vincent La Soudière (2012). Certains me reprocheront peut-être de retarder quelque peu, l’écrivain sud-africain, né dans l’État libre d’Orange en octobre 1939, ayant commencé à publier dès les années 1960. Oui, je retarde, et non sans délices, puisque la somme des auteurs lus cette année ne me laissait pas présager une telle rencontre : la plume trempée de lumière spirituelle d’un Claude-Henri Rocquet et l’angoisse réflexive en attente d’engendrement d’un Willem Jan Otten, pour ne citer que les deux auteurs déjà abordés en ce lieu, ont suscité l’enthousiasme, tantôt de l’intelligence, tantôt du cœur ; ils accompagnent tout être pétri d’une quête existentielle, de la recherche de sens au milieu des dédales effrités d’un monde qui meurt de sa fausse tolérance.
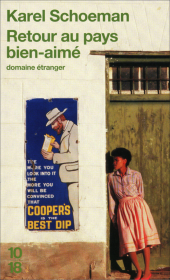 Karel Schoeman, lui, n’enthousiasme pas ; il n’accompagne pas. Il détruit nos barrières mentales pour nous placer dans un univers qui ne permet – du moins pas immédiatement – aucune réflexion, qui n’autorise aucun retour sur soi, qui ne tolère aucun garde-fou ; il n’est nulle appréciation, au détour d’une ligne, qui nous permettrait de ne pas sombrer. Alors nous sombrons, engloutis par ce trop-plein de liberté auquel nous ne sommes plus accoutumés. L’écrivain ne force pas notre jugement : il montre, dévoile, souligne, décrit, contemple… Nous aurions apprécié l’un ou l’autre avis, ne serait-ce qu’une brève indication « sur qui sontles gentils et les méchants », ceux pour qui nous devons prendre parti et ceux qu’il nous faut détester avec la sûreté du bourgeois replet de ses certitudes préfabriquées. Mais il n’est d’autre parti que celui des hommes, des vivants et des morts, plus souvent encore de ces êtres qui réunissent en leur chair ridée, dans leurs voix brésillées, lointaines, comme disparues, quand elles résonnent encore, miraculeusement, telle celle de la femme sans âge parce que trop vieille, mourante et effroyablement seule de Cette vie, qui réunissent – disais-je – la mémoire ancestrale et l’éphémère présent. Liberté nous a été rendue.
Karel Schoeman, lui, n’enthousiasme pas ; il n’accompagne pas. Il détruit nos barrières mentales pour nous placer dans un univers qui ne permet – du moins pas immédiatement – aucune réflexion, qui n’autorise aucun retour sur soi, qui ne tolère aucun garde-fou ; il n’est nulle appréciation, au détour d’une ligne, qui nous permettrait de ne pas sombrer. Alors nous sombrons, engloutis par ce trop-plein de liberté auquel nous ne sommes plus accoutumés. L’écrivain ne force pas notre jugement : il montre, dévoile, souligne, décrit, contemple… Nous aurions apprécié l’un ou l’autre avis, ne serait-ce qu’une brève indication « sur qui sontles gentils et les méchants », ceux pour qui nous devons prendre parti et ceux qu’il nous faut détester avec la sûreté du bourgeois replet de ses certitudes préfabriquées. Mais il n’est d’autre parti que celui des hommes, des vivants et des morts, plus souvent encore de ces êtres qui réunissent en leur chair ridée, dans leurs voix brésillées, lointaines, comme disparues, quand elles résonnent encore, miraculeusement, telle celle de la femme sans âge parce que trop vieille, mourante et effroyablement seule de Cette vie, qui réunissent – disais-je – la mémoire ancestrale et l’éphémère présent. Liberté nous a été rendue.
Retarder pour mieux accueillir… Accueillir le flot tumultueux des sensations qui fouette le visage du lecteur, qui brûle d’éclats de poussière ses yeux effrayés, qui envahit impitoyablement l’étroite cavité de ses esgourdes, qui s’engouffre dans son palais embrasé comme un torrent de boue et de sang, qui couvre de sueur et de métal sa peau fébrile et soudainement vulnérable. Accueillir enfin le silence du veld où il s’est peut-être passé quelque chose, qui sait ?, mais où le temps s’est définitivement arrêté, et même la grande histoire, celle qui n’a pas d’éclat, parce qu’essentiellement façonnée à partir de la glaise du quotidien.
*
* *
 Comment est-il possible qu’un pays ayant connu de telles vicissitudes puisse provoquer pareil ennui ? Les deux protagonistes qui ouvrent le roman Des voix parmi les ombres, paru en français à la fin du mois d’août dernier, sont progres- sivement happés par une lancinante torpeur, à mesure qu’ils passent indifféremment de village en village, en quête d’une information ou d’un cliché, pour les besoins d’un ouvrage historique qui leur a été com- mandé. Ils ne savent pas regarder : le passé n’a pour eux de valeur que dans la figure de ce jeune héros, Giel Fourie, mort à 21 ans dans une bataille à la sortie de son village au nom inspiré de ses ancêtres, Fouriesfontein. Mais en fait d’héroïsme, l’histoire nous révèle que Giel n’est qu’un fils arrogant de bonne famille, que le village n’est qu’un bourg perdu dans un veld à perte de vue, que la bataille a eu lieu au col de Vaalberg et non à Fouriesfontein, et qu’il ne s’agit même pas d’une bataille, mais d’une escarmouche aussi anecdotique que vaine. Il n’y a rien à raconter sur Fouriesfontein. Il n’y avait rien à en dire… La mythologie a su faire son œuvre : la légende du jeune héros a pris forme, masquant que tout est petit et médiocre à Fouresfontein, sauf la vie battante.
Comment est-il possible qu’un pays ayant connu de telles vicissitudes puisse provoquer pareil ennui ? Les deux protagonistes qui ouvrent le roman Des voix parmi les ombres, paru en français à la fin du mois d’août dernier, sont progres- sivement happés par une lancinante torpeur, à mesure qu’ils passent indifféremment de village en village, en quête d’une information ou d’un cliché, pour les besoins d’un ouvrage historique qui leur a été com- mandé. Ils ne savent pas regarder : le passé n’a pour eux de valeur que dans la figure de ce jeune héros, Giel Fourie, mort à 21 ans dans une bataille à la sortie de son village au nom inspiré de ses ancêtres, Fouriesfontein. Mais en fait d’héroïsme, l’histoire nous révèle que Giel n’est qu’un fils arrogant de bonne famille, que le village n’est qu’un bourg perdu dans un veld à perte de vue, que la bataille a eu lieu au col de Vaalberg et non à Fouriesfontein, et qu’il ne s’agit même pas d’une bataille, mais d’une escarmouche aussi anecdotique que vaine. Il n’y a rien à raconter sur Fouriesfontein. Il n’y avait rien à en dire… La mythologie a su faire son œuvre : la légende du jeune héros a pris forme, masquant que tout est petit et médiocre à Fouresfontein, sauf la vie battante.
Mais comment décrire en un livre académique cette pulsation vitale qui ne tolère pas le figement du manuel d’histoire ? Comment appréhender le passé, y compris celui de l’invisible village de Fouriesfontein, après le déchirement sanglant, irréversible, de tout un pays ? Comment entrer dans ce passé qui « est un autre pays : quelle est la route qui y mène ? » Telle est la première phrase du roman, une interrogation frontale, à laquelle nous revenons sans cesse, au fil des pages. Là où l’universitaire échoue, le romancier se déploie, dans une confidence à son hôte indiscernable, apprenti historien ou fils d’une génération décimée, narrateur ou lecteur.
 « Un abîme te sépare de cette lointaine réalité, mais les abîmes peuvent être franchis une fois que l’on a trouvé la route ; une paroi de verre te sépare inexorablement du monde qui s’étend devant tes yeux, mais sous tes doigts qui tâtonnent, elle peut soudain se fissurer, telle une couche de glace, et voler en éclats. Étonné, tu t’aperçois non sans un certain effroi que les lézardes, formant une toile d’araignée, courent sur la surface lisse et que les éclats vibrent, se défont et dégringolent sans un bruit dans l’obscurité pour ne plus laisser que le cadre vide grâce auquel tu pourras passer de l’autre côté sans prêter attention aux quelques fragments qui y collent encore, ni te préoccuper de leur tranchant. Là, tu pourras commencer. »
« Un abîme te sépare de cette lointaine réalité, mais les abîmes peuvent être franchis une fois que l’on a trouvé la route ; une paroi de verre te sépare inexorablement du monde qui s’étend devant tes yeux, mais sous tes doigts qui tâtonnent, elle peut soudain se fissurer, telle une couche de glace, et voler en éclats. Étonné, tu t’aperçois non sans un certain effroi que les lézardes, formant une toile d’araignée, courent sur la surface lisse et que les éclats vibrent, se défont et dégringolent sans un bruit dans l’obscurité pour ne plus laisser que le cadre vide grâce auquel tu pourras passer de l’autre côté sans prêter attention aux quelques fragments qui y collent encore, ni te préoccuper de leur tranchant. Là, tu pourras commencer. »
Franchir la barrière qui nous sépare du passé nécessite de faire taire l’intelligence, cette voix qui dissèque, analyse, recompose et interprète sans fin, selon les présupposés du moment. Il faut entrer dans la mémoire collective comme dans Fouriesfontein, village suspendu dans le temps, lequel ?, dans un à-venir qui ne viendra jamais ; comme cet homme dont nous ne connaissons pas le nom – lui aussi, avalé par l’Histoire, quand il se croyait encore au présent – et qui y pénètre inconsciemment, sous le mode de l’hallucination, et qui ne sait plus que regarder, écouter, goûter, sentir, toucher ce lieu qui lui échappe à chaque pas.
« Une division arbitraire du paysage en deux plans morts, ciel bleu, terre grise, en deux moitiés arbitraires de chaque côté de la route : c’est tout ce que l’on peut espérer restituer. La chaleur, la poussière, l’éclat du bois ou du métal dans la main, les gouttes de sueur dans les yeux et la poussière dans la gorge, le sifflement des balles, les balles qui ricochent sur les pierres et la mort soudaine, cela, aucun film, aucune photo ne peut le rendre. Les yeux injectés de sang, le sang qui gargouille dans la gorge. Cela, personne ne le saura jamais. »
 Tout est indistinct, brouillé, confus… Des bruits sans images succèdent aux apparitions sans échos. L’homme ignore où il se trouve. Ce n’est qu’à la suite d’une longue errance que les premiers renseignements sur la ville sont donnés, premières voix filtrant des tombes d’un cimetière figé à l’aube du XXe siècle. Incertitude de temps et incertitude de lieu, auxquelles vient s’ajouter une incertitude de faits et de gestes, à mesure que les silhouettes émergent de l’obscurité devant l’homme égaré, pour s’évanouir aussitôt.
Tout est indistinct, brouillé, confus… Des bruits sans images succèdent aux apparitions sans échos. L’homme ignore où il se trouve. Ce n’est qu’à la suite d’une longue errance que les premiers renseignements sur la ville sont donnés, premières voix filtrant des tombes d’un cimetière figé à l’aube du XXe siècle. Incertitude de temps et incertitude de lieu, auxquelles vient s’ajouter une incertitude de faits et de gestes, à mesure que les silhouettes émergent de l’obscurité devant l’homme égaré, pour s’évanouir aussitôt.
« Il comprend que l’important, ce sont les événements passés ou à venir et non le jour, la date ou l’heure, que ce sont le lever du jour et le chant du coq qui annoncent le commencement de cette nouvelle journée, non la position, purement fortuite, des aiguilles. »
Un jardinier le frôle, un boiteux marche vers lui pour soudainement disparaître, les femmes s’ébattent, une jeune fille chante… Autant de personnages qu’il observe sans interférer – mais qui donc est en mesure d’interférer avec ce passé à la fois si dense et impalpable ? Et tous lui apparaissent lointains : « les femmes s’interpellent en riant, leurs voix lui parviennent assourdies comme si elles venaient de très loin bien qu’il soit tout près d’elles » ; « il l’entend chanter, sa voix semble venir de loin comme s’ils étaient séparés par une vitre, bien que la fenêtre entre eux soit ouverte… » Car ces voix ne sont plus, mais elles résonnent encore, de leur lieu obscur, inconcevable de mémoire d’homme… des voix sans ténèbres… mais des voix parmi les ombres…
*
* *
 Lieu et temps se replient progressivement en une atemporalité qui estompe jusqu’au narrateur lui même, devenu incertain à son tour : le « il » devient « je » sans que nous sachions précisément qui parle. L’homme s’est fondu dans l’épaisse chair de ce lieu pourtant inconséquent. Il n’est plus qu’une voix neutre, blanche, une voix parmi d’autres, qui s’interroge jusqu’à l’absurde, avec cette même question, posée encore et encore, à mesure qu’il prend conscience de l’inanité des faits advenus à Fouriesfontein : « Mais pour qui est-elle importante, la bataille du col du Vaalberg, ou de Fouriesfontein ? » Pour personne. Même les anciens ont oublié.
Lieu et temps se replient progressivement en une atemporalité qui estompe jusqu’au narrateur lui même, devenu incertain à son tour : le « il » devient « je » sans que nous sachions précisément qui parle. L’homme s’est fondu dans l’épaisse chair de ce lieu pourtant inconséquent. Il n’est plus qu’une voix neutre, blanche, une voix parmi d’autres, qui s’interroge jusqu’à l’absurde, avec cette même question, posée encore et encore, à mesure qu’il prend conscience de l’inanité des faits advenus à Fouriesfontein : « Mais pour qui est-elle importante, la bataille du col du Vaalberg, ou de Fouriesfontein ? » Pour personne. Même les anciens ont oublié.
« Ils [les vieillards] ne s’intéressent plus à rien, ils ont oublié, sacrifié le passé, et le fait de les forcer à se souvenir de quelque chose qui a pu jadis avoir une certaine importance, mais qui leur a échappé, leur fait sentir qu’ils ont, d’une certaine manière, failli à leur devoir, si bien qu’ils deviennent de plus en plus agressifs et réagissent par l’esquive. »
« Mais pour qui est-elle importante, la bataille du col du Vaalberg, ou de Fouriesfontein ? » Pour personne. Car les témoins sont morts ; il ne reste que ceux qui ne savent rien en dire. Alors sur quoi écrire ? Est-il seulement possible de faire œuvre d’historien sans avoir de matière concrète : une bonne grosse bataille, un fait héroïque, la témérité d’un jeune homme fauché à la fleur de l’âge, un mythe à transmettre d’une génération à l’autre… ? Mais les vieux ne transmettent plus, car ils savent la terrible vérité : le reflux des armées n’a guère laissé de héros sur le rivage, seulement des victimes à foison. Ce qu’ils ignorent en revanche, c’est la richesse de ces humbles existences qui ne témoignent pas des puissants faits de guerre, mais dévoilent la vie dans sa complexe densité. Il n’est pas de matière concrète et l’historien académique se meurt. Le romancier laisse sa plume suspendue, perplexe.
« Est-ce sur ces gens qui ont vécu jadis et qui sont morts depuis longtemps que j’écris, ou bien sur les ombres et les échos qui peuplent mon imagination ? […] Jusqu’où peut-on se pencher sans basculer au dehors par-dessus l’appui de la fenêtre, jusqu’où peut-on se pencher sans dégringoler dans la fosse sombre du passé perdu, irrévocablement ? Essayer ».
 Que dire ? Comment aborder le passé ? Question vaine. Il n’est que le « ici et maintenant », le hic et nunc si cher aux spirituels, notamment aux franciscains, ces bienheureux contemplatifs de l’instant offert, auquel Karel Schoeman, converti au catholicisme dans sa jeunesse, se joignit quelques années, sans finalement prononcer ses vœux.
Que dire ? Comment aborder le passé ? Question vaine. Il n’est que le « ici et maintenant », le hic et nunc si cher aux spirituels, notamment aux franciscains, ces bienheureux contemplatifs de l’instant offert, auquel Karel Schoeman, converti au catholicisme dans sa jeunesse, se joignit quelques années, sans finalement prononcer ses vœux.
« Ne pas chercher à comprendre, ne pas tenter de trouver une explication, rien d’autre n’existe qu’ici et maintenant, ce soir, rien que cette obscurité, la véranda et le jardin où l’on distingue à peine, dans le demi-jour, les contours des massifs. Ici, et pas ailleurs. »
Angoissante réalité que cet « ici et maintenant » ! Mais elle dévoile les sillons impalpables que l’écrivain, trop rempli de lui-même, ne savait jusqu’alors déceler. Libéré de toute conception historico-critique, il s’efface progressivement pour laisser enfin surgir les voix indistinctes. Elles émergent l’une après l’autre du silence, de l’obscurité, du vide dans lequel les maintenait une narration volontairement trop bavarde. À la surprise du lecteur, elles ne sont pas celle du héros fauché, ni celle de ceux qui savent, des puissants qui étaient au cœur de la guerre, mais les faibles voix de ceux qui l’ont vécue jusque dans leur chair, sans en rien connaître, sans en rien comprendre, victimes jusqu’à leur mort d’un conflit qui ne cessera plus de les hanter.
*
* *
 La division meurtrière d’une communauté laisse des stigmates qui disent davantage l’histoire que l’escarmouche avortée. Que sont les hérauts des épopées tragiques devant ces existences dont la dramatique est scellée jusque dans la chair ? Que sont les coups d’éclats fantastiques face à l’humble déchirure d’une population à jamais divisée par l’inimitié ? Ce n’est qu’airain qui sonne, et le vent emporte l’écho en de lointaines sphères, tandis que l’humanité continue d’avancer coûte que coûte, clopin-clopant, vers la réconciliation, avec soi, avec l’autre, avec le passé, le présent et l’avenir.
La division meurtrière d’une communauté laisse des stigmates qui disent davantage l’histoire que l’escarmouche avortée. Que sont les hérauts des épopées tragiques devant ces existences dont la dramatique est scellée jusque dans la chair ? Que sont les coups d’éclats fantastiques face à l’humble déchirure d’une population à jamais divisée par l’inimitié ? Ce n’est qu’airain qui sonne, et le vent emporte l’écho en de lointaines sphères, tandis que l’humanité continue d’avancer coûte que coûte, clopin-clopant, vers la réconciliation, avec soi, avec l’autre, avec le passé, le présent et l’avenir.
George, héros du Retour au pays bien-aimé, autre roman magistral de Karel Schoeman, retourne dans son pays d’origine après la mort de sa mère, afin de goûter une dernière fois la saveur d’antan et de vendre définitivement les quelques biens – une vieille ferme en ruines – dont il a hérités. Il ne trouvera qu’une communauté déchirée par les conflits, par l’oppression policière, par la jalousie de ceux qui sont restés envers ceux qui ont choisi l’exil, lui, George ; une communauté hantée par un glorieux passé irrémédiablement perdu et qui ne sait comment vivre – même les plus jeunes, surtout les plus jeunes, parce que leur désir vital n’est pas tari – dans ce veld inhospitalier, sans joie, sans ouverture au monde qui l’entoure. La guerre a meurtri jusqu’aux relations humaines les plus évidentes.
Karel Schoeman aurait pu se mettre en quête des voix de ceux qui savent, celle de M. Macalister, le magistrat, celle du pasteur Broodryk, celle du capitaine Crossley, chef de la police de la ville, ou encore celle du vieux Fourie… Ces voix nous auraient décrit avec finesse et exactitude les mécanismes de la guerre, les enjeux d’alors, les négociations diplomatiques et les conséquences politiques. Non. Les voix qui s’exondent de la brume d’antan sont celles des méconnus, de ceux qui étaient ombres parmi les vivants, des « vies minuscules ». Les premiers seront les derniers et inversement.
 Ainsi Alice, d’origine écossaise, fille alors jeune du magistrat, incapable de se souvenir de ses années en Afrique du Sud, pas même de sa propre mère, « une ombre, une silhouette, une robe légère qui se détachait sur la lumière du soleil, une voix ». Ses souvenirs sont troubles, enfouis, refoulés.
Ainsi Alice, d’origine écossaise, fille alors jeune du magistrat, incapable de se souvenir de ses années en Afrique du Sud, pas même de sa propre mère, « une ombre, une silhouette, une robe légère qui se détachait sur la lumière du soleil, une voix ». Ses souvenirs sont troubles, enfouis, refoulés.
« Je mélange les endroits, les visages et les noms ; je confonds les villes. Je ne me souviens plus, je ne sais plus ; tout se mêle et s’emmêle. Cela fait si longtemps déjà. […] À quoi bon repenser à tout cela et pourquoi faut-il que je raconte le peu dont je me souviens ? C’est du passé, et je préfère ne pas penser au passé, je ne pense jamais aux choses désagréables, j’en ai fait une règle, une règle immuable, j’ai brûlé toutes les photos et les lettres de cette époque je ne les ai plus non plus, je n’ai conservé aucun souvenir ».
Ainsi Kallie le boiteux, secrétaire de M. Macalister, qui prétend ne rien se rappeler mais dont les souvenirs s’échappent progressivement, précis et inattendus, au son d’un refrain : « C’est tout ce dont je me souviens ». Il confirme l’impression initiale qu’il ne s’est rien passé à Fouriesfontein ; tout peut se résumer à un abondant flot de paroles, d’impressions, de nuances, sur le contexte et l’atmosphère de l’époque. Il n’est finalement qu’une victime, un nègre du nom d’Adam Balie. Rien de grave en somme. Il aurait pu jouer un rôle important ; il fut exécuté à l’orée de la maturité, et on aura tôt fait de l’oublier. Il aurait dû être le héros ; ce n’était qu’un Noir. Les puissants en auront forgé un autre, bien blanc, c’est plus hygiénique. Kallie se tait, après un long monologue : « De toute façon, répète-t-il, je n’avais rien à raconter. »
La voix de Mademoiselle Godby s’élève alors. Elle non plus n’a rien à raconter sur la guerre ; elle ne peut que déclamer de petits faits sans intérêt, sur telle personnalité du village, sur tel événement anodin, pour autant que sa mémoire sur le déclin n’écorche pas le prénom ou la situation. Elle avance par petites touches imperceptibles, achevant la toile de fond que les narrateurs qui l’ont précédée ont commencé à tisser. L’angoisse la saisit, comme Alice qui a brûlé tous ses souvenirs, comme Kallie qui a fui le village.
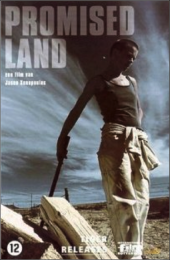 « Ce sont des choses que l’on oublie, et pour ma part, j’en ai déjà oubliées beaucoup, mais qui me reviennent soudain par bribes maintenant que je commence à en parler, les chevaux que l’on attelle à la lueur de la lanterne, la neige, les bruits de sabots dans la nuit, les voix. L’on finit par en savoir trop, et ce savoir, on n’a pas la liberté de le partager avec d’autres, on en porte le poids, seule. Finalement, le mieux est encore d’oublier. »
« Ce sont des choses que l’on oublie, et pour ma part, j’en ai déjà oubliées beaucoup, mais qui me reviennent soudain par bribes maintenant que je commence à en parler, les chevaux que l’on attelle à la lueur de la lanterne, la neige, les bruits de sabots dans la nuit, les voix. L’on finit par en savoir trop, et ce savoir, on n’a pas la liberté de le partager avec d’autres, on en porte le poids, seule. Finalement, le mieux est encore d’oublier. »
Alice et la tentative d’oubli de l’histoire.
Kallie et le déni des faits réels.
Mademoiselle Godby et la résignation de tout un peuple.
Qui peut les condamner, leur reprocher leur manque d’objectivité, leurs tentatives de vivre envers et contre tout ? Ils sont l’Histoire, celle passée et – le temps de quelques pages – la nôtre.
Les voix qui s’élèvent parmi les ombres sont celles qui ne savent décidément pas oublier, parce que le hennissement des chevaux continue de les hanter, parce que la poussière continue d’irriter leur gorge, parce que le sang a définitivement entaché leur peau, parce que d’autres voix ne cessent de murmurer à leurs oreilles les souvenirs enterrés. C’est tout ce qui leur reste. Ils ont été atteints de plein fouet par la guerre, par quelques misérables semaines de conflit dénué de valeur historique, sans jamais savoir l’appréhender, parce qu’ils étaient à l’écart, incapables de maîtriser ce qui leur arrivait.
« Ces voix – quand je pense à la guerre, quand j’essaie de me rappeler quelque chose de la guerre, ce sont toujours les voix dont je me souviens, et aussi du bruit des chevaux […] C’est à cela, aujourd’hui encore, que se limite la guerre lorsque j’essaie d’y repenser : les voix à la porte d’entrée, la voix de Minnie au salon, la voix d’Adam Balie qui appelle du bout du couloir, peut-être aussi des bruits de pas sous la véranda, quelque chose qui se passait dans une autre pièce, dehors dans la rue ou bien chez les Fourie, dans la petite école de Minnie, dans le quartier métis, mais jamais près de moi ».
*
* *
Pays des fleuves, récit de deux voyages aux Pays-Bas
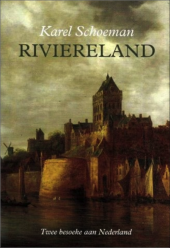 Chaque narrateur est une monade qui tente de décrire l’histoire de son point de vue, sans perspective de communion. Seule l’exubérante Minnie Colefax, dont la voix ne filtre jamais directement mais qui traverse les différents témoi- gnages, tente vainement de garder uni ce qui a toujours été divisé, malgré les apparences. Les blessures existaient : un bref événement les a dramatiquement révélées. Il n’était dès lors plus de communauté possible. Le village a soudainement disparu dans la brume, et il n’apparaîtra désormais qu’au lecteur soucieux de se laisser à nouveau happer parces obscures voix surgies, l’une d’une tombe, l’autre d’un ruisseau à demi asséché, l’une du sable soulevé brusquement par un vent de provenance inconnue, l’autre de l’intérieur d’une maison à laquelle nous n’avons jamais pleinement accès.
Chaque narrateur est une monade qui tente de décrire l’histoire de son point de vue, sans perspective de communion. Seule l’exubérante Minnie Colefax, dont la voix ne filtre jamais directement mais qui traverse les différents témoi- gnages, tente vainement de garder uni ce qui a toujours été divisé, malgré les apparences. Les blessures existaient : un bref événement les a dramatiquement révélées. Il n’était dès lors plus de communauté possible. Le village a soudainement disparu dans la brume, et il n’apparaîtra désormais qu’au lecteur soucieux de se laisser à nouveau happer parces obscures voix surgies, l’une d’une tombe, l’autre d’un ruisseau à demi asséché, l’une du sable soulevé brusquement par un vent de provenance inconnue, l’autre de l’intérieur d’une maison à laquelle nous n’avons jamais pleinement accès.
Difficile communion, car pour écouter une voix, encore faut-il qu’une autre se taise, sous peine de voir resurgir les incertitudes premières, lorsque tout est encore confus, indiscernable.
« Pardonner, peut-être, est possible, mais oublier, non, les blessures, même si elles se referment, laissent des cicatrices indélébiles. Ce qui est arrivé demeure à tout jamais irrémédiable, irrévocable, et court à travers le souvenir comme du fil de fer barbelé. La poussière, les chevaux, les jeunes cavaliers avec des plumes d’autruche à leur chapeau, les filles avec leurs rubans, Charles Kleynhans à genoux dans la poussière avec son costume noir, le jeune homme souriant d’un air aussi poli qu’absent derrière son bureau, et enfin Adam Balie gisant par terre, mort, dans la plantation d’acacias. […] Nous n’avons rien appris de ce qui est arrivé, les divisions n’ont fait que se creuser, l’amertume n’a fait que grandir. […] Nous n’avons rien appris, nous continuons de faire comme si de rien n’était, comme si rien ne s’était produit, condamnés, me dis-je parfois, à répéter éternellement les mêmes mots, les mêmes gestes, pris au piège dans un manège dont nous ne pouvons plus descendre. Éveillée dans la nuit, j’écoute, seule dans le noir, le tintement et le bruissement presque imperceptibles ».
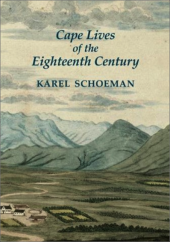 Entre réconciliation et oubli… Tel est le drame de ce pays déchiré par des guerres, celle des Boers au début du siècle dernier et celle, non moins terrifiante, causée par le système de l’Apartheid, contre lequel Karel Schoeman a beaucoup lutté ; son enga- gement résolu lui vaudra la remise de la plus haute distinction de son pays, l’Ordre du Mérite sud-africain, des mains de Nelson Mandela, en 1999. L’écrivain connaît le prix de la réconciliation ; il sait le poids de la mémoire. Une fois mentionnées les grandes batailles, si enthousiasmantes à écrire et à lire dans des livres, il a conscience qu’il ne reste qu’une population divisée et qui cherche constamment, péniblement, à se reconstruire. Pourquoi a-t-il écrit ce que les voix lui disaient ? Parce que l’histoire, la vraie, se noue dans le drame de la condition humaine. C’est ce qu’il s’attache à exprimer dans sa langue originelle, la langue du drame, l’afrikaans, dont nous goûtons la saveur grâce à l’excellente traduction de Pierre-Marie Finkelstein.
Entre réconciliation et oubli… Tel est le drame de ce pays déchiré par des guerres, celle des Boers au début du siècle dernier et celle, non moins terrifiante, causée par le système de l’Apartheid, contre lequel Karel Schoeman a beaucoup lutté ; son enga- gement résolu lui vaudra la remise de la plus haute distinction de son pays, l’Ordre du Mérite sud-africain, des mains de Nelson Mandela, en 1999. L’écrivain connaît le prix de la réconciliation ; il sait le poids de la mémoire. Une fois mentionnées les grandes batailles, si enthousiasmantes à écrire et à lire dans des livres, il a conscience qu’il ne reste qu’une population divisée et qui cherche constamment, péniblement, à se reconstruire. Pourquoi a-t-il écrit ce que les voix lui disaient ? Parce que l’histoire, la vraie, se noue dans le drame de la condition humaine. C’est ce qu’il s’attache à exprimer dans sa langue originelle, la langue du drame, l’afrikaans, dont nous goûtons la saveur grâce à l’excellente traduction de Pierre-Marie Finkelstein.
Mais voici que les voix « meurent au loin », comme le faible bruissement du vent après son passage. Il ne manque qu’une voix à cette symphonie dysharmonique, celle de l’auteur lui-même qui les a rassemblées, lui qui ne pose aucune question mais se met à leur écoute, se contentant de regarder, d’entendre et de perpétuer le souvenir. Il ne joue plus, rejette le masque alors que la dernière voix s’estompe. Nous sommes encore dans ce village, où plus aucune voix ne perce, sinon la sienne. Sommes-nous dans le passé ou dans le présent ? Qu’importe. Hic et nunc. La question, en dépit de notre rationalisme forcené, ne contient aucun intérêt. Seule notre liberté a désormais une parole à prononcer, pour que l’histoire puisse s’achever en nous, ne serait-ce qu’un instant.
« Tenter de juger cette réalité comme si elle était le résultat d’une suite apparemment logique d’incidents, d’une progression ordonnée de cause à effet, est en l’espèce une tâche impossible à réaliser, tout comme n’a aucun sens le fait de demander, ou de se poser la question de savoir combien de temps va durer mon séjour ici, ou encore quand je pourrai en partir, ce serait vouloir utiliser un système de valeurs étranger : ces questions sont sans réponse. »
Pierre Monastier
Promised Land - trailer
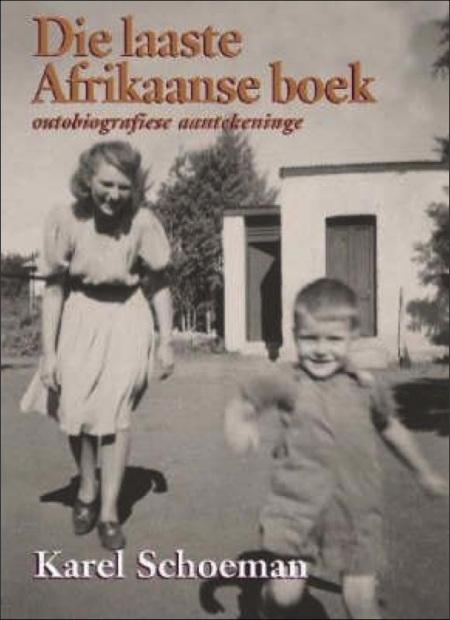



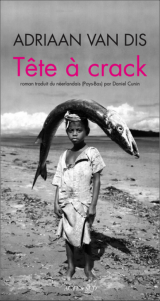
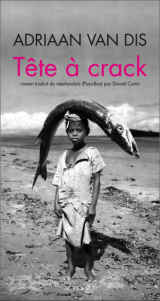 « Officiellement », car dans le village de Donald, ça n’a pas l’air tout à fait acquis. Les Blancs sont barricadés dans les villas du haut de la dune, alors que les Noirs s’entassent en contrebas, près du port, dans un bidonville gluant. Les pêcheurs sont au chômage, les trafiquants de nacre roulent sur l’or, les dealers n’ont aucun mal à refourguer leur tik, une colle bon marché, à tous les jeunes du coin qui la sniffent jour et nuit à s’en rendre débiles mentaux. Et quand il leur reste un peu de lucidité, ils volent ou vandalisent les maisons des Blancs. Mulder en a le cœur qui lui sort par la bouche : tensions sociales, viols, agressions, meurtres, corruption endémique, est-ce vraiment ça, le pays libéré ? Et Donald, il est bizarre, Donald, comment peut-il vivre ici, se résigner à tout ce qu’hier ils avaient combattu avec tant de force ? Quel genre de compromissions a-t-il fait avec son passé, « leur » passé ?
« Officiellement », car dans le village de Donald, ça n’a pas l’air tout à fait acquis. Les Blancs sont barricadés dans les villas du haut de la dune, alors que les Noirs s’entassent en contrebas, près du port, dans un bidonville gluant. Les pêcheurs sont au chômage, les trafiquants de nacre roulent sur l’or, les dealers n’ont aucun mal à refourguer leur tik, une colle bon marché, à tous les jeunes du coin qui la sniffent jour et nuit à s’en rendre débiles mentaux. Et quand il leur reste un peu de lucidité, ils volent ou vandalisent les maisons des Blancs. Mulder en a le cœur qui lui sort par la bouche : tensions sociales, viols, agressions, meurtres, corruption endémique, est-ce vraiment ça, le pays libéré ? Et Donald, il est bizarre, Donald, comment peut-il vivre ici, se résigner à tout ce qu’hier ils avaient combattu avec tant de force ? Quel genre de compromissions a-t-il fait avec son passé, « leur » passé ?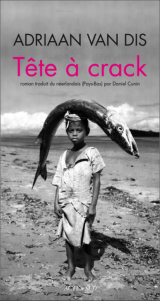 Parce qu’il ne suffit pas de déclarer qu’une guerre est finie pour qu’elle le soit vraiment. Parce que la schizophrénie des deux héros, qui hésitent constamment entre résignation et enga- gement, est bouleversante. Parce que le roman est comme eux, complexe, subtil, ambivalent, tellement humain. Parce que ça faisait combien de temps qu’un roman historico-politique ne vous avait pas arraché des larmes ? Parce qu’il a raison, Mulder, « le fossé entre les riches et les pauvres est ce qu’il y a de plus laid, la laideur même ». Et parce que les romans sans morale sont de loin les meilleurs.
Parce qu’il ne suffit pas de déclarer qu’une guerre est finie pour qu’elle le soit vraiment. Parce que la schizophrénie des deux héros, qui hésitent constamment entre résignation et enga- gement, est bouleversante. Parce que le roman est comme eux, complexe, subtil, ambivalent, tellement humain. Parce que ça faisait combien de temps qu’un roman historico-politique ne vous avait pas arraché des larmes ? Parce qu’il a raison, Mulder, « le fossé entre les riches et les pauvres est ce qu’il y a de plus laid, la laideur même ». Et parce que les romans sans morale sont de loin les meilleurs.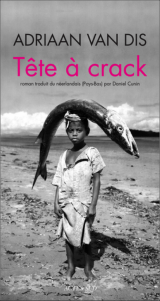


 « Entre-temps nous voilà déjà en mars et une chronique plus loin lorsque Couperus part pour El-Kantara, localité bâtie au pied d’une immense muraille. Après quoi, il finit par rejoindre la ville dont, à l’en croire, il a toujours rêvé : Timgad. Couperus passe trois jours dans cette cité frontalière afro-romaine, d’une grande importance sur le plan militaire, où Charles Godet, directeur des sites archéologiques, lui sert de cicérone. Le 16 avril 1921, Couperus fait part à ses lecteurs de son arrivée à Tunis. Alger, comme ville française, produit une impression de plus grande prospérité que Tunis, qui a davantage conservé le visage d’une ville orientale. Tunis, estime Couperus, est surtout intéressante pour ses souks, qu’il décrit page après page. Il ne se passe pratiquement pas un jour que Couperus ne visite les ruines de Carthage sous la houlette de l’archéologue
« Entre-temps nous voilà déjà en mars et une chronique plus loin lorsque Couperus part pour El-Kantara, localité bâtie au pied d’une immense muraille. Après quoi, il finit par rejoindre la ville dont, à l’en croire, il a toujours rêvé : Timgad. Couperus passe trois jours dans cette cité frontalière afro-romaine, d’une grande importance sur le plan militaire, où Charles Godet, directeur des sites archéologiques, lui sert de cicérone. Le 16 avril 1921, Couperus fait part à ses lecteurs de son arrivée à Tunis. Alger, comme ville française, produit une impression de plus grande prospérité que Tunis, qui a davantage conservé le visage d’une ville orientale. Tunis, estime Couperus, est surtout intéressante pour ses souks, qu’il décrit page après page. Il ne se passe pratiquement pas un jour que Couperus ne visite les ruines de Carthage sous la houlette de l’archéologue 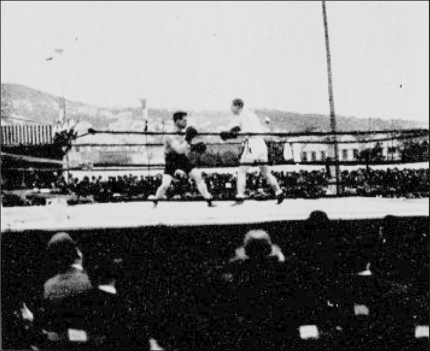
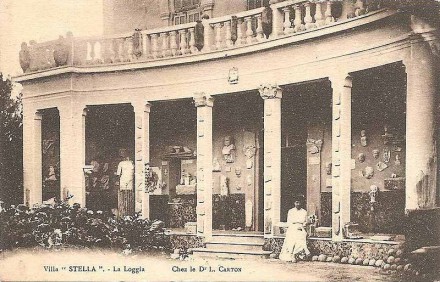
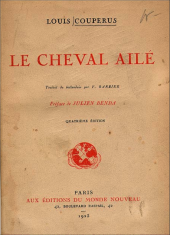
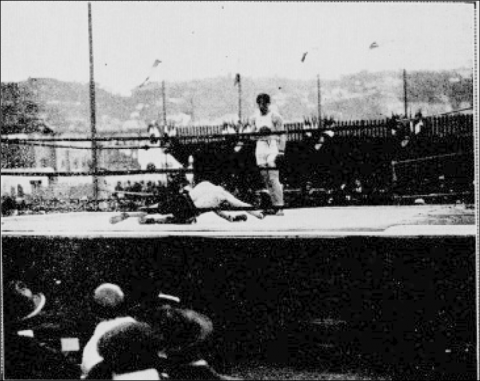

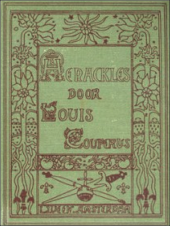 L’œuvre de Louis Couperus s’étend sur une quarantaine d’années, suivant toujours la ligne ascendante. Sa forte culture gréco-latine, son étonnante fécondité, son esprit souple et nombreux lui ont permis d’aborder les genres les plus différents et d’exceller dans tous. Citons quelques-unes de ses œuvres : Eline Vere (étude fouillée des milieux patriciens de La Haye) ;
L’œuvre de Louis Couperus s’étend sur une quarantaine d’années, suivant toujours la ligne ascendante. Sa forte culture gréco-latine, son étonnante fécondité, son esprit souple et nombreux lui ont permis d’aborder les genres les plus différents et d’exceller dans tous. Citons quelques-unes de ses œuvres : Eline Vere (étude fouillée des milieux patriciens de La Haye) ; 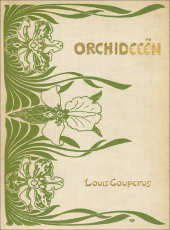 * Les deux seuls recueils de poèmes jamais publiés par Louis Couperus : Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886, volume qui comprend des proses). Après son premier roman, Eline Vere (1889), qui eut un grand retentissement dans son pays, il ne devait pour ainsi dire plus aban- donner la prose. L’homme de lettres
* Les deux seuls recueils de poèmes jamais publiés par Louis Couperus : Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886, volume qui comprend des proses). Après son premier roman, Eline Vere (1889), qui eut un grand retentissement dans son pays, il ne devait pour ainsi dire plus aban- donner la prose. L’homme de lettres 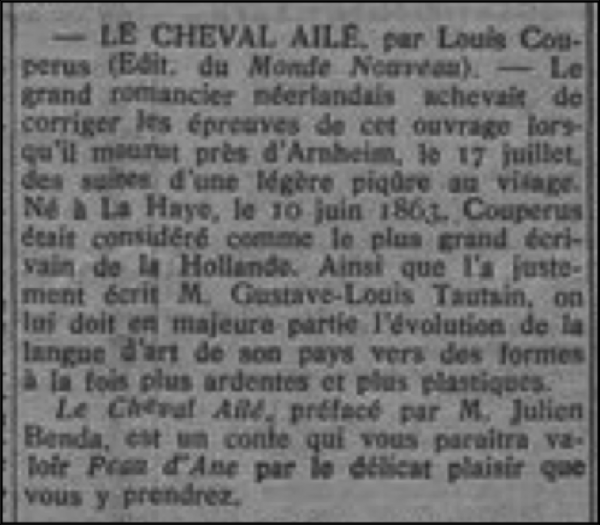
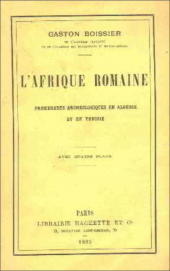 Oui, c’était bien ici que se trouvait le bûcher ; et là-bas, le Troyen fuyait à l’horizon… Et je ne suis pas le seul que cet endroit ait su émouvoir de la sorte. Feuilletez Gaston Boissier, et vous verrez que ce savant, cet archéologue, ce digne membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avoue son attendrissement sans fausse honte. Comme moi, il s’est dit : « Voici les lieux où vécut Didon ; c’est ici qu’elle a souffert ; c’est ici, qu’après s’être consumée d’amour, elle se laissa dévorer par les flammes. Quant à Énée… les dieux lui imposèrent l’épreuve de voir Didon monter sur le bûcher, tandis qu’il s’élançait au loin… »
Oui, c’était bien ici que se trouvait le bûcher ; et là-bas, le Troyen fuyait à l’horizon… Et je ne suis pas le seul que cet endroit ait su émouvoir de la sorte. Feuilletez Gaston Boissier, et vous verrez que ce savant, cet archéologue, ce digne membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avoue son attendrissement sans fausse honte. Comme moi, il s’est dit : « Voici les lieux où vécut Didon ; c’est ici qu’elle a souffert ; c’est ici, qu’après s’être consumée d’amour, elle se laissa dévorer par les flammes. Quant à Énée… les dieux lui imposèrent l’épreuve de voir Didon monter sur le bûcher, tandis qu’il s’élançait au loin… »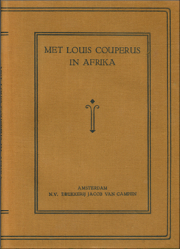 Et puis, voyez-vous les deux ports de la Carthage punique, évoqués dans le roman de Flaubert ? D’abord le port marchand, circulaire, avec, au centre, l’île sur laquelle se dressait le Palais de l’Amirauté ; ensuite le port militaire. Il est presque impossible de se représenter que ces deux minuscules étangs furent jadis les deux grands ports de l’antique Carthage, et que le port de guerre abritait, du temps d’Hamilcar, un nombre – que j’ignore – de trirèmes, chacune dans sa loge, séparée de la suivante par une colonne. Les alluvions ont-elles donc été si considérables qu’il ne reste plus aujourd’hui que ces deux petites flaques, l’une ronde, l’autre allongée ? Grâce aux ruines qui nous restent, il est plus aisé de reconstruire le môle aux bastions carrés qui se dressait entre les ports et la mer.
Et puis, voyez-vous les deux ports de la Carthage punique, évoqués dans le roman de Flaubert ? D’abord le port marchand, circulaire, avec, au centre, l’île sur laquelle se dressait le Palais de l’Amirauté ; ensuite le port militaire. Il est presque impossible de se représenter que ces deux minuscules étangs furent jadis les deux grands ports de l’antique Carthage, et que le port de guerre abritait, du temps d’Hamilcar, un nombre – que j’ignore – de trirèmes, chacune dans sa loge, séparée de la suivante par une colonne. Les alluvions ont-elles donc été si considérables qu’il ne reste plus aujourd’hui que ces deux petites flaques, l’une ronde, l’autre allongée ? Grâce aux ruines qui nous restent, il est plus aisé de reconstruire le môle aux bastions carrés qui se dressait entre les ports et la mer. L’autre jour, tandis que je me laissais doucement emporter au fil de mes rêves, je vis deux jeunes taureaux, échappés à leur petit pâtre, qui dévalaient la colline, se lutinant, éparpillant le sable sous leurs sabots, soufflant de leurs naseaux dilatés, et lançant vers le ciel des mugissements joyeux. Et voici que la vague frangée de neige déposa à mes pieds une de ces belles coquilles de murex, d’où les anciens tiraient la pourpre. Et je ne saurais vous dire pourquoi cette coquille, ces taureaux, pourquoi la mer, le ciel turquin, les asphodèles roses et, enfin, ces ruines géantes – pourquoi l’ensemble de ces choses me donna l’impression de goûter « l’heure exquise », baignées qu’elles étaient de la lumière blonde d’une fin d'après-midi doré. Non, je ne saurais vraiment vous dire pourquoi…
L’autre jour, tandis que je me laissais doucement emporter au fil de mes rêves, je vis deux jeunes taureaux, échappés à leur petit pâtre, qui dévalaient la colline, se lutinant, éparpillant le sable sous leurs sabots, soufflant de leurs naseaux dilatés, et lançant vers le ciel des mugissements joyeux. Et voici que la vague frangée de neige déposa à mes pieds une de ces belles coquilles de murex, d’où les anciens tiraient la pourpre. Et je ne saurais vous dire pourquoi cette coquille, ces taureaux, pourquoi la mer, le ciel turquin, les asphodèles roses et, enfin, ces ruines géantes – pourquoi l’ensemble de ces choses me donna l’impression de goûter « l’heure exquise », baignées qu’elles étaient de la lumière blonde d’une fin d'après-midi doré. Non, je ne saurais vraiment vous dire pourquoi…
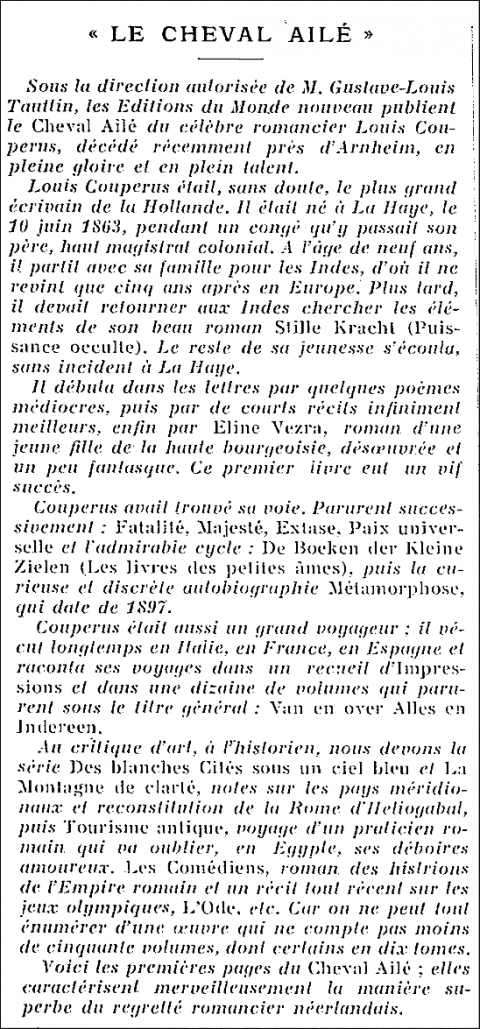
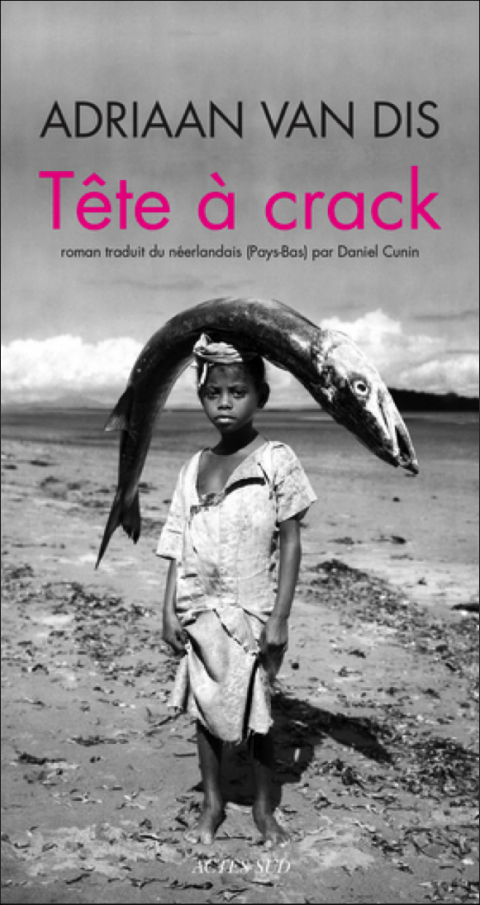
 Grâce à de subtils éclairages,
Grâce à de subtils éclairages, 
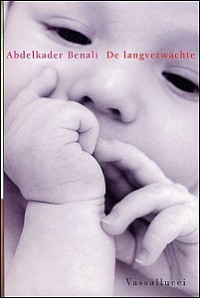 Son don lui permet de connaître ses géniteurs et aïeux bien mieux qu’eux-mêmes ne se connaîtront jamais : Mehdi, son jeune papa de 17 ans ; Diana, sa jeune maman de 17 ans ; ses grands-parents pater- nels, Driss Ayoub, boucher titulaire d’un faux permis de conduire, et Malika, amatrice de thé devant l’Éter- nel ; Elisabeth Doorn, sa grand-mère maternelle, bourgeoise de La Haye, pacifiste sur le retour; Samuel Black Crow Brannigan, son grand-père paternel biologique qui s’est retiré dans le désert de l’Arizona en quête des secrets de ses propres aïeux indiens ; Rob Knuvelder, le père adoptif de Diana, qui ne vit plus avec sa femme Elisabeth, mais en face de chez elle.
Son don lui permet de connaître ses géniteurs et aïeux bien mieux qu’eux-mêmes ne se connaîtront jamais : Mehdi, son jeune papa de 17 ans ; Diana, sa jeune maman de 17 ans ; ses grands-parents pater- nels, Driss Ayoub, boucher titulaire d’un faux permis de conduire, et Malika, amatrice de thé devant l’Éter- nel ; Elisabeth Doorn, sa grand-mère maternelle, bourgeoise de La Haye, pacifiste sur le retour; Samuel Black Crow Brannigan, son grand-père paternel biologique qui s’est retiré dans le désert de l’Arizona en quête des secrets de ses propres aïeux indiens ; Rob Knuvelder, le père adoptif de Diana, qui ne vit plus avec sa femme Elisabeth, mais en face de chez elle. bien que court, fait figure de nom à courant d’air : les Ayoub descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent de… Job, modèle inégalé de vertu et de probité sur son tas de fumier. Malika, la grand-mère berbère, n’a bien entendu pas de nom de famille si ce n’est celui de son mari. Une femme, ça n’en acquiert un que le jour de son mariage.
bien que court, fait figure de nom à courant d’air : les Ayoub descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent de… Job, modèle inégalé de vertu et de probité sur son tas de fumier. Malika, la grand-mère berbère, n’a bien entendu pas de nom de famille si ce n’est celui de son mari. Une femme, ça n’en acquiert un que le jour de son mariage. Entre les fusées qui jettent des gerbes de couleur dans le ciel marocain pour annoncer aux habitants d’une campagne reculée le début du Ramadan et les feux d’artifice que l’on tire en Hollande à l’occasion du passage à la nouvelle année, le romancier narre une année de l’existence de Diana et Mehdi, deux adolescents d’autant plus attachants qu’ils sont quelconques. De sa plume en apparence dégingandée et assurément sarcastique, il épingle avec une rare acuité tant les travers des adultes que ceux des « jeunes », tant ceux du citoyen moyen que ceux de l’étranger nouvellement arrivé, tant ceux des autres que les siens propres. Le quartier de Rotterdam qu’il décrit, avec sa boucherie, sa bibliothèque, son tramway, la boutique où tous les étrangers viennent téléphoner, sa population bigarrée, son junkie, c’est un peu sa mythologie personnelle, le terrain de sa commedia dell’arte, son buffet à souvenirs, même s’il a grandi dans un environnement plutôt hollandais ; comme Mehdi, il a travaillé dans la boucherie de son père ; comme Mehdi, il a une mère qui ne s’exprime guère en néerlandais ; comme Mehdi, il a éprouvé le besoin de chausser des baskets qui coûtaient la peau des fesses, bottes de sept lieues conduisant non à la cour du roi mais dans les bras d’une Diane pas forcément chaste, dans ceux d’une Muse ou bien à l’Atlantide
Entre les fusées qui jettent des gerbes de couleur dans le ciel marocain pour annoncer aux habitants d’une campagne reculée le début du Ramadan et les feux d’artifice que l’on tire en Hollande à l’occasion du passage à la nouvelle année, le romancier narre une année de l’existence de Diana et Mehdi, deux adolescents d’autant plus attachants qu’ils sont quelconques. De sa plume en apparence dégingandée et assurément sarcastique, il épingle avec une rare acuité tant les travers des adultes que ceux des « jeunes », tant ceux du citoyen moyen que ceux de l’étranger nouvellement arrivé, tant ceux des autres que les siens propres. Le quartier de Rotterdam qu’il décrit, avec sa boucherie, sa bibliothèque, son tramway, la boutique où tous les étrangers viennent téléphoner, sa population bigarrée, son junkie, c’est un peu sa mythologie personnelle, le terrain de sa commedia dell’arte, son buffet à souvenirs, même s’il a grandi dans un environnement plutôt hollandais ; comme Mehdi, il a travaillé dans la boucherie de son père ; comme Mehdi, il a une mère qui ne s’exprime guère en néerlandais ; comme Mehdi, il a éprouvé le besoin de chausser des baskets qui coûtaient la peau des fesses, bottes de sept lieues conduisant non à la cour du roi mais dans les bras d’une Diane pas forcément chaste, dans ceux d’une Muse ou bien à l’Atlantide  (3) Entretien de l’auteur avec Dominique Caubet.
(3) Entretien de l’auteur avec Dominique Caubet.
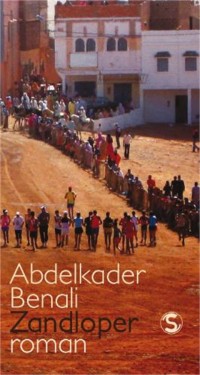 Toujours en 2010, une chaîne publique néerlandaise a diffusé les reportages «
Toujours en 2010, une chaîne publique néerlandaise a diffusé les reportages «
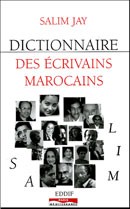
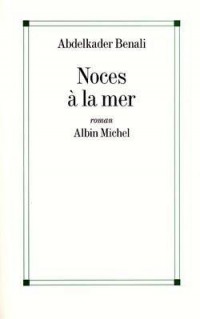 le choc des cultures et les malentendus qui en dé- coulent. En 2003, Benali obtient le prix Libris (équivalent du Goncourt) pour son deuxième livre, L’Enfant tant attendu (De Langverwachte), une projection dans la vie tumultueuse d’un couple mixte.
le choc des cultures et les malentendus qui en dé- coulent. En 2003, Benali obtient le prix Libris (équivalent du Goncourt) pour son deuxième livre, L’Enfant tant attendu (De Langverwachte), une projection dans la vie tumultueuse d’un couple mixte.