Quand je n’aurai plus d’ombre
Au-delà de la mort, je reviendrai, dit-elle
La parution de Quand je n’aurai plus d’ombre, roman d’Adriaan van Dis aux éditions Actes Sud – chroniqué dès avril par Christophe Mercier dans Le Figaro ou encore fin mars par Lut Missine sur les-plats-pays.com – a été repoussée à ce début de l’année 2021. Le roman est enfin en librairie. Dans l’œuvre de cet écrivain néerlandais, ce livre s’inscrit en parallèle de ceux dans lesquels la figure paternelle domine la narration (en particulier Les Dunes coloniales , qui connaît une nouvelle vie en format de poche, et Fichue famille dont une adaptation graphique a vu le jour récemment). Dans la novella (non traduite) De rat van Arras (Le Rat d’Arras), le personnage central est une femme qui présente certaines similitudes avec la mère d’Adriaan van Dis mise en scène dans l’autofiction qu’est Quand je n’aurai plus d’ombre. La vieille dame, qui tient à tout prix à mourir avant son centième anniversaire, passe ses dernières années dans un petit appartement d’une résidence pour personne âgée, ce qu’on appelle en français depuis la nuit des temps de ce beau vocable d’EHPAD ou hè ! pad ! en néerlandais, ce qui signifie : Eh ! crapaud !
Tandis que les enfants des petits villages bataves aident les crapauds à traverser la route après leur hibernation (ce qu’on appelle paddentrek ou migration des crapauds et autres batraciens/amphibiens), les grands de nos capitales, depuis le dernier hiver, écrasent les petits vieux comme des mouches.
Adriaan van Dis, Quand je n'aurais plus d'ombre, traduction par Daniel Cunin,
Arles, Actes Sud, janvier 2021
LE MOT DE L’ÉDITEUR
Drapée dans ses secrets, une femme presque centenaire annonce sans ménagement à son fils qu’elle compte sur lui pour abréger sa fin de vie. Ce dernier négocie : il ne l’aidera à trouver les pilules adéquates que si elle accepte d’éclaircir certains mystères qui pèsent sur l’histoire familiale. De souvenirs tronqués en conversations échevelées, s’engage alors un pas de deux mouvementé, où la tendresse le dispute à la fureur. Née dans une famille de riches propriétaires terriens, la mère a saisi, dans les années 1920, la première occasion de s’échapper : elle a épousé un élève officier « caramel » d’une école militaire toute proche et l’a suivi aux Indes néerlandaises, l’actuelle Indonésie.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été rapatriée, veuve, avec ses trois filles. Son fils, né aux Pays-Bas peu après ces événements tragiques, d’un autre père, ne sait rien ou presque de cette période tumultueuse, qu’elle semble tantôt fabuler joyeusement, tantôt occulter farouchement. Il la presse donc de questions, impatient qu’elle se livre enfin. Avant qu’il ne soit trop tard. Saisissant portrait d’une aventurière, ode enragée à une mère impossible, ce roman irrévérencieux laisse libre cours à la verve d’un écrivain aux prises avec celle qui l’a mis au monde.
Van Dongen, Fichue famille, d'après le roman éponyme d'Adriaan van Dis, Dupuis, 2020
LE POINT DE VUE DE LUT MISSINE
C’est la double motivation de l’écrivain qui rend ce roman passionnant. D’une part, le narrateur tente de racheter une dette qu’il a en tant que fils : son ignorance du passé de sa mère, qui a toujours été occulté par celui du père. […] D’autre part, le narrateur s’exprime en tant qu’écrivain et endosse ainsi un nouveau sentiment de culpabilité. Il veut non seulement dénouer le mystère de sa mère, mais aussi embellir sa vie par l’écrit – non sans y avoir un intérêt personnel. Il a en effet reçu une avance de son éditeur, un contrat attend sa signature et il va maintenant exploiter sa mère sans vergogne, comme un « vautour d’écrivain ».
Mais la mère, bientôt centenaire, n’agit pas non plus de façon désintéressée. Elle lui livre l’histoire de sa vie en échange de son aide pour mourir. […] Ce livre est une réussite avant tout par la manière dont le narrateur se découvre et se met à nu en racontant sa mère. […] Quand je n’aurai plus d’ombre est le roman d’une lutte. Celle du fils avec la mère, celle de la mère avec ses souvenirs des camps, ses mariages et la mort qui approche – « Vieillir, c’est aussi une guerre », dit-elle –, celle de l’écrivain avec l’histoire qu’il raconte. Mais, avant tout, c’est l’histoire d’une lutte entre un fils et un écrivain.
Adriaan Van Dis, Le Rat d'Arras, Amsterdam, De Bijenkorf, 1986
EXTRAIT (chapitre 28)
J’ai téléphoné avant le dîner. Elle avait une voix rauque.
« T’as parlé à quelqu’un aujourd’hui ?
— Non, t’es le premier. » La porte de son balcon était ouverte, j’entendais des oiseaux chanter.
« Personne n’est passé ?
— J’ouvre pas.
— Oui, mais la directrice a la clé.
— Je mets le verrou.
— Ça n’est pas très gai, t’es toujours plus seule.
— Seule, moi ? N’exagère pas, tu sais que je fais peu de cas des autres. »
Ensemble à la table de lecture. Le téléphone sonne. Elle décroche, sans mentionner son nom : « Non, non, madame n’est pas là. Non, je suis son amie. Vous voulez lui laisser un message ? » Elle fait oui de la tête, mais tire la langue et raccroche.
« C’était qui ?
— Juste la banque. Ces gens, de nos jours, y cherchent à nous refiler tout un tas de trucs. »
Une nouvelle fois, le téléphone. Cette fois, elle décroche en adoptant une voix distinguée : « Oui, vous êtes bien chez… Une seconde, je demande à madame. » Elle garde la main sur le combiné, laisse passer du temps… « Non, ça ne convient pas à madame. Ces prochaines semaines, elle n’a pas une minute à elle. »
Elle glousse comme une polissonne. « Le club de lecture, je n’en ai plus envie. »
La directrice téléphone. « Non, demain, pas le temps. C’est ça, oui, des visites. En effet, on s’occupe bien de moi… Bien trop bien… ha, ha.
— Tu as de la visite demain ?
— Non, mais je n’ai pas envie d’la voir celle-là. Je fais celle qui a un emploi du temps surchargé. »
Coup de fil inquiet de la directrice : « Votre mère ne va pas bien. Elle aboie sur le personnel, elle se dispute avec tout le monde. »
Sans attendre, je l’appelle.
« On me dit que tu te conduis mal.
— J’suis pas au courant.
— Si tu tiens à mourir dans la sérénité, il te faut commencer par lâcher prise et respirer la paix. Renonce à ta rage. Se disputer, c’est s’attacher. »
Je la mets face aux textes qu’elle revendique pour planer.
« Évacue l’inutile.
— Comme si je n’évacuais déjà pas assez de choses comme ça. »
Un va-au-diable et, dans la seconde, communication coupée.
J’emportai un coussin neuf, doux, rempli de duvet, odorant la lavande. Couvert de taches, celui qu’elle tenait contre son ventre sentait mauvais. Elle refusa le nouveau. Je le posai sur ses genoux. Elle posa dessus un regard de dégoût et le balança par-dessus son épaule. Je le posai devant elle sur la table – une pelote de reproches. Elle leva sur moi des yeux bruns larmoyants, tira le coussin vers elle, le tint des deux mains devant sa bouche et me demanda de l’appuyer contre sa figure.
« Non, t’es folle ou quoi ! »
Elle me considéra d’un air suppliant, je m’agenouillai devant elle puis nous caressâmes à l’unisson le coussin. Sous nos mains chaudes s’élevait une odeur de lavande.
« On peut pas continuer comme ça, j’ai chuchoté, pas faire comme ça. »
Elle tira sur les accoudoirs du fauteuil à les arracher tout en tapant furieusement du pied sur le tapis.
Adriaan Van Dis lit le passage suivant de son roman :
J’AI SU TRÈS TÔT RECONNAÎTRE L'ODEUR DE LA MORT
(chapitre 34)
Jardiner, c’est transmettre des histoires, de façon hésitante ; mais quand on fouit la terre, on finit toujours par les faire émerger. De plus, selon elle, un jardin ressemble à une histoire, ce dont elle parlait avec de grands gestes. Prenez la forme, délimitée, quelle que soit l’étendue qu’on a sous les yeux. Un jardin a un début, une fin, un point focal. Dès qu’on ouvre le portillon, une image nous saisit – une vue, un cytise luxuriant ou un arbre de caractère. On se laisse entraîner entre les parterres, d’un tableau à l’autre, et c’est alors que le rythme s’impose à nous, on découvre des surprises, une perspective différente, des trompe-l’œil, on devine des côtés sombres où ça sent le sang, où ça grouille d’intrigues. Un jardin naît sous la main de son créateur, non sans maints tâtonnements, celui-ci copie sur ses voisins, se lance dans la bataille, sarcle, taille, déplace, cherche à séduire. Sentiers et oscillation exigent plus d’attention qu’une ligne droite. Retrancher ce qui dépasse, le jeter sur le tas de compost – dans le fumier fermentent les promesses.
Dans le jardin, ma mère abandonnait toutes ses réserves, arrachait des feuilles, les froissait dans sa main qu’elle me faisait renifler – apprendre à assimiler des odeurs. De la sorte, j’ai su très tôt reconnaître celle de la mort.
long entretien en néerlandais avec l’auteur (2015)
Jean-Claude Vantroyen, « Quand je n’aurai plus d’ombre, d’Adriaan van Dis : sarabande pour une mère mourante »,
Le Monde des Livres, 8 janvier 2021.


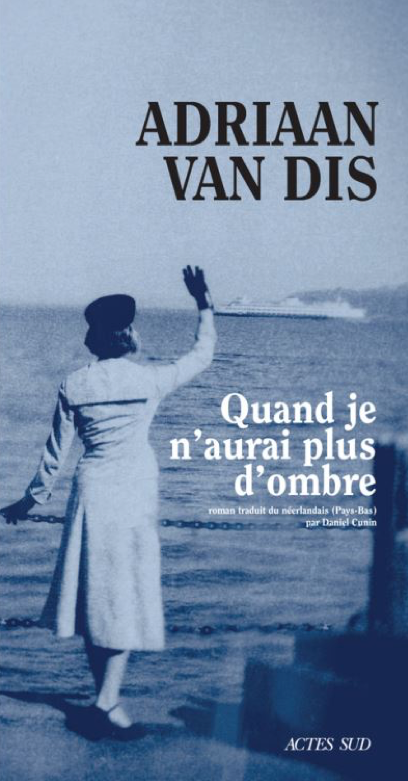

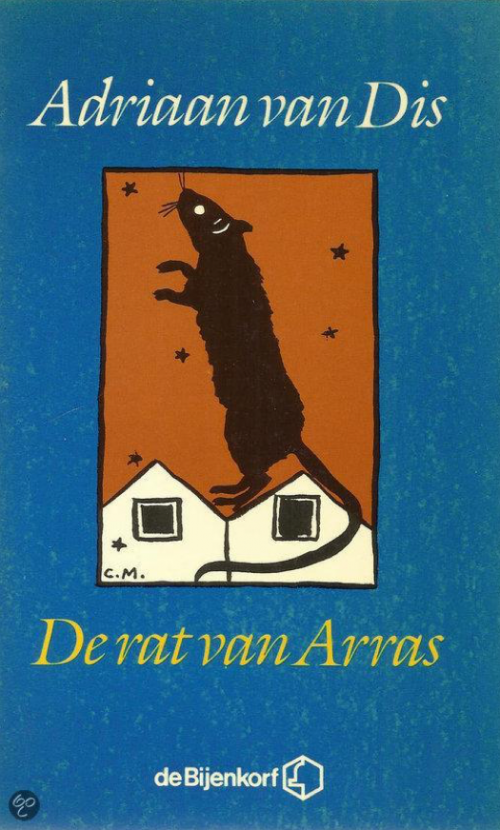

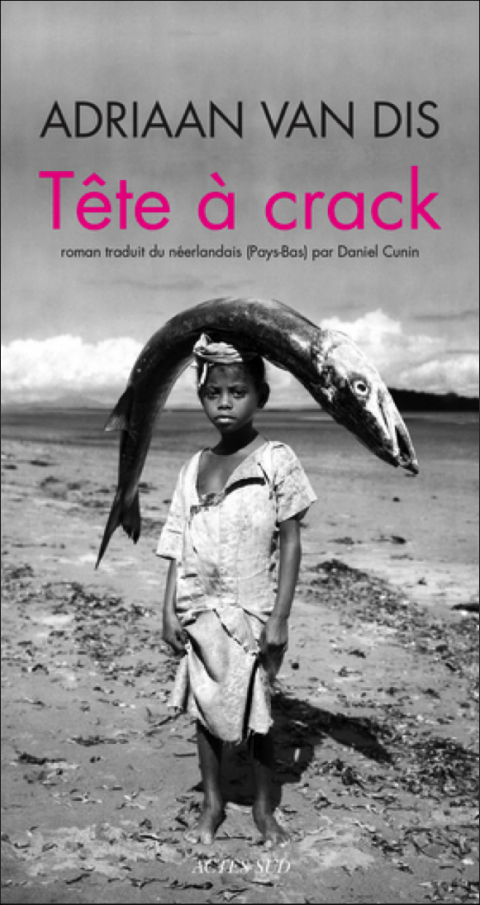
 Grâce à de subtils éclairages,
Grâce à de subtils éclairages, 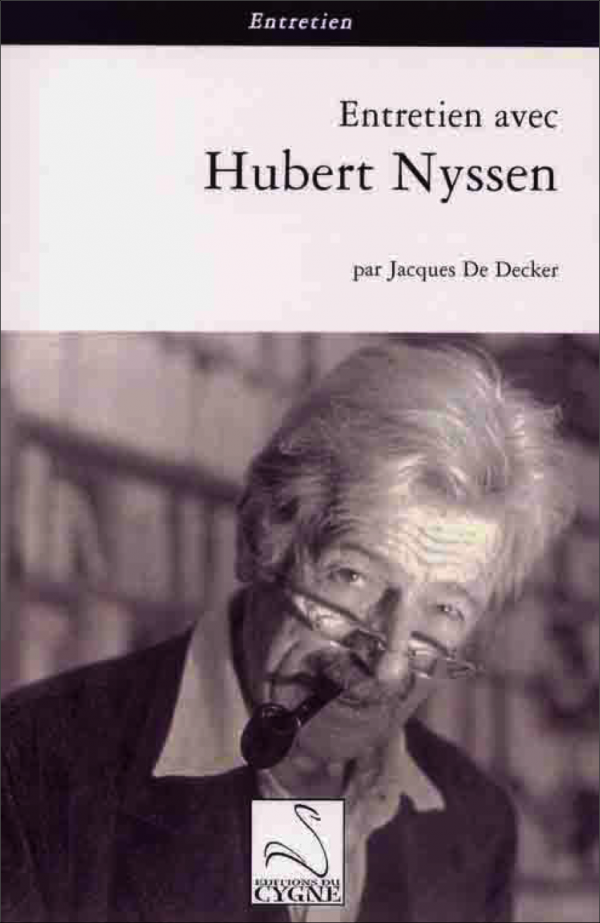
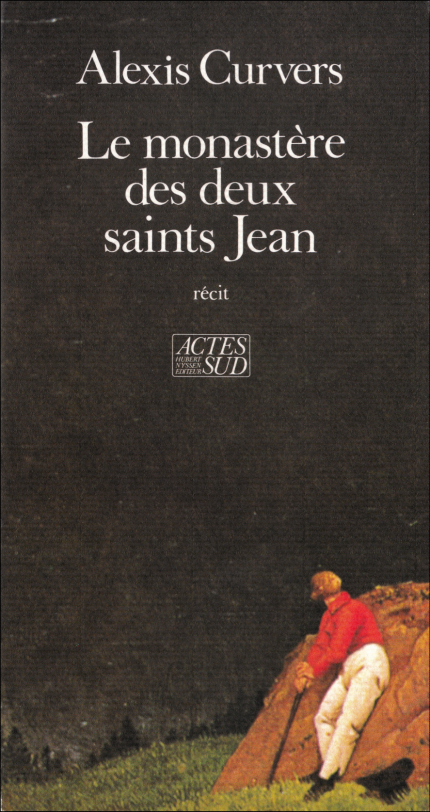

 Il nous résuma cependant, mais d’assez mauvaise grâce, quelques observations qu’il avait cursivement notées. Nous dûmes ainsi convenir que les panneaux intérieurs du retable sont peints tout à la gloire et pour l’apothéose du seul Jean-Baptiste. Il y trône au ciel à côté de Dieu, tandis que sur la terre l’Évangéliste se laisse à peine deviner parmi les Apôtres et les Docteurs qui l’environnent en foule. Contrastant avec cet anonymat, une inscription très claire décore le trône céleste du Baptiste, lequel y est qualifié de « plus grand que l’homme, égal aux anges » et de « lampe du monde » ; la phrase est tirée d’un sermon de saint Pierre Chrysologue, évêque de la cour de Ravenne, catholique mais longtemps ami de l’hérétique Eutychès et lui-même arianisant, comme presque tout le monde l’était plus ou moins consciemment dans ce dernier siècle de l’Empire romain.
Il nous résuma cependant, mais d’assez mauvaise grâce, quelques observations qu’il avait cursivement notées. Nous dûmes ainsi convenir que les panneaux intérieurs du retable sont peints tout à la gloire et pour l’apothéose du seul Jean-Baptiste. Il y trône au ciel à côté de Dieu, tandis que sur la terre l’Évangéliste se laisse à peine deviner parmi les Apôtres et les Docteurs qui l’environnent en foule. Contrastant avec cet anonymat, une inscription très claire décore le trône céleste du Baptiste, lequel y est qualifié de « plus grand que l’homme, égal aux anges » et de « lampe du monde » ; la phrase est tirée d’un sermon de saint Pierre Chrysologue, évêque de la cour de Ravenne, catholique mais longtemps ami de l’hérétique Eutychès et lui-même arianisant, comme presque tout le monde l’était plus ou moins consciemment dans ce dernier siècle de l’Empire romain.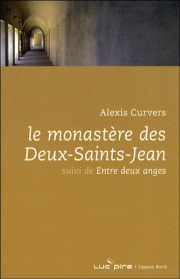 Bien plus, la croix du Christ ne se rencontre nulle part dans tout l’ensemble du polyptyque. Le peintre y a pourtant semé nombre de croix, mais toutes petites, grecques ou pattées, et ne servant que d’accessoires et d’ornements ; plusieurs sont en forme de tau, symbole imparfait, décapité de la branche supérieure par où descend la grâce du ciel. Même la croix figurant parmi les instruments de la Passion portés par les anges qui entourent l’Agneau, même cette croix du Calvaire est douteuse : on ne sait si l’écriteau qui la surmonte au ras de la transversale est ainsi placé pour cacher la branche supérieure de la verticale, ou pour en masquer l’absence. De telles ambiguïtés sont-elles sans intention ?
Bien plus, la croix du Christ ne se rencontre nulle part dans tout l’ensemble du polyptyque. Le peintre y a pourtant semé nombre de croix, mais toutes petites, grecques ou pattées, et ne servant que d’accessoires et d’ornements ; plusieurs sont en forme de tau, symbole imparfait, décapité de la branche supérieure par où descend la grâce du ciel. Même la croix figurant parmi les instruments de la Passion portés par les anges qui entourent l’Agneau, même cette croix du Calvaire est douteuse : on ne sait si l’écriteau qui la surmonte au ras de la transversale est ainsi placé pour cacher la branche supérieure de la verticale, ou pour en masquer l’absence. De telles ambiguïtés sont-elles sans intention ?