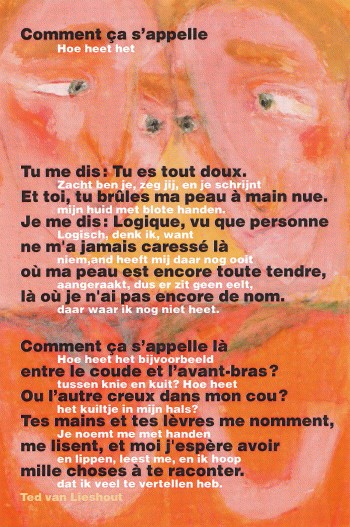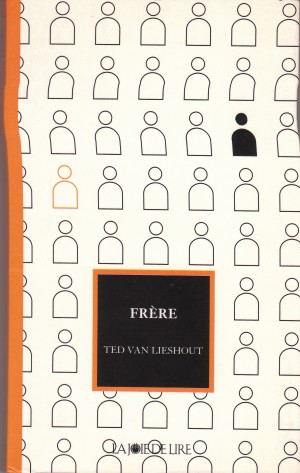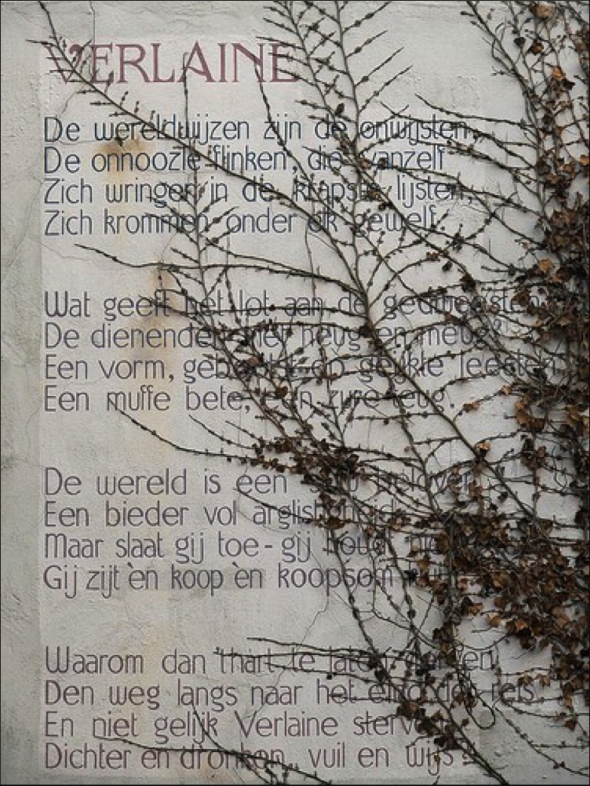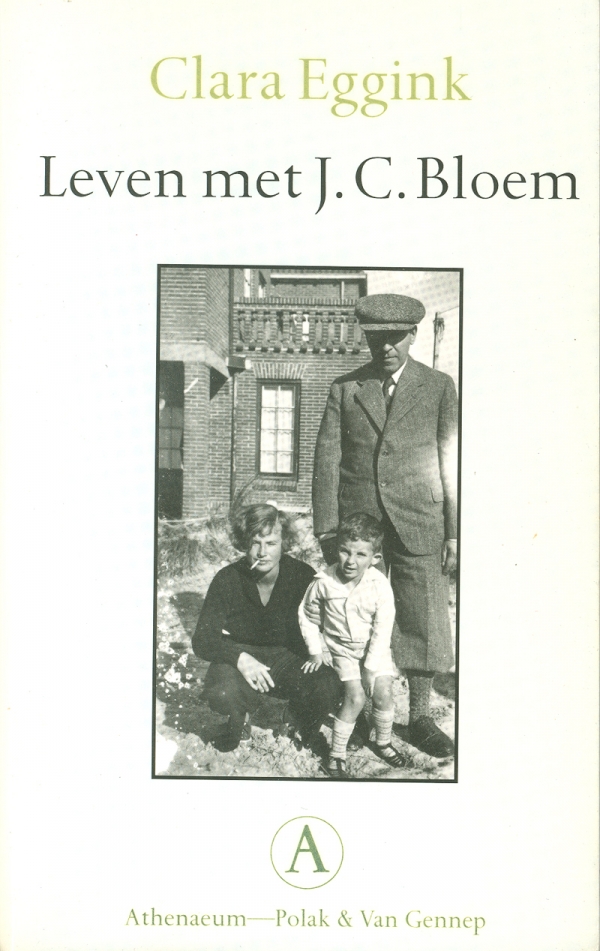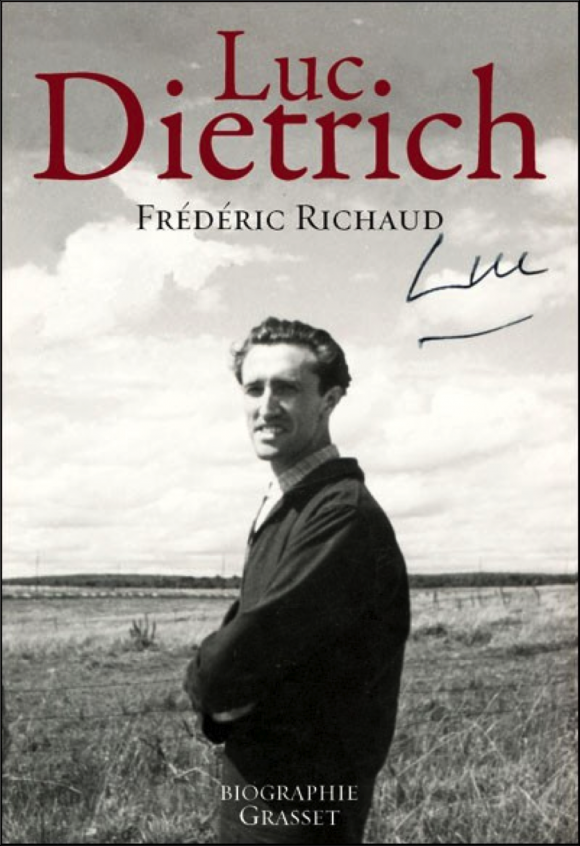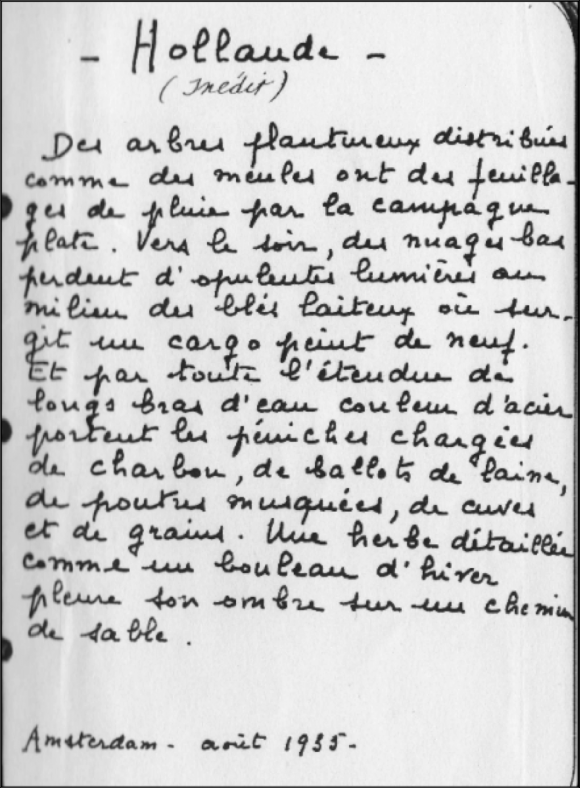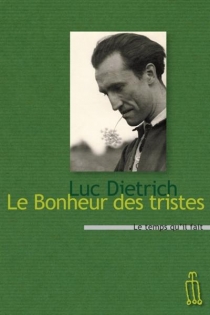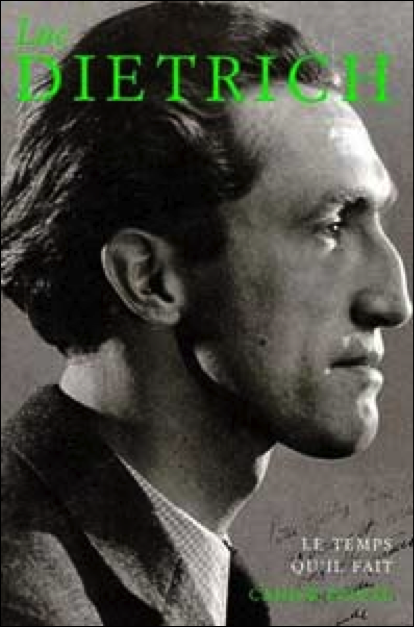LA MORT DE LOUIS COUPERUS VUE DE PARIS (1)
Le 16 juillet 1923, Louis Couperus s’éteint dans la maison où il s'est établi avec sa femme Elisabeth peu après leur retour d'Extrême-Orient. Rentré très fatigué du Japon où il avait été hospitalisé quelques mois plus tôt, le romancier aurait succombé à une pneumonie doublée d'une septicémie. Une infection du nez se serait manifestée dans les derniers jours. Aussi, un journal hollandais annonce en ces termes sa disparition le jour même du décès : « Une infection au visage, suivie d’une septicémie pernicieuse a mis fin en quelques jours à cette riche existence qui a revêtu une importance majeure pour les lettres néerlandaises. » En France, la presse reprendra plus ou moins cette version.
Le 15 juillet, veille de la mort de l’écrivain, paraissait en France une de ses nouvelles en traduction dans la revue Les Marges (tome XXVIII, n° 109, 20ème année, p. 181-184) : Les Courtisanes, autrement dit De oirans (courtizanen), la treizième petite légende d'un recueil de proses « japonaises », Le Collier de la Miséricorde (Het snoer der ontferming), publiées en livraisons puis en volume, mais seulement après la mort de leur auteur. Le traducteur, Paul Eyquem, précisait dans une note : « La Hollande célèbre ce mois-ci le soixantième anniversaire de Couperus. Les Marges sont particulièrement heureuses de s’associer à cet hommage. Les pages traduites ci-dessus sont extraites d’un livre encours de publication dans la revue Groot Nederland : Le Collier de la Miséricorde. »
Le 19 juillet, le quotidien Le Temps annonce à la « Mort du poète Couperus ». L’auteur anonyme de l’entrefilet reprend la thèse d’un décès suite à « une infection généralisée foudroyante », mais celle aurait été causée par « une légère piqûre au visage », thèse qu’a pu avancer aux Pays-Bas le journaliste S.F. van Oss. Dans une chronique qui précède un article anecdotique sur « les débuts de Mata-Hari », le Mercure de France du 1er août emploie pour ainsi dire les mêmes mots, si ce n’est que « généralisée » est remplacé par « tétanique ». Dans ces lignes, le roman Majesté est devenu Majestic, Eline Vere s’appelle dorénavant Elène Vezra. Hormis la mention de la traduction donnée par Paul Eyquem aux Marges et l’annonce de la parution prochaine d’une œuvre de Couperus en français, à savoir Le Cheval ailé préfacé par Julien Benda (prépublication dans Le Monde nouveau et parution du volume à l’automne), l’essentiel de ce papier est peu fiable. Avec quelques mois de recul, et en s’inspirant d’une chronique nécrologique de Herman Robbers (1868-1937) – homme de lettres néerlandais qui, loin d’être un grand ami de Couperus, avait tout de même, en tant que vice-président de l’Association des Gens de Lettres, pris la parole lors de ses obsèques – parue dans la Revue de Genève en octobre 1923, Les Chroniques des Lettres françaises (n° 8, mars-avril 1924, p. 257) proposent un aperçu plus solide. Mais l’article le plus complet consacré au romancier après sa disparition est sans doute celui d’un de ses compatriotes, Johannes Lodewijk Walch (1879-1946) qui rédigeait à cette époque la rubrique des « Lettres néerlandaises » à la « Revue de la Quinzaine » du Mercure de France (1er octobre 1923, p. 241-245). Johannes Lodewijk Walch, journaliste (il sera correspondant à Paris en 1916) et homme de lettres, a assuré différentes charges dans le milieu du théâtre ; curieux de tout, en particulier de théâtre et de littérature, de moyen-néerlandais (un essai sur Hadewijch) et de linguistique, il sera nommé professeur de langue et de littérature néerlandaises à la Sorbonne, poste qu’il occupera jusqu’en 1939. Parmi ses nombreuses publications (poésies, pièces de théâtre, romans, nouvelles, essais, une Petite histoire de la littérature néerlandaise…), on compte un Louis Couperus (1921) et un Mensen in Parijs (Gens à Paris, 1946). (D.C.)
Voici cette nécrologie – à laquelle nous ajoutons quelques notes – qui propose tout compte fait, malgré sa sécheresse, un assez bon aperçu de la carrière du Haguenois Louis Couperus
LETTRES NÉERLANDAISES
La mort de Louis Couperus. – Mon état de santé m'a obligé, pendant près d'un an, d’interrompre ces chroniques trimestrielles et maintenant qu'il m'est permis de les reprendre, j'ai le triste devoir de parler tout d'abord de la mort de mon maître et grand ami Louis Couperus, mort que rien ne faisait prévoir et qui, par un jeu cruel du destin, l'a frappé tout juste au lendemain des fêtes célébrées à l'occasion de son soixantième anniversaire et où toute la Hollande intellectuelle et aussi le gouvernement lui avaient apporté leur hommage ; au lendemain aussi du jour où le grand romancier, qui jusque-là avait mené une vie non exempte de soucis, continuellement errante, pouvait compter sur le repos et sur un travail entièrement désintéressé dans le cottage dont ses admirateurs lui avaient fait don à de Steeg, prés d'Arnhem. Déjà le Mercure a annoncé la mort de Louis Couperus dans une note succincte qui indiquait exactement la place importante que le grand romancier néerlandais avait prise dans nos lettres, de même que dans la littérature internationale.
Il était le plus délicat en même temps que le plus puissant, le plus fécond et le plus lu de nos auteurs modernes et aussi le plus grand d'entre eux tous, malgré l'hostilité que ses livres ont rencontrée dans les milieux religieux qui leur reprochaient une inspiration trop païenne et malgré les critiques en partie justifiées qui lui reprochaient son art trop efféminé et même un peu déliquescent, Louis Couperus ne s'en est pas moins imposé et cela par la diversité prodigieuse de ses créations, par leur continuité et par l’impression d'indéniable puissance qui en émanait et à laquelle le raffinement des détails et des sentiments ne parvenait pas à porter atteinte. L'opinion générale le plaçait dès maintenant au rang de nos classiques et nos lycéens, en passant leur baccalauréat, inscrivaient, sur la liste des auteurs qu'ils devaient avoir lus et sur lesquels ils pouvaient être interrogés, un ou deux ouvrages de Couperus à côté des œuvres de Vondel, de Hooft, de Corneille, de Molière, de Shakespeare et de Goethe. Cela ne veut pas dire que Couperus fût rangé sur la même ligne que ces géants de la littérature universelle, mais indique seulement la place considérable qui lui était reconnue.
Louis Couperus était né le 10 juin 1863. Son père était un haut fonctionnaire colonial et l’enfant naquit au cours d'un congé que la famille passait à La Haye. Son grand-père maternel avait été gouverneur géneral des Indes néerlandaises. Plus tard, par son mariage, Louis Couperus entra encore plus étroitement en rapport avec les milieux coloniaux. Il entreprit une couple de voyages aux Indes et ce pays occupe une place considérable dans son œuvre. Il lui consacra deux ouvrages : Van oude Menschen (Vieilles gens) (1) et De Stille Kracht (la Force occulte) (2). Mais il n'était pas ce qu'on appelle en Hollande un « sinjo » ; il n'avait, dans ses veines, aucun sang javanais ou malais ainsi qu'on l'a longtemps prétendu et comme l'avait donné à croire un de ses portraits de jeunesse.
Au sortir de l'école, Louis Couperus n'aurait pas demandé mieux que de se consacrer à la production littéraire, mais ses parents exigèrent qu'il continuât ses études et, sous la direction du Dr Jan ten Brink, plus tard professeur à Leyde, le même qui, comme critique, fut la bête noire des jeunes poètes de l'époque, il obtint son brevet de capacité pour l'enseignement du néerlandais. Il avait satisfait ainsi aux exigences familiales ; et, assuré d'avoir en cas de besoin un gagne-pain, il put se vouer sans arrière-pensée à ses travaux personnels.
Il avait déjà publié des poèmes dans les revues et, dans sa vingt-et-unième année, il fit paraître un recueil, Een lent van Vaerzen (Un printemps de poésie), suivi, peu après, de deux autres recueils. Plus tard la grande revue littéraire Groot Nederland, dont il fut un des fondateurs en 1903 publia encore quelques poésies de sa main. Ces productions, il faut le reconnaître, sont médiocres. Louis Couperus est avant tout et presque exclusivement un grand prosateur. Comme tel, son début fut un coup de maître. Son premier roman, Eline Vere, qui parut d'abord en feuilleton dans le journal Het Vaderland de La Haye, fut un succès. Le critique du Nieuwe Gids écrivit à ce propos : « Couperus, qui, cinq années durant, s'est trompé dans son art, s'est transformé brusquement, de petit poète précieux et prétentieux qu'il était, en un grand réaliste, doué d'une belle sensibilité. » En écrivant Eline Vere, Couperus avait eu sans cesse à l'esprit l'Anna Karénine de Tolstoï. Il décrit la vie malheureuse d'une femme désœuvrée et névrosée, dans les milieux aristocratiques de La Haye. L'œuvre s'apparentait au naturalisme ; mais elle se distinguait du naturalisme hollandais, lequel se complaisait trop souvent dans la description vulgairement sentimentale des basses classes, par une vision personnelle de la vie et une psychologie pénétrante. Le succès de ce livre s'est maintenu et se maintiendra longtemps. Il en paraît encore de nouvelles éditions et Mme Couperus en a fait une adaptation théâtrale, qui a été représentée en 1918.
Et voici que commence toute une série de publications, des plus diverses et pouvant se ranger en différentes catégories. D'abord les œuvres psychologiques où, après Eline Vere, nous pouvons citer les romans Noodlot (Fatalité) (1890), et Extaze (1892), le recueil de nouvelles : Een llluzie (1892) (3), le roman Langs Lynen van Geleidelykheid (Les Affinités), le roman javanais De Stille Kracht (1900), l'admirable cycle (4 volumes) De Boeken der Kleine Zielen (Les Livres des Petites Âmes) (1901-1903) décrivant la vie familiale et intime à La Haye. Puis viennent en 1906 et 1908 Van Oude Menschen, avec le sous-titre De Dingen die Voorbygaan, et le récit italien Aan den Weg der Vreugde (Sur le Chemin de la Joie).
Dans les intervalles de ces romans psychologiques ou pour employer un mot sinon plus exact du moins plus caractéristique, de ces romans bourgeois, Couperus avait publié des romans de pure imagination ; d'abord ses romans de la vie de cour : Majesteit (1893) (4), Wereldvrede (1895) (La Paix du Monde), qui attira l'attention de l'étranger parce que l'auteur y avait donné un vue anticipée des événements qui accompagnèrent et suivirent le manifeste du tzar; et Hooge Troeven (1896).
Puis vint, en 1897, un roman autobiographique, Metamorfoze, dont l’affabulation est tellement neuve et originale qu’il n’y a guère d’œuvre, dans la littérature européenne, qui puisse lui être comparée. A Metamorfoze se rattachent un grand nombre d'esquisses, où Couperus, dans la suite, a décrit sa vie et analysé ses sentiments et qui, parus d'abord comme feuilleton dans Het Vaderland, furent réunis en volumes. Puis viennent les récits légendaires Psyché (1898) (récemment traduit en français et publié sous le titre de Le Cheval ailé), Fidessa (1899) (5), Babel (1901), Over lichtende Drempels (les Seuils de lumière) (1902), recueil de fantaisies légendaires. Cette série trouve son couronnement dans une œuvre grandiose, Van God en Goden (1903), vaste cosmogonie peu connue et moins comprise encore.
Louis Couperus s'était senti très tôt attiré par les rivages ensoleillés de la Méditerranée (6). L’Italie avec ses villes d'art, l’Espagne, la Sicile lui étaient familières, il séjourna longtemps à Nice. Il en rapporta des impressions de voyage qui, disséminées dans des journaux, furent publiées en 1915 en dix volumes. L'antiquité romaine et grecque inspira peut-être à Couperus ses plus belles œuvres : De Berg van Licht (1905-1906) (La Montagne de Clarté), tableau prodigieux de la Rome décadente, De Komedianten (les Comédiens), une de ses œuvres de prédilection où il décrit la vie des comédiens romains, Antiek Toerisme (1911), décrivant les pérégrinations d'un patricien romain en Egypte; Van Goden en Koningen, Van Dichters en Hetæren (des Dieux, des Rois, des Poètes et des Hétaïres) ; Schimmen van Schoonheid (Fantômes de Beauté); Xerxes of de Hoogmoed (Xerxès ou l'Orgueil), et enfin Iskander, roman antique ayant pour héros Alexandre le Grand. Nous pourrions appeler ceci l’œuvre méditerranéenne de Couperus. Il faut y joindre un roman qui se passe dans la vieille Espagne: De Ongelukkigen (les Malheureux), et ses romans mythiques, Dionyzos (1904), Herakles (1913), De Verliefde ezel (L'Âne amoureux) (1918), et Legende, mythe en fantazie (1918).
Et ce n'est pas tout encore : il y a ses traductions, ses fragments de la Tentation de saint Antoine, sorte d'exercice où Couperus, tout à ses débuts, s'appliqua à assouplir et à orner, à corser, si je puis dire, sa langue en transposant en néerlandais la prose de Flaubert (7) ; Les Ménechmes de Plaute (1896), Antoine et Cléopâtre de Shaw (1917).
Ce n'est qu'une sèche énumération et rien que cette énumération a déjà dépassé les limites de cette chronique. Dans cette nombreuse production, il y a des œuvres entachées de quelques faiblesses, mais il n'y en a pas de médiocres. Signalons une courte polémique que Louis Couperus eut, en 1919, avec la romancier H. Robbers (8) et où il déclara que le roman bourgeois était un genre fini, épuisé, trop galvaudé aussi, raison pour laquelle lui-même y avait renoncé. Dans ces dernières années, il avait donné fréquemment des lectures publiques de ses œuvres, et cela avec un talent de diseur tout à fait remarquable ; malgré les insuffisances de sa technique. Un jour il lut ainsi, dans un petit cercle d'amis, des fragments, d'une brillante traduction de Chantecler, traduction qui n'a pu être ni jouée ni publiée à cause des prétentions exorbitantes d'Edmond Rostand. Les héritiers du poète seraient-ils disposés à se montrer plus coulants ?
J.-L. WALCH.
(1) Le roman a été traduit en français par S. Roosenburg (= Selinde Margueron) sous le titre Vieilles gens et choses qui passent, Paris, Éditions Universitaires, 1973.
(2) La Force des ténèbres, traduit par Selinde Margueron, préface de Philippe Noble, Paris, Le Sorbier, 1986.
(3) Deux des six nouvelles de ce recueil ont été traduites en français à la fin du XIXe siècle.
(4) voir sur ce blog : Louis Couperus en Majesté
(5) Le Cheval ailé, traduit par Félicia Barbier, préface de Julien Benda, Paris, Éditions du Monde nouveau, 1923. En 2002, les Presses Universitaires du Septentrion ont publié une traduction de Psyché et de Fidessa en un même volume : Psyché/Fidessa. Contes et légendes littéraires, traduction David Goldberg, , introduction de Gilbert Van de Louw.
(6) Sur les affinités de Louis Couperus avec le monde méditerranéen, on peut lire en français : Adrienne Lautère, L’Âme latine de M. Louis Couperus, romancier hollandais, Paris, Éditions du Monde nouveau, 1923.
(7) Les traductions qu’a données Louis Couperus de Flaubert et de Rostand doivent faire l’objet d’un article à paraître dans la revue Deshima en 2010.
(8) Le même Herman Robbers que celui qui a assisté aux obsèques de Couperus.
Les données les plus complètes sur les dernières semaines de Couperus, sa mort et ses obsèques figurent dans la dernière partie du chapitre 6 de la biographie que lui a consacré Frédéric Bastet : Louis Couperus. Een biografie, Amsterdam, Querido, 1989. Quant à celles portant sur les traductions françaises des œuvres du romancier, on les trouvera dans : R. Breugelmans, Louis Couperus in den vreemde, deuxième édition revue et augmentée, Leyde, 2008.
Voir aussi : La mort de Louis Couperus vue de Paris (2)
et une de ses nouvelles : Les éventails.

 L’histoire d’une énumération (anthologie), Paris, Caractères, 2003.
L’histoire d’une énumération (anthologie), Paris, Caractères, 2003.