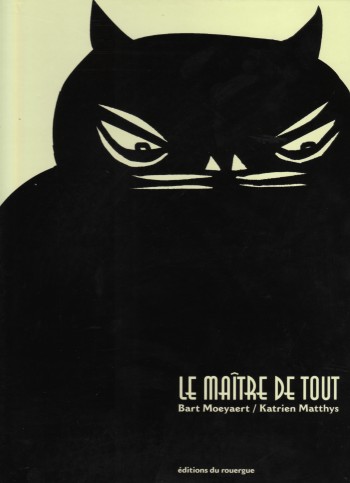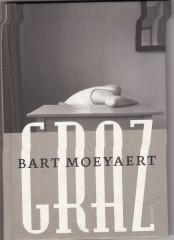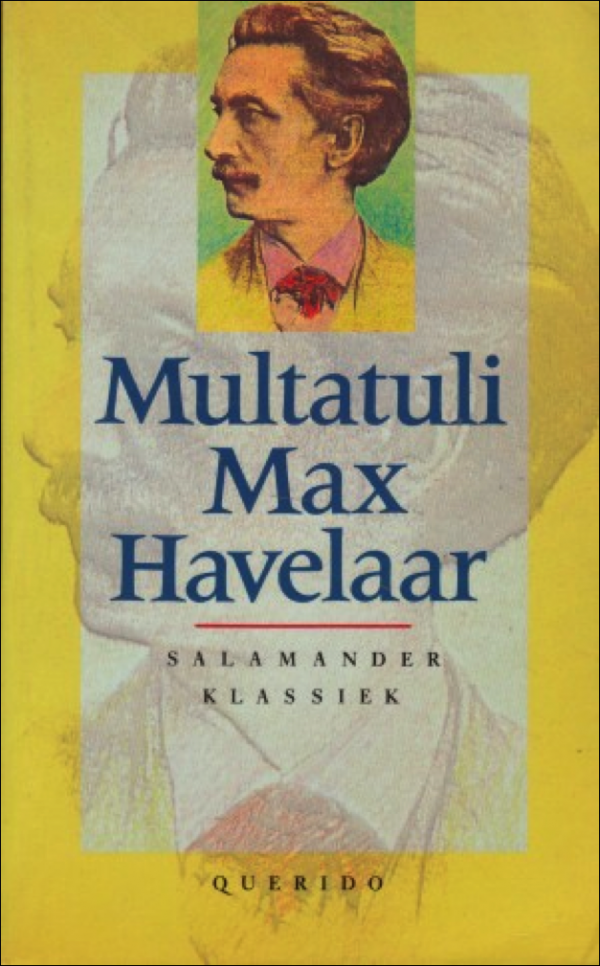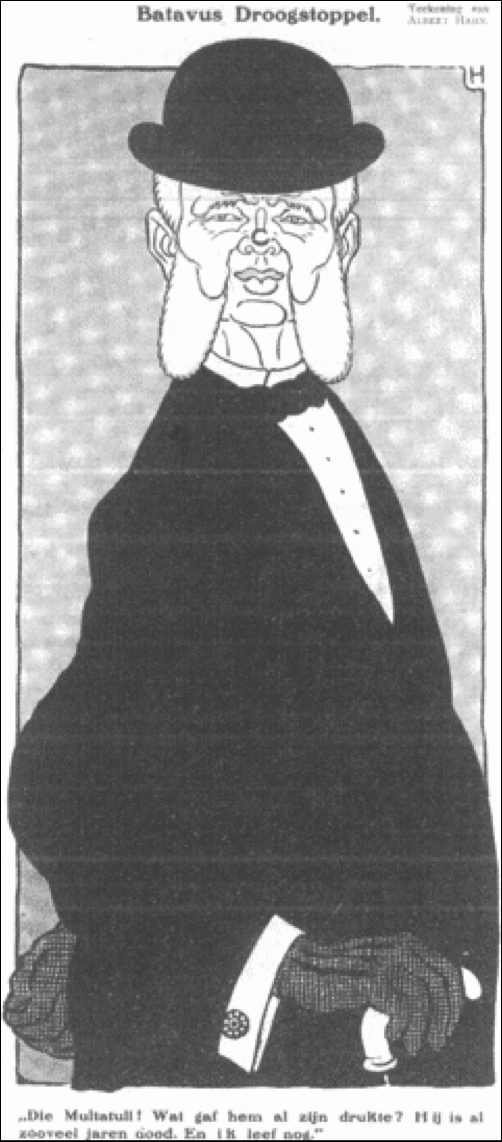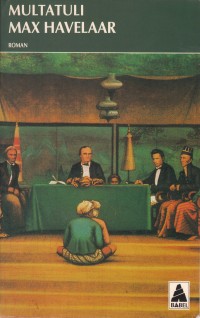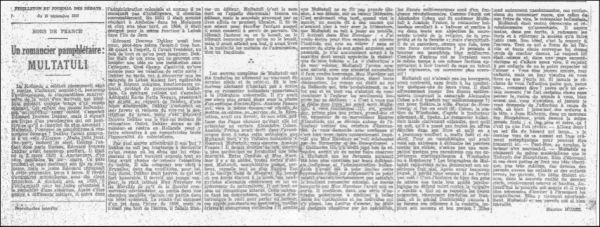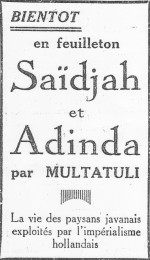Pierre Michon selon Rokus Hofstede
Pierre Michon et son traducteur
Pierre Michon est relativement peu traduit. La langue néerlandaise est la seule à avoir « accueilli » pour ainsi dire l’intégralité de son œuvre. Un entretien en français avec son traducteur Rokus Hofstede qui a, par ailleurs, transposé des écrivains aussi divers que Aragon, Barthes, Bourdieu, Cioran, Ernaux, Jauffret, Lamarche, Pansaers, Perec, Proust…
Gand, le 9 novembre 2009
Texte de Rokus Hofstede
qui reprend sa communication de 2001.
Il a été publié dans Pierre Michon, l’écriture absolue,
textes rassemblés par Agnès Castiglione,
Publications de l’Université de Saint-Etienne,
2002, p. 235-243.
« Je ne pus qu’amèrement m’extasier »
Traduire Michon en néerlandais
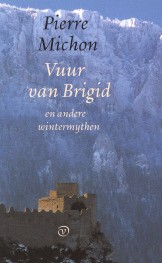 Parmi les différentes formes de plaisir que procure la lecture, Roland Barthes, dans son essai Sur la lecture (1) distingue, à côté de la lecture métaphorique ou poétique du texte (qui relève du fétichisme) et du plaisir métonymique de la narration (le suspense), le désir que provoque le texte lu d’écrire soi-même : nous désirons, dit Barthes, le désir que l’auteur a eu du lecteur lorsqu’il écrivait, nous désirons le aimez-moi qui est dans toute écriture. Aucun lecteur sans doute n’est saisi d’un tel désir au même degré que le traducteur : son désir, produire un texte digne d’être aimé, est directement proportionnel à l’aimez-moi investi dans le texte à traduire. Or, pour le réaliser, le traducteur doit oser s’affranchir du texte qu’il traduit. Le traducteur est un avatar d’Orphée : dans l’espoir de retrouver ce qu’il aime, il doit s’en éloigner ; se retourne-t-il, il éprouvera que son amour n’est pas sans risques. À propos de mon amour risqué pour le travail de Pierre Michon, et plus spécialement pour Vies minuscules (Roemloze levens), le livre qui ouvre son œuvre et qui clôt, jusqu’à nouvel ordre, ma traduction néerlandaise de cette œuvre, ces quelques immodestes remarques.
Parmi les différentes formes de plaisir que procure la lecture, Roland Barthes, dans son essai Sur la lecture (1) distingue, à côté de la lecture métaphorique ou poétique du texte (qui relève du fétichisme) et du plaisir métonymique de la narration (le suspense), le désir que provoque le texte lu d’écrire soi-même : nous désirons, dit Barthes, le désir que l’auteur a eu du lecteur lorsqu’il écrivait, nous désirons le aimez-moi qui est dans toute écriture. Aucun lecteur sans doute n’est saisi d’un tel désir au même degré que le traducteur : son désir, produire un texte digne d’être aimé, est directement proportionnel à l’aimez-moi investi dans le texte à traduire. Or, pour le réaliser, le traducteur doit oser s’affranchir du texte qu’il traduit. Le traducteur est un avatar d’Orphée : dans l’espoir de retrouver ce qu’il aime, il doit s’en éloigner ; se retourne-t-il, il éprouvera que son amour n’est pas sans risques. À propos de mon amour risqué pour le travail de Pierre Michon, et plus spécialement pour Vies minuscules (Roemloze levens), le livre qui ouvre son œuvre et qui clôt, jusqu’à nouvel ordre, ma traduction néerlandaise de cette œuvre, ces quelques immodestes remarques.
La formule paradoxale de Vies minuscules est de dire le manque dans le mouvement même qui réalise le désir. Ce paradoxe – la débâcle devenant rédemption, l’absence devenant présence – provoque chez le lecteur un singulier rapport affectif au texte : comment ne pas aimer un texte dont le aimez-moi est si formidable, dont la venue à l’existence semble à tel point miraculeuse ? Or, le traducteur de Vies minuscules, qui consacre cette venue à l’existence tout en disparaissant en elle, est dans une situation inversée : pour lui, c’est la présence qui devient absence, le désir réalisé qui réitère le manque. J’emploie à dessein ce vocabulaire mi-amoureux, mi-religieux : c’est le seul disponible apparemment pour penser la situation spécifique du traducteur. Ne sommes-nous pas habitués à voir le rapport d’un texte traduit à un original en termes de « fidélité » et de « trahison » ? Selon cette idéologie commune, que tant de lecteurs véhiculent sans voir où est le problème et que tant de traducteurs endossent avec une si exemplaire abnégation, le traducteur serait ce fidèle qui s’efface devant l’auteur, dans le désir, évidemment impossible à réaliser, de se rendre transparent, d’offrir au lecteur un accès immédiat au texte, c’est-à-dire aussi dans le regret de ne pas être auteur lui-même. Pour clarifier, on fait appel à la distinction, tout aussi commune, entre la langue « source » et la langue « cible » : il y aurait donc les « sourciers » et les « ciblistes », d’un côté ceux qui privilégient la fidélité à la langue de départ, c’est-à-dire avant tout une transmission adéquate du style, mais qui sont toujours suspects de donner dans le mot à mot, le calque, la traduction littérale, et de l’autre côté ceux, la majorité, qui privilégient la fidélité à la langue d’arrivée, c’est-à-dire avant tout une transmission adéquate du sens, mais qui sont toujours suspects de donner dans le naturel, le lisse, le beau style. Dans les deux cas, fidélité, effacement, transparence sont les maîtres-mots.
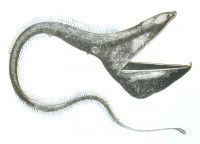 La fidélité, cette norme impensée, je crois qu’elle est funeste. Elle est funeste pour les traducteurs, à qui elle renvoie une image déréalisante et dévalorisante de leur travail tout en les empêchant de se munir des outils critiques et des titres sociaux qu’il mérite ; elle est funeste pour la qualité de leurs traductions, qui souffrent de ne pas être comprises pour ce qu’elles sont ; et elle est funeste aussi pour la littérature en tant que telle, dont l’existence universelle, c’est-à-dire autonome, dépend entièrement des traductions, qui sont les instruments de consécration par excellence. « Fidélité », « trahison » sont des concepts insuffisants pour penser la relation complexe entre écrire et traduire, car ils décrivent de façon simplistement hiérarchique un phénomène équivoque. À quoi doit-on être fidèle en traduisant : à la « langue source » ou à la « langue cible » ? Au « style » ou au « sens » ? À l’auteur ou au lecteur ? Henri Meschonnic, dans son récent Poétique du traduire (2), plaide avec force pour un changement fondamental de paradigme et pour l’élaboration d’une théorie critique, d’une « poétique » de la traduction, contre la vieille dichotomie entre le sens et le style :
La fidélité, cette norme impensée, je crois qu’elle est funeste. Elle est funeste pour les traducteurs, à qui elle renvoie une image déréalisante et dévalorisante de leur travail tout en les empêchant de se munir des outils critiques et des titres sociaux qu’il mérite ; elle est funeste pour la qualité de leurs traductions, qui souffrent de ne pas être comprises pour ce qu’elles sont ; et elle est funeste aussi pour la littérature en tant que telle, dont l’existence universelle, c’est-à-dire autonome, dépend entièrement des traductions, qui sont les instruments de consécration par excellence. « Fidélité », « trahison » sont des concepts insuffisants pour penser la relation complexe entre écrire et traduire, car ils décrivent de façon simplistement hiérarchique un phénomène équivoque. À quoi doit-on être fidèle en traduisant : à la « langue source » ou à la « langue cible » ? Au « style » ou au « sens » ? À l’auteur ou au lecteur ? Henri Meschonnic, dans son récent Poétique du traduire (2), plaide avec force pour un changement fondamental de paradigme et pour l’élaboration d’une théorie critique, d’une « poétique » de la traduction, contre la vieille dichotomie entre le sens et le style :
« Le paradoxe de la traduction n’est pas, comme on croit communément, qu’elle doit traduire, et serait ainsi radicalement différente du texte qui n’avait qu’à s’inventer. Il est qu’elle doit, elle aussi, être une invention de discours, si ce qu’elle traduit l’a été. C’est le rapport très fort entre écrire et traduire. Si traduire ne fait pas cette invention, ne prend pas ce risque, le discours n’est plus que de la langue, le risque n’est plus que du déjà fait, l’énonciation n’est plus que de l’énoncé, au lieu du rythme il n’y a plus que du sens. Traduire a changé de sémantique, et ne s’en est pas rendu compte. La parabole est celle de l’écriture même. »
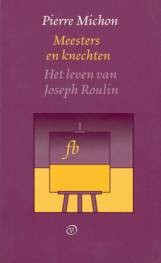 Ce qu’on traduit, ce ne sont pas des langues mais des textes. Le texte traduit est un texte second : c’est donc qu’il est parasitaire, on pourrait aller jusqu’à dire qu’il vampirise l’original ; mais aussi qu’il est, jusqu’à un certain degré, autonome, en rivalité avec le texte primaire. D’une part le traducteur doit essayer de rendre compte de toute la complexité syntaxique et sémantique de ce texte primaire ; d’autre part il doit essayer d’imprimer à son texte un souffle, un rythme, la « scansion vaine, despotique et sourde » (Vie de Joseph Roulin) qui a régi l’écriture première. Le travail du traducteur ne se borne pas à être celui d’un intermédiaire, d’un « passeur » – même si pour traduire il doit évidemment comprendre et interpréter. Ce n’est qu’en osant abandonner le texte original qu’il peut avoir une chance réelle de le retrouver, de recréer un texte littéraire autonome dans sa langue. Si la traduction ne commence que là où elle s’invente, un traducteur ne peut être réellement « fidèle » que pour autant qu’il est prêt à « trahir ». Et puisque nous sommes dans le registre amoureux, cette dialectique entre auteur et traducteur pourrait peut-être mieux s’exprimer comme un rapport d’ « amour libre », expression qui, pour être une contradiction dans les termes, a au moins le mérite de rendre sensible à la tension insoluble caractéristique du rapport entre texte écrit et texte traduit.
Ce qu’on traduit, ce ne sont pas des langues mais des textes. Le texte traduit est un texte second : c’est donc qu’il est parasitaire, on pourrait aller jusqu’à dire qu’il vampirise l’original ; mais aussi qu’il est, jusqu’à un certain degré, autonome, en rivalité avec le texte primaire. D’une part le traducteur doit essayer de rendre compte de toute la complexité syntaxique et sémantique de ce texte primaire ; d’autre part il doit essayer d’imprimer à son texte un souffle, un rythme, la « scansion vaine, despotique et sourde » (Vie de Joseph Roulin) qui a régi l’écriture première. Le travail du traducteur ne se borne pas à être celui d’un intermédiaire, d’un « passeur » – même si pour traduire il doit évidemment comprendre et interpréter. Ce n’est qu’en osant abandonner le texte original qu’il peut avoir une chance réelle de le retrouver, de recréer un texte littéraire autonome dans sa langue. Si la traduction ne commence que là où elle s’invente, un traducteur ne peut être réellement « fidèle » que pour autant qu’il est prêt à « trahir ». Et puisque nous sommes dans le registre amoureux, cette dialectique entre auteur et traducteur pourrait peut-être mieux s’exprimer comme un rapport d’ « amour libre », expression qui, pour être une contradiction dans les termes, a au moins le mérite de rendre sensible à la tension insoluble caractéristique du rapport entre texte écrit et texte traduit.
Aux Pays-Bas, je l’écris sans fausse modestie, Pierre Michon a été intensément traduit. Après une première avortée (la traduction en 1991, l’année Van Gogh, de Vie de Joseph Roulin, sous le titre De postbode van Van Gogh, traduction – maladroite – de Marijke Jansen), la publication, chez l’éditeur Van Oorschot, des œuvres majeures a eu lieu durant la deuxième moitié des années 90 à un rythme régulier : Meesters en knechten et Het leven van Joseph Roulin (Maîtres et serviteurs, suivi de Vie de Joseph Roulin) en 1996 (avec une postface de Manet van Montfrans), De hengelaars van Castelnau (La Grande Beune) en 1997, Rimbaud de zoon (Rimbaud le fils) en 1998, et Roemloze levens (Vies minuscules) en 2001 ; ces deux dernières éditions ont été assorties d’un appareil de notes en fin de volume, jugé nécessaire pour expliquer certaines des références historiques, culturelles ou littéraires qui émaillent le texte. Plusieurs traductions ont paru en revue : De Koning van het woud (Le Roi du bois) en 1998, Drie wonderen in Ierland (Trois prodiges en Irlande) en 1999, Negen keer over de Causse (Neuf passages du Causse) et De vader van de tekst (Le Père du texte) en 2000. Si les ventes des traductions néerlandaises ont été très confidentielles, la réception critique de l’œuvre semble enfin démarrer : l’importante revue De revisor, animée par P.F. Thomése, lui a consacré en décembre 2000 un dossier de 70 pages, contenant, outre des traductions, six textes d’auteurs et de traducteurs faisant état d’un enthousiasme marqué pour un auteur si peu canonisé – comme dit l’édito : « Michon fait partie des royaux parmi nous, qui créent avec chaque livre des catégories nouvelles (et en rend désuètes quelques autres). »

Il est difficile de dire précisément le pourquoi de cette intense traduction. Il y a fallu évidemment les conditions nécessaires que sont un éditeur courageux et un traducteur mordu, mais le fait qu’une « petite » littérature comme la néerlandaise soit marquée par une absorption asymétrique des « grandes » littératures ne suffit pas à expliquer le phénomène. Est-ce l’étrangeté stylistique des textes de Michon, leur violence formelle et inséparablement émotive, qui séduit et qui choque dans une littérature sous domination anglo-saxonne, avec son cortège de textes naïvement réalistes ? Le côté classiciste, dix-septièmiste des textes de Michon est inévitablement perçu par le lecteur néerlandais, qui n’a pas cette référence à un âge d’or littéraire et culturel, comme passablement maniéré ; dans Vies minuscules, ce classicisme stylistique se trouve encore renforcé par le « maniérisme » caractéristique de l’opera prima. Par bonheur, les artifices de style sont chez Michon sans cesse comme démentis et relativisés par les ruptures de registre et de rythme qui ancrent ses textes dans la contemporanéité et l’oralité, et ce sont ces ruptures sans doute qui peuvent assurer à la traduction sa « lisibilité » dans un contexte autre. Est-ce le statut « excentré » de Michon dans le domaine français, malgré sa consécration en haut lieu, qui fait que son œuvre peut rencontrer aux Pays-Bas, région relativement excentrée du monde littéraire, des sensibilités propres à percevoir sa grandeur tragique ? Michon, comme Faulkner, a cette particularité de décrire des lieux (le monde rural) ou des époques (le Haut Moyen Âge) qu’on peut dire périphériques, même s’il met à l’œuvre toutes les ressources formelles et esthétiques élaborées dans les centres ; en outre, son inspiration prend notamment appui sur des auteurs radicalement extérieurs à l’histoire littéraire française – je pense à des anglo-saxons comme, justement, Faulkner, mais aussi Melville, Kipling ou Conrad, eux-mêmes relativement marginaux de leur vivant. Personnellement, je tends à croire que c’est aussi la référence, nostalgique mais persistante, dans l’œuvre de Michon d’une transcendance d’ordre religieux (3) qui peut réveiller chez certains néerlandais, dont la langue et la culture restent profondément marquées par des références bibliques, des nostalgies qu’ils ne sont plus habitués à voir exprimées.
Durant mon travail de traduction des textes de Pierre Michon, ininterrompu depuis 1992, je me suis fabriqué, pour mon usage personnel, une petite théorie intuitive de ma « stratégie traductrice », comme disent les traductologues. Cette stratégie est une sorte de politique à double objectif, que j’ai appelée, en néerlandais, de bekkentrekkerij van de vertaler, ce qui pourrait se traduire par « les façons-sans-façon » du traducteur. Trekken, c’est tirer, étirer, essayer de fléchir ou de tordre le néerlandais de façon à le faire épouser les mouvements du français, plus élastique avec ses interminables subordonnées, ses participes présents (cauchemar du traducteur), la densité de son phrasé – c’est donc ce qui ressortit aux façons, à l’affectation et à l’artifice rhétorique du discours. Bekken, à l’inverse, c’est ce qui ressortit au sans-façon, au langage oral, à la faconde ; le mot, lié au vieux français « bec », est le terme qu’emploient les acteurs de théâtre néerlandais pour dire qu’un texte a « de la gueule ». Avoir des « façons-sans-façon » signifie pour moi qu’il me fallait traduire sur le fil du rasoir, au plus serré : tout faire pour que le lecteur néerlandais éprouve la singularité du français de Michon, et en même temps, ne pas rater une occasion pour qu’il se sente chez lui dans le texte, de sorte qu’il lui accorde le crédit qui ferait admettre aussi les passages contournés ou cryptés. Tout se passait comme si la captatio verborum, la chasse au verbe constitutive de la traduction, s’inscrivait sans arrêt dans une captatio benevolentiae, une tentative de s’attirer la bienveillance du lecteur, en le rendant confiant que ce qu’il lit est bien voulu comme tel et ne relève pas d’une quelconque maladresse. Évidemment, cette double stratégie en soi ne résout rien, car la question de savoir où il faut préférer les solutions cryptées, plus rugueuses et donc plus exotiques à l’oreille néerlandaise, et où il faut préférer les solutions claires, plus naturelles à cette oreille, reste sans réponse, une question d’intuition, un point de discussion avec les lecteurs critiques du traducteur ou avec Manet van Montfans, critique inlassable et directrice de la collection Franse Bibliotheek de l’éditeur Van Oorschot, dans laquelle ont paru toutes les traductions de Michon.
 Cette petite théorie spontanée a ses limites, car elle vise avant tout la transmission adéquate du sens. Or, traduisant Michon, il s’agit de traduire des textes très particuliers, des discours qui tiennent par la voix d’un seul, voix dont je dois tenter, tant bien que mal, de rendre le timbre, l’ampleur, le grain singuliers, avec les mots qui sont les miens. D’autres parleront, mieux que moi, des caractéristiques de la prose de Michon, de son énergie, de sa violence, de sa poésie. Ce qui m’importe ici, c’est que les textes de Michon imposent, comme dirait Barthes, une lecture poétique ou métaphorique, c’est-à-dire rythmée, gonflée du souffle et de l’émotion qui l’ont fait naître, qui active le corps du lecteur, une lecture qui n’est pas seulement métonymique comme celle du lecteur de romans qui s’oublie dans sa lecture. Il importe donc que la traduction se fasse, elle aussi, au-delà des contraintes de sens, résonance d’une voix. C’est là que se joue la liberté du traducteur, dans cette interférence permanente du sens, du rythme et de la sonorité. Pierre Michon lui-même a bien compris la nature de cette nécessaire liberté. J’en veux pour preuve ces quelques extraits de lettre, révélateurs du souci d’encourager le traducteur à prendre ses responsabilités stylistiques. À propos des métaphores récurrentes qui ponctuent Rimbaud le fils, Michon écrit : « Elles ont entraîné le sens, elles l’ont généré. C’est donc en effet sur elles que doit porter le principal effort de traduction, et ça ne doit pas être facile : si je peux vous donner un conseil, ce serait de vous laisser porter par la logique de votre propre langue, quitte à me trahir un peu […]. En général, je tiens beaucoup au son. Quand une polysémie vous semble impossible à rendre en totalité, choisissez le sens dont le son vous semble le plus heureux. » (13/01/93) Expliquant l’hérésie horticole des « glaïeuls sur l’eau », à la fin du texte sur Goya, Michon explique : « Je suis conscient de l’écart, je l’ai voulu. C’était une question de sonorités en français. Tu choisis comme tu veux avec ta langue (le mot « glaïeul » est comme « triomphant »). » (11/12/94). Et concernant « la source de miel et de lait » que le petit Bernard, dans La Grande Beune, sait inaccessible « en quelque endroit », Michon précise : « Le corps de la mère ne peut être donné au fils, suivant la loi universelle de prohibition de l’inceste. C’est ce qui est énoncé là, et tu peux prendre des libertés pour l’énoncer à ta façon. » (03/11/96)
Cette petite théorie spontanée a ses limites, car elle vise avant tout la transmission adéquate du sens. Or, traduisant Michon, il s’agit de traduire des textes très particuliers, des discours qui tiennent par la voix d’un seul, voix dont je dois tenter, tant bien que mal, de rendre le timbre, l’ampleur, le grain singuliers, avec les mots qui sont les miens. D’autres parleront, mieux que moi, des caractéristiques de la prose de Michon, de son énergie, de sa violence, de sa poésie. Ce qui m’importe ici, c’est que les textes de Michon imposent, comme dirait Barthes, une lecture poétique ou métaphorique, c’est-à-dire rythmée, gonflée du souffle et de l’émotion qui l’ont fait naître, qui active le corps du lecteur, une lecture qui n’est pas seulement métonymique comme celle du lecteur de romans qui s’oublie dans sa lecture. Il importe donc que la traduction se fasse, elle aussi, au-delà des contraintes de sens, résonance d’une voix. C’est là que se joue la liberté du traducteur, dans cette interférence permanente du sens, du rythme et de la sonorité. Pierre Michon lui-même a bien compris la nature de cette nécessaire liberté. J’en veux pour preuve ces quelques extraits de lettre, révélateurs du souci d’encourager le traducteur à prendre ses responsabilités stylistiques. À propos des métaphores récurrentes qui ponctuent Rimbaud le fils, Michon écrit : « Elles ont entraîné le sens, elles l’ont généré. C’est donc en effet sur elles que doit porter le principal effort de traduction, et ça ne doit pas être facile : si je peux vous donner un conseil, ce serait de vous laisser porter par la logique de votre propre langue, quitte à me trahir un peu […]. En général, je tiens beaucoup au son. Quand une polysémie vous semble impossible à rendre en totalité, choisissez le sens dont le son vous semble le plus heureux. » (13/01/93) Expliquant l’hérésie horticole des « glaïeuls sur l’eau », à la fin du texte sur Goya, Michon explique : « Je suis conscient de l’écart, je l’ai voulu. C’était une question de sonorités en français. Tu choisis comme tu veux avec ta langue (le mot « glaïeul » est comme « triomphant »). » (11/12/94). Et concernant « la source de miel et de lait » que le petit Bernard, dans La Grande Beune, sait inaccessible « en quelque endroit », Michon précise : « Le corps de la mère ne peut être donné au fils, suivant la loi universelle de prohibition de l’inceste. C’est ce qui est énoncé là, et tu peux prendre des libertés pour l’énoncer à ta façon. » (03/11/96)
Une comparaison point par point entre original et traduction révèlerait aussi bien les « pertes » que les « gains » de cette dernière. La vraie question, c’est de savoir si la traduction dans son ensemble fonctionne, si le « système du discours », comme dirait Meschonnic, est préservé. Il y a certainement des rythmes, des allitérations, des euphonies qui se perdent en traduction, mais il y en aussi qui se gagnent ; il y a des connotations qui pour un lecteur néerlandais sont effacées, qui même pour le traducteur sont imperceptibles, mais il y en a aussi qui viennent à l’existence grâce au décentrement du texte dans un contexte lexical, littéraire et culturel neuf. Martin de Haan, traducteur et critique, va jusqu’à supposer que la langue qui structure l’inconscient de Michon doit fortement ressembler au néerlandais, au vu des magnifiques oppositions minimales qu’on trouve dans la traduction de La Grande Beune : witte wanden / rode wonden (parois blanches / plaies rouges), witte vissen / rode vossen (poissons blancs / renards rouges) (4). Et à un autre niveau, on peut se demander si cette Creuse dépeuplée et archaïque des Vies minuscules ne pourrait pas être, pour le lecteur néerlandais, aussi envoûtante que le Mississippi de Faulkner, aussi exotique que le Léon de Juan Benet, aussi mythique que le Macondo de García Márquez – et devenir ainsi une terre de légendes bien plus étrange, obscure et troublante qu’elle n’est pour un lecteur qui connaît la signification de l’expression « France profonde » et le ton sur lequel on la prononce.
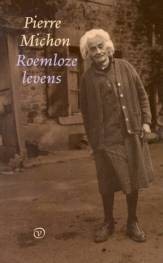 Pourquoi considérer les traductions seulement comme de pâles imitations, des déperditions, des pis-aller, au lieu de les voir comme des reprises dignes des originaux, potentiellement aussi belles, efficaces, littéraires ? Et, dans un même ordre d’idées, pourquoi reprendre encore le vieux poncif de l’humilité et de la modestie statutaires du traducteur, serviteur d’un maître éternellement hors d’atteinte, au lieu de voir l’auteur irrévérencieusement comme le serviteur, le « nègre » qui livre au traducteur le matériau brut dont lui, maître styliste, fait de la littérature – en l’occurrence, de la littérature néerlandaise, une littérature mineure, petite, dominée, mais de la littérature malgré tout ? S’il m’est arrivé durant mon travail sur les textes de Michon d’avoir de tels accès d’hybris traductrice, de telles bravades rivales de l’auteur, « cette audace, ou cette inconscience, cette force sans réplique » (pour citer Michon parlant de Faulkner), ils sont restés rares. Le sentiment ordinaire, c’est bien celui du traducteur qui modestement patauge, qui se consume dans un sourd désespoir, quand la traduction idéale semble encore une fois hors de portée. Le plus souvent, le traducteur de Pierre Michon est un minuscule, si par minuscule on entend le fait d’être confronté à plus grand que soi, à être dépassé et à ne pouvoir s’en remettre. Car même si mes traductions arrivaient par moments à être aussi sonores, aussi rythmées, aussi passionnées, et par le jeu des compensations et des décalages, aussi riches en connotations que les originaux, il reste au moins deux points où elles accusent le coup de leur statut second.
Pourquoi considérer les traductions seulement comme de pâles imitations, des déperditions, des pis-aller, au lieu de les voir comme des reprises dignes des originaux, potentiellement aussi belles, efficaces, littéraires ? Et, dans un même ordre d’idées, pourquoi reprendre encore le vieux poncif de l’humilité et de la modestie statutaires du traducteur, serviteur d’un maître éternellement hors d’atteinte, au lieu de voir l’auteur irrévérencieusement comme le serviteur, le « nègre » qui livre au traducteur le matériau brut dont lui, maître styliste, fait de la littérature – en l’occurrence, de la littérature néerlandaise, une littérature mineure, petite, dominée, mais de la littérature malgré tout ? S’il m’est arrivé durant mon travail sur les textes de Michon d’avoir de tels accès d’hybris traductrice, de telles bravades rivales de l’auteur, « cette audace, ou cette inconscience, cette force sans réplique » (pour citer Michon parlant de Faulkner), ils sont restés rares. Le sentiment ordinaire, c’est bien celui du traducteur qui modestement patauge, qui se consume dans un sourd désespoir, quand la traduction idéale semble encore une fois hors de portée. Le plus souvent, le traducteur de Pierre Michon est un minuscule, si par minuscule on entend le fait d’être confronté à plus grand que soi, à être dépassé et à ne pouvoir s’en remettre. Car même si mes traductions arrivaient par moments à être aussi sonores, aussi rythmées, aussi passionnées, et par le jeu des compensations et des décalages, aussi riches en connotations que les originaux, il reste au moins deux points où elles accusent le coup de leur statut second.
En premier lieu, l’auteur jouit malgré tout de libertés que le traducteur ne peut que lui envier, libertés syntaxiques, prosodiques et lexicales qui lui permettent d’exploiter au maximum les possibilités du français, de déjouer les écueils des clichés et d’augmenter la force d’évocation, au sens fort d’incantation, de ses phrases. Le traducteur, lui, subit à un degré plus élevé les contraintes des conventions littéraires de sa langue, dans la mesure où son autonomie créatrice, qui est aussi son autonomie sociale, est plus restreinte. Il est parfois difficile à un traducteur, et surtout s’il n’est pas consacré en tant que tel, de prendre par rapport aux canons du bien parler et du bien écrire les mêmes libertés que l’auteur. Ainsi, dans les « Vies des frères Bakroot », il faut de la persévérance pour faire admettre la traduction de mots comme « mômes » (« […] les gris-gris qu’amassent certains mômes ») ou « pattes » (« les livres, […], enrubannés peut-être, si mal assortis aux vieilles pattes du latiniste ») par des mots aussi argotiques que dans l’original français. De même, il faut oser bouleverser l’emploi conventionnel en néerlandais de signes de ponctuation comme le point-virgule et le deux-points, signes du classicisme auxquels Michon est si attaché, et qui servent chez lui à ramasser et à accumuler le sens ; mon parti-pris a été de faire une concession pour le deux-points, qui en néerlandais sert uniquement à introduire ce qui suit et n’a pas la fonction logique d’articulation qu’il reçoit chez Michon, quitte à faire un emploi immodéré et, si on veut, subversif du point-virgule.
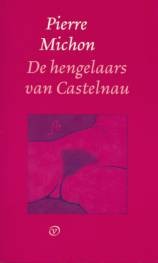 En deuxième lieu, l’auteur peut se référer, pour la compréhension de sa propre pratique, à des concepts romantiques comme l’inspiration ou l’originalité, qui ne valent pas de la même façon pour le traducteur. Ainsi, la métaphysique de la Grâce, ironiquement décrite dans Vies minuscules comme une « pieuse sottise », est inutilisable pour un traducteur, même le plus imbu de prétentions auctoriales. « Je ne croyais qu’à la Grâce ; elle ne m’était point échue ; je dédaignais de condescendre aux Œuvres, persuadé que le travail qu’eût exigé leur accomplissement, si acharné qu’il fût, ne m’élèverait jamais au-dessus d’une condition d’obscur convers besogneux. » (« Vie de Georges Bandy », p.137). Le traducteur, lui, est « l’obscur convers besogneux » qui condescend aux Œuvres ; nulle scansion transcendante ne lui souffle son texte ; il doit s’en remettre à l’état toujours provisoire de sa dernière version. La grâce ne lui est point échue, contrairement à celui dont le texte, par miracle, a été écrit.
En deuxième lieu, l’auteur peut se référer, pour la compréhension de sa propre pratique, à des concepts romantiques comme l’inspiration ou l’originalité, qui ne valent pas de la même façon pour le traducteur. Ainsi, la métaphysique de la Grâce, ironiquement décrite dans Vies minuscules comme une « pieuse sottise », est inutilisable pour un traducteur, même le plus imbu de prétentions auctoriales. « Je ne croyais qu’à la Grâce ; elle ne m’était point échue ; je dédaignais de condescendre aux Œuvres, persuadé que le travail qu’eût exigé leur accomplissement, si acharné qu’il fût, ne m’élèverait jamais au-dessus d’une condition d’obscur convers besogneux. » (« Vie de Georges Bandy », p.137). Le traducteur, lui, est « l’obscur convers besogneux » qui condescend aux Œuvres ; nulle scansion transcendante ne lui souffle son texte ; il doit s’en remettre à l’état toujours provisoire de sa dernière version. La grâce ne lui est point échue, contrairement à celui dont le texte, par miracle, a été écrit.
Et pourtant, la grâce n’est peut-être pas définitivement étrangère à son travail. Parfois, quand une phrase archifrançaise, chargée de toute la densité sémantique et stylistique de l’original devient, par un bonheur d’expression tout contingent ou par l’emploi d’une locution discrète mais tout à fait idiomatique, quelque chose d’inaliénablement néerlandais, ce qui pourrait bien être de la grâce devient perceptible au traducteur : l’intraduisible traduit, l’irremplaçable remplacé, l’invention réinventée – c’est du Michon, c’est méconnaissable, mais c’est encore du Michon. Ce que j’ose dans mes traductions espérer : la grâce de ressusciter en néerlandais cette voix, dans le vœu pieux que son projet messianique, ressusciter les morts, ait une chance, une fois encore, de réussir.
Il y a un pathos spécifique lié à la traduction d’un texte pathétique, qui ne se réduit ni à la difficulté technique de la tâche, ni à l’investissement psychique qu’elle demande, ni au rapport fétichiste que le traducteur entretient avec le texte à traduire. Les textes de Michon, le traducteur doit en laisser se décanter en lui la charge émotive, pour la résoudre en un examen d’alternatives qui se veut rationnel ; il éprouve la charge passionnelle dans le rythme de l’original, mais ne peut s’en remettre au « mécanisme d’ivresse », comme Michon l’appelle, dont cet original est le produit. Ce qu’il peut essayer de faire, c’est se camper dans cette impossibilité, s’y tenir, s’ouvrir à ce qui sépare le pathos de l’auteur de ses propres tentatives de le reproduire. Alors peut-être naît la possibilité que sa traduction se charge de quelque chose de plus grand que lui-même.
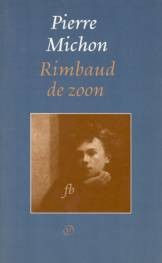 C’est dans mon rapport à ce pathos que j’ai pu me sentir assez proche parfois du héros michonien de Vies minuscules, cet écrivain virtuel, fantasmatique, souffrant de son mutisme et de son invisibilité, et cela malgré tout ce qui me sépare de ce personnage sur le plan sociologique, culturel et biogra- phique. Dans le corps à corps avec le texte à traduire, le traducteur qui fait des « façons-sans-facon » se dédouble en une créature hybride : piocheur immanent et perfec- tionniste transcendant, clerc qui tire du spectacle de ses imperfections un désir jamais réalisé de perfection – qui n’est rien d’autre que le désir du aimez-moi qu’incarne le texte original. La description de la deuxième messe de l’abbé Bandy, vers la fin de sa Vie, est devenue pour moi une sorte d’exemplification hyperbolique de cette situation ambiguë. En traduisant Michon, je serais, à la fois ou alternativement, Bandy devenu vieux qui, « avec une furieuse modestie », célèbre la messe, pâle imitation des messes flamboyantes de sa jeunesse, un « écorcheur de mots conscient de l’être et tant bien que mal y remédiant », qui s’en remet à son habitude et à sa persévérance – et un jeune écrivain sans écrit « qui amèrement s’extasie, stupéfait, rassuré », à son écoute, dont la conscience aiguë, exacerbée de cette faillite du verbe parfois lui permettrait de se hisser au-dessus de lui-même. « Le masque était parfait, et pathétique l’effort pour n’avoir d’autre visage que ce masque. »
C’est dans mon rapport à ce pathos que j’ai pu me sentir assez proche parfois du héros michonien de Vies minuscules, cet écrivain virtuel, fantasmatique, souffrant de son mutisme et de son invisibilité, et cela malgré tout ce qui me sépare de ce personnage sur le plan sociologique, culturel et biogra- phique. Dans le corps à corps avec le texte à traduire, le traducteur qui fait des « façons-sans-facon » se dédouble en une créature hybride : piocheur immanent et perfec- tionniste transcendant, clerc qui tire du spectacle de ses imperfections un désir jamais réalisé de perfection – qui n’est rien d’autre que le désir du aimez-moi qu’incarne le texte original. La description de la deuxième messe de l’abbé Bandy, vers la fin de sa Vie, est devenue pour moi une sorte d’exemplification hyperbolique de cette situation ambiguë. En traduisant Michon, je serais, à la fois ou alternativement, Bandy devenu vieux qui, « avec une furieuse modestie », célèbre la messe, pâle imitation des messes flamboyantes de sa jeunesse, un « écorcheur de mots conscient de l’être et tant bien que mal y remédiant », qui s’en remet à son habitude et à sa persévérance – et un jeune écrivain sans écrit « qui amèrement s’extasie, stupéfait, rassuré », à son écoute, dont la conscience aiguë, exacerbée de cette faillite du verbe parfois lui permettrait de se hisser au-dessus de lui-même. « Le masque était parfait, et pathétique l’effort pour n’avoir d’autre visage que ce masque. »
Rokus Hofstede
(1) R. Barthes, « Sur la lecture », Le bruissement de la langue, Essais critiques IV, Seuil, Paris, 1984, p.37-48.
(2) H. Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, Lagrasse, 1999, p.459-460.
(3) R. Hofstede, « “Je sentais la sacristie” : Pierre Michon et le Très-Haut », Rapports – Het Franse Boek, 1997, 67/1, p.27-34.
(4) M. de Haan, « Rood en wit », De revisor, 27/6, 2000, p.32.




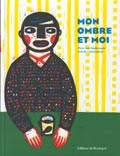 plus deux ou trois questions à poser. Il est très utile aussi d’entendre l’auteur lire quelques pages de son livre. Cela permet de mieux entendre le texte et le ton du texte, d’autant plus que le néerlandais est une langue à accentuation de mot (selon la syllabe qu’on accentue, le mot change de sens) et que là où le français réclame des points d’exclamation et autres points d’interrogation, lui se contente bien souvent d’accentuer une syllabe en jouant avec la place des mots dans la phrase.
plus deux ou trois questions à poser. Il est très utile aussi d’entendre l’auteur lire quelques pages de son livre. Cela permet de mieux entendre le texte et le ton du texte, d’autant plus que le néerlandais est une langue à accentuation de mot (selon la syllabe qu’on accentue, le mot change de sens) et que là où le français réclame des points d’exclamation et autres points d’interrogation, lui se contente bien souvent d’accentuer une syllabe en jouant avec la place des mots dans la phrase. Oreille d’homme, de Bart Moeyaert, coll. doAdo
Oreille d’homme, de Bart Moeyaert, coll. doAdo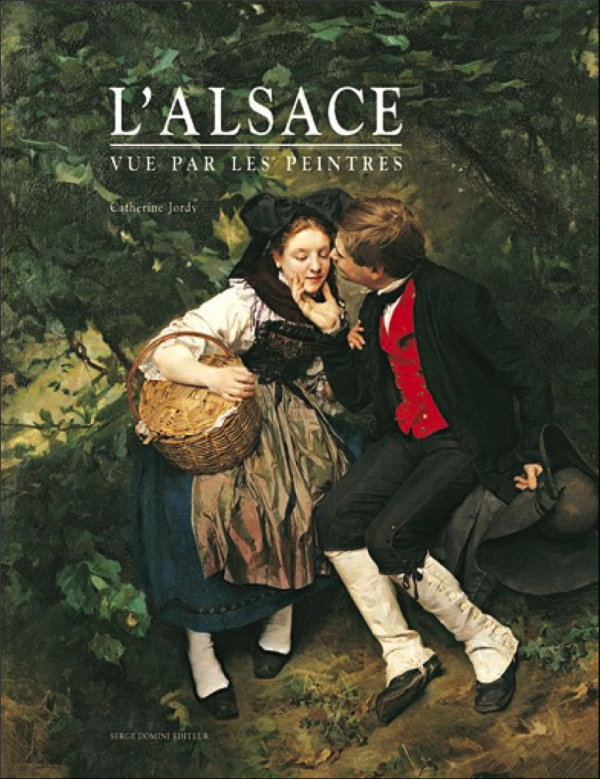
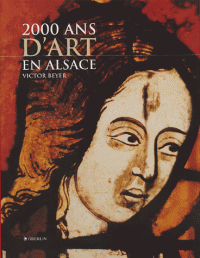
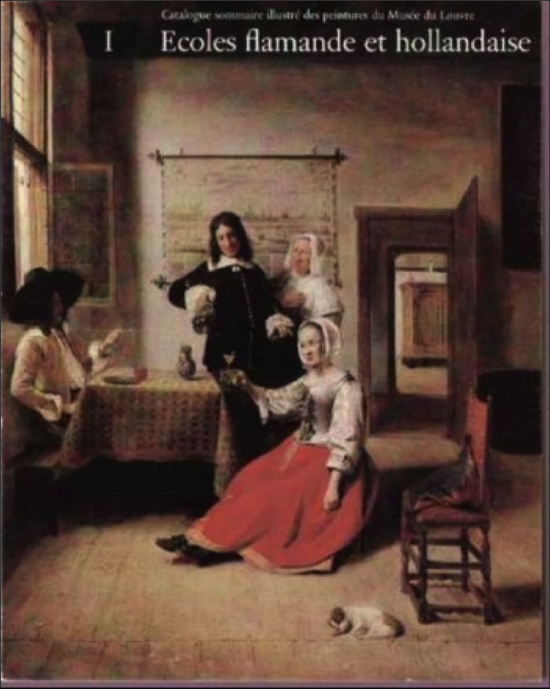

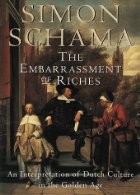

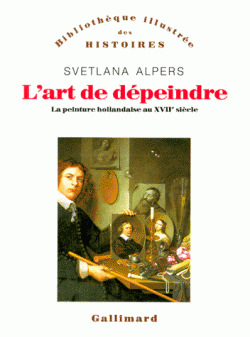
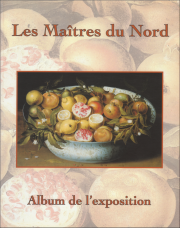


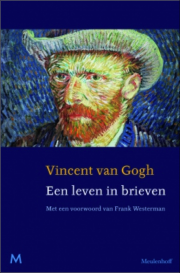


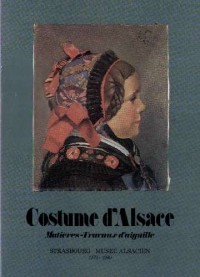
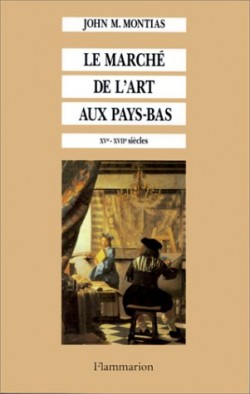 (19) Voir John M. Montias,
(19) Voir John M. Montias,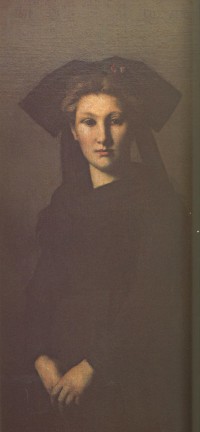

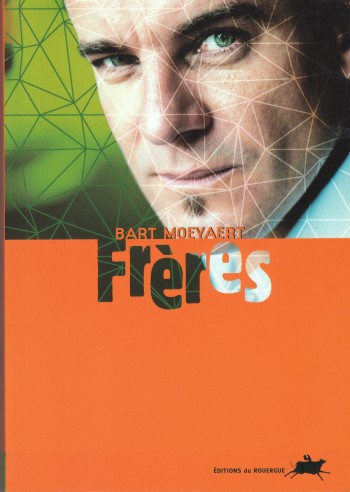
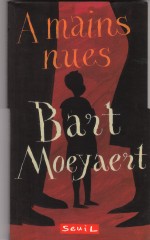 Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...
Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...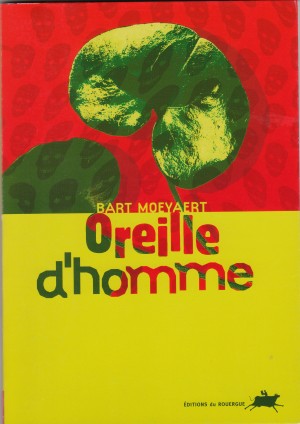
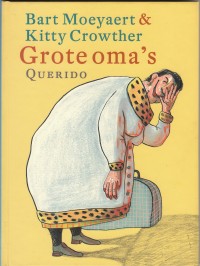 Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.
Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.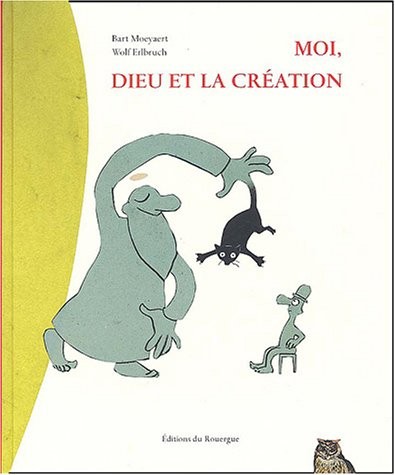
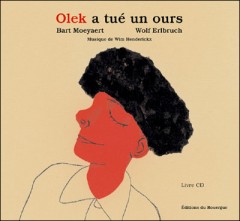 Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail.
Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail. Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” »
Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” »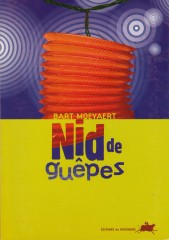 Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ».
Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ».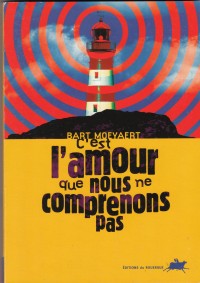 Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».
Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».