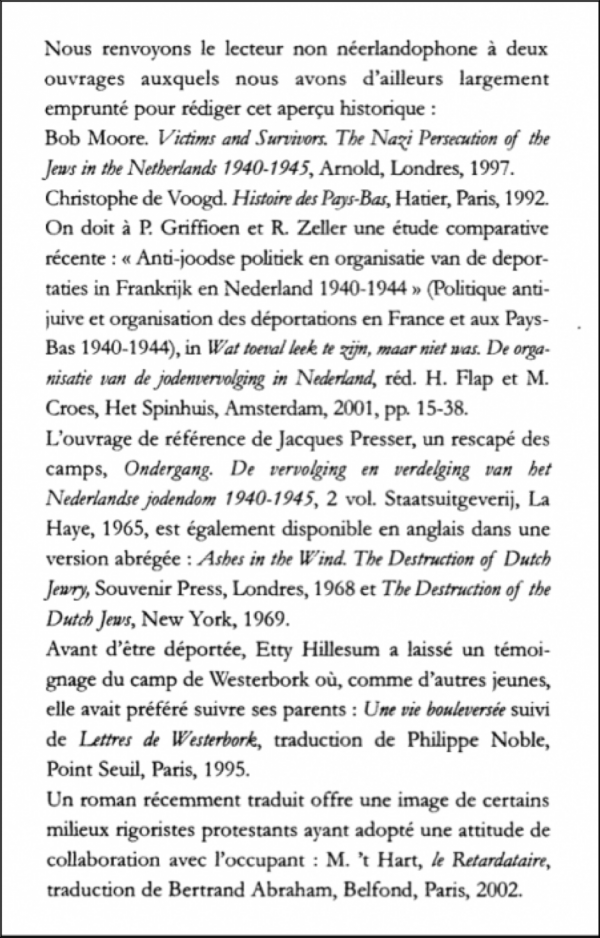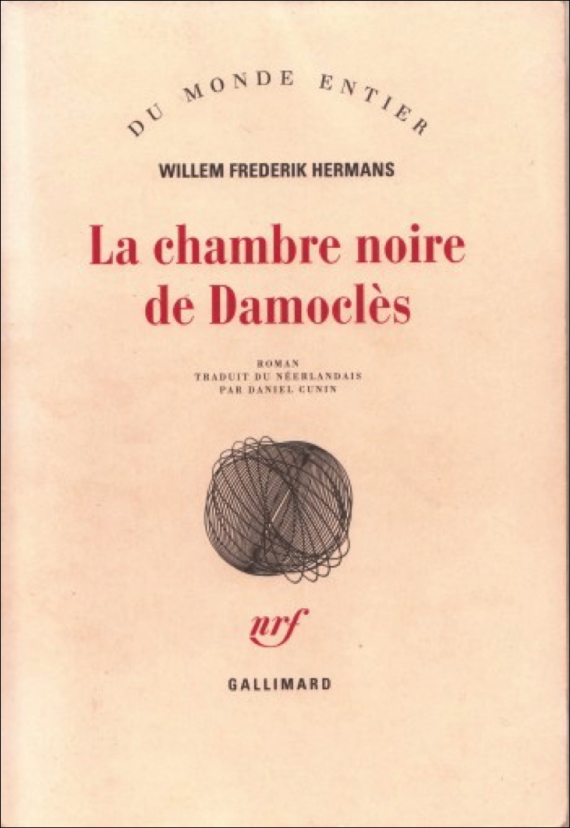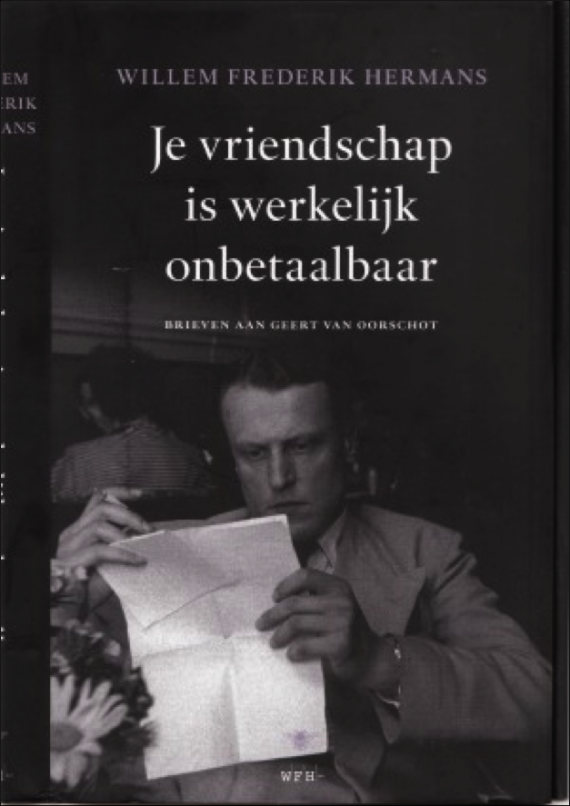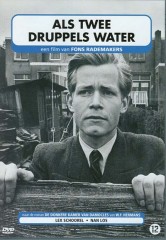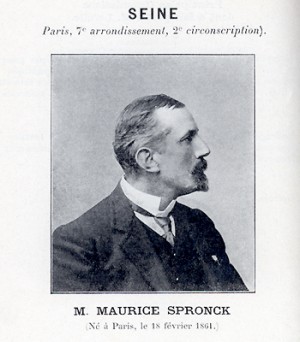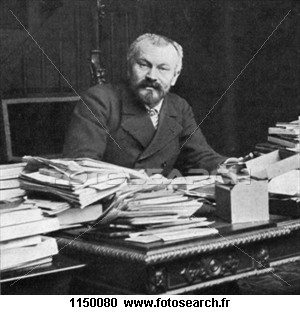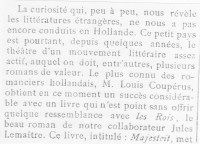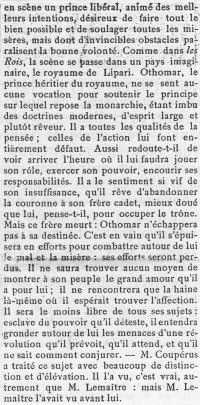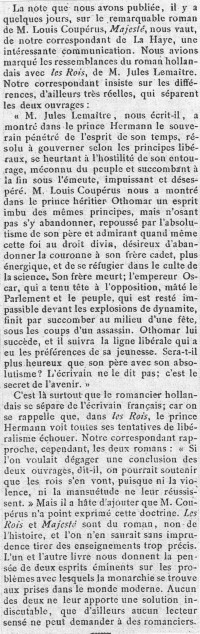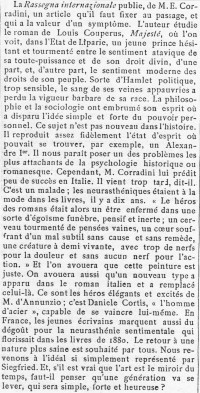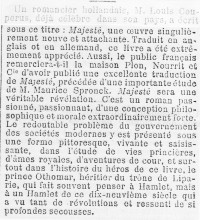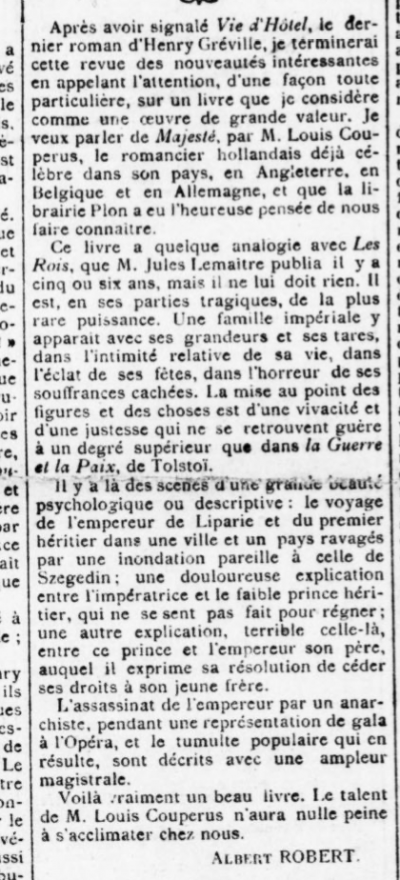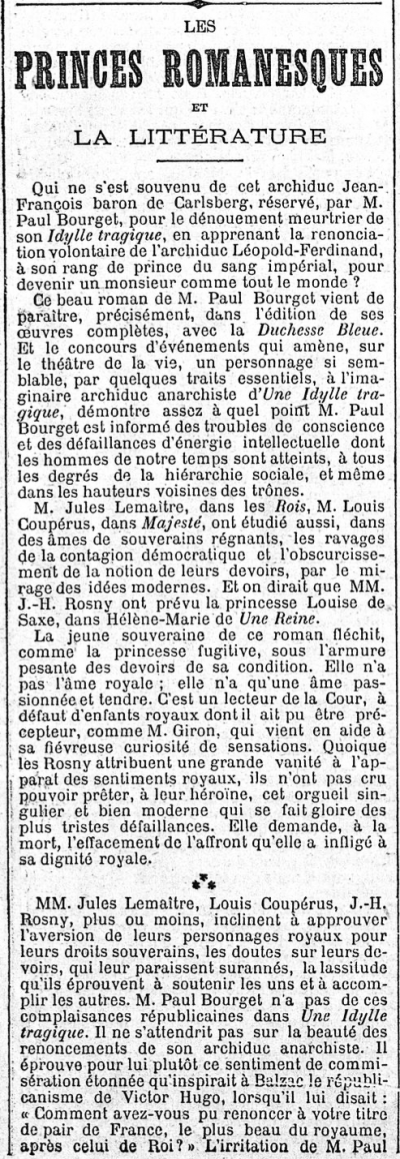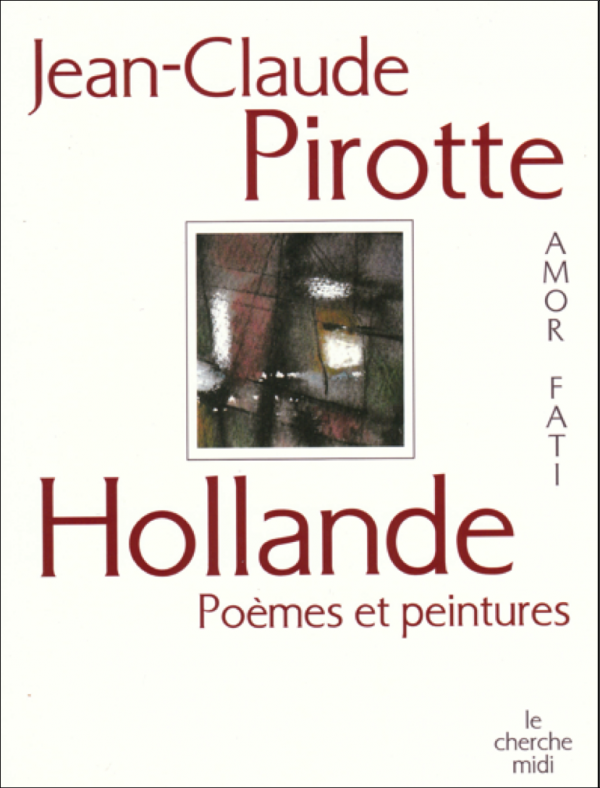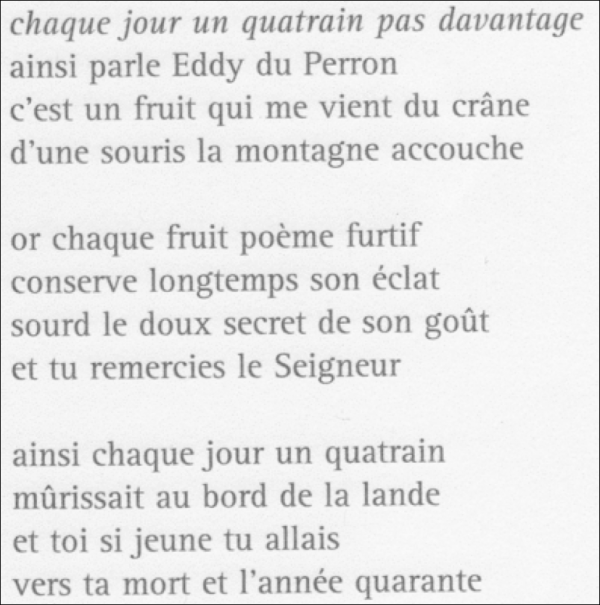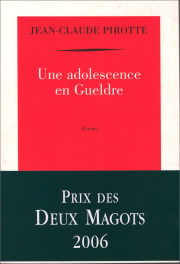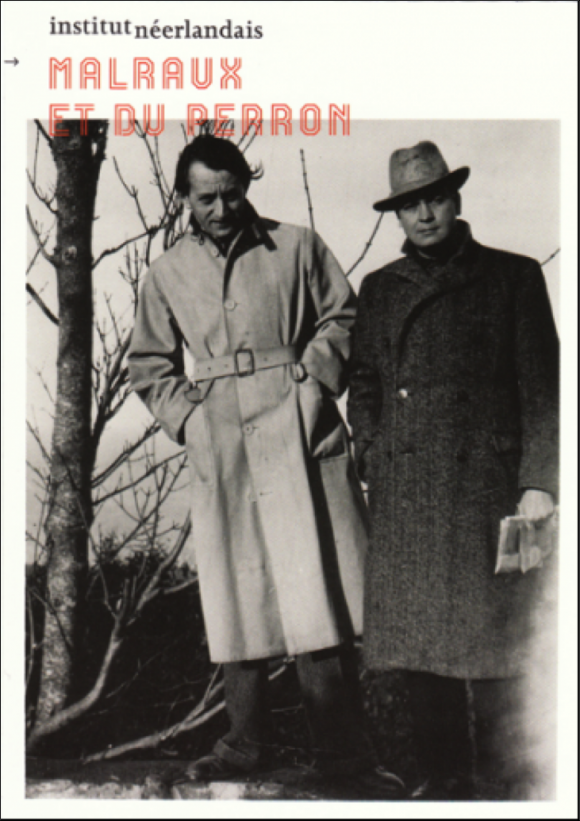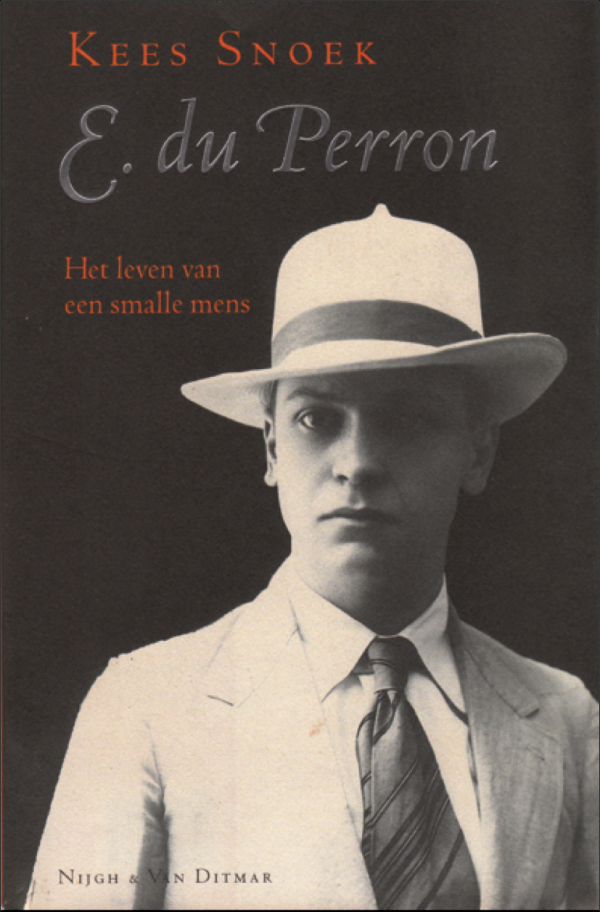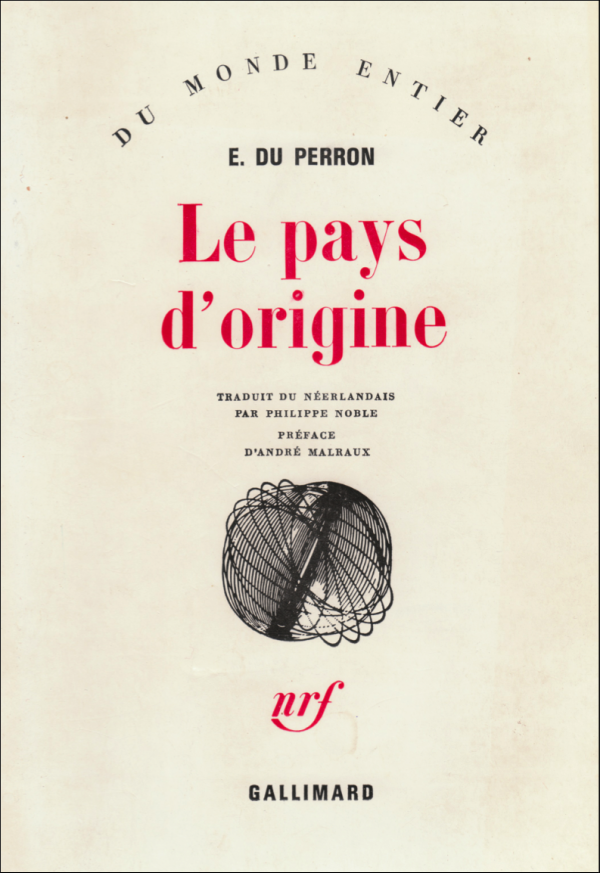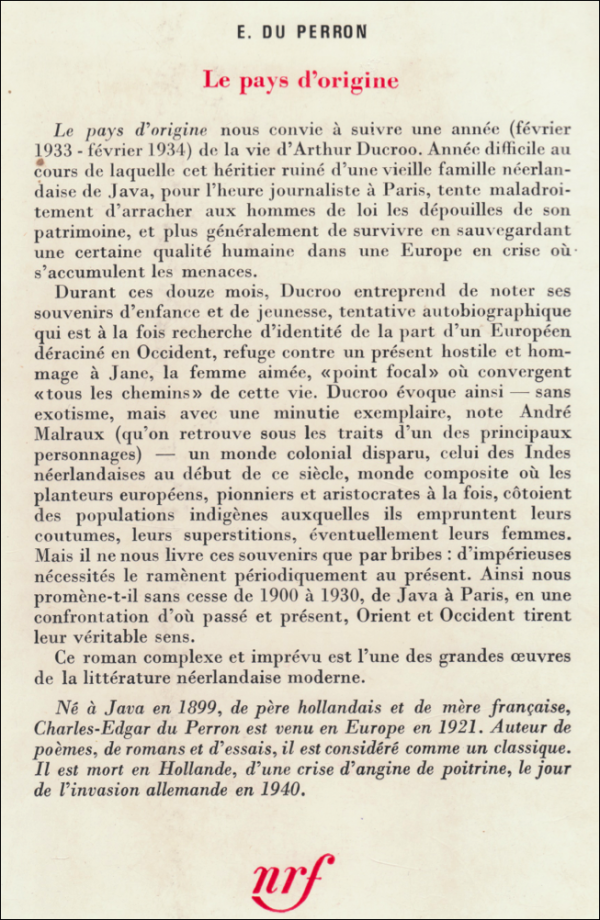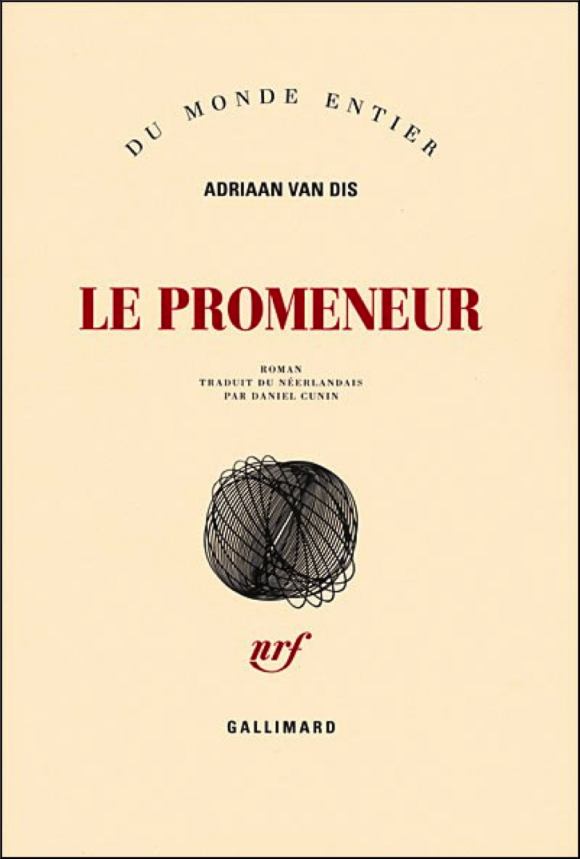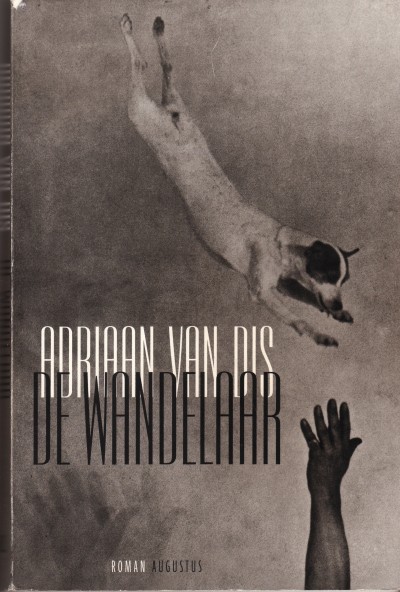T’as une sacrée chance, toi
Lettres néerlandaises et persécution des juifs
à travers un livre de Marga Minco
Le texte présenté ci-dessous, « Les Pays-Bas durant la Deuxième Guerre mondiale et la persécution des juifs : un aperçu historique », a été publié en annexe du livre de Marga Minco, T’as une sacrée chance, toi (Paris, Caractères, 2003), un choix de nouvelles traduites qui retracent de façon fragmentaire le sort d’une famille juive néerlandaise de la veille de la guerre aux lendemains de la libération.
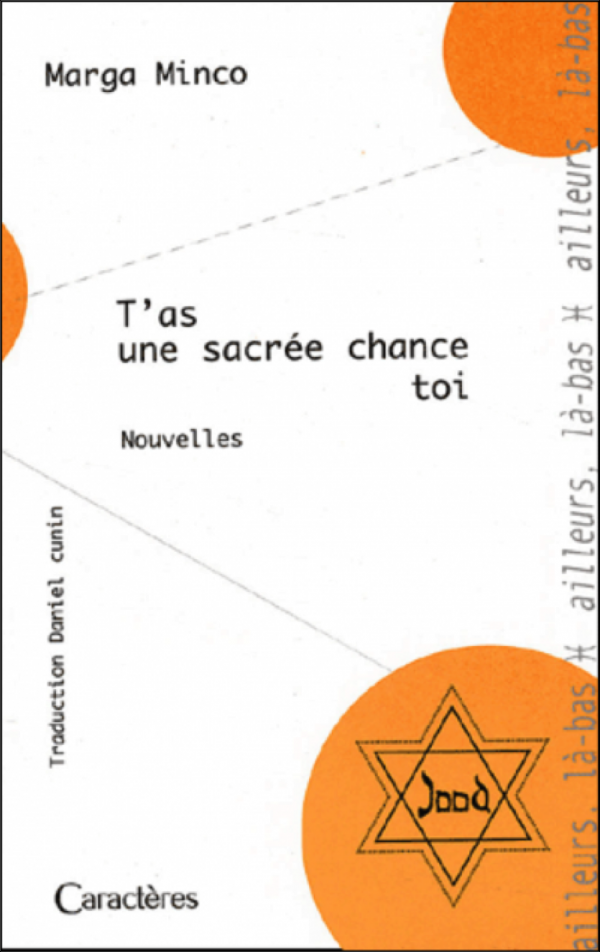
Dans « Ces blessures qui ne cicatrisent jamais », postface de ce recueil, Dorian Cumps (1) présente l’auteur et son œuvre en ces termes : « Née en 1920 près de Breda (sud des Pays-Bas) dans une famille juive pratiquante, Marga Minco, de son vrai nom Sara Menco, est l’auteur d’une œuvre sobre et forte, presque entièrement marquée par la tragédie de la Shoah, le sort des survivants et l’impossible oubli d’un monde disparu. Le demi-pseudonyme que la romancière s’est choisi est à cet égard significatif : Minco était en réalité le patronyme de son grand-père, orthographié Menco suite à une erreur d’un employé de l’état civil ; Marga, diminutif de Margaretha, correspond à un prénom d’emprunt, que l’écrivain a utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, afin d’échapper aux rafles et à la déportation. On retrouve ici deux thèmes présents dans les nouvelles réunies dans ce recueil : l’attachement au noyau familial, source de sécurité et de bonheur, et la nécessité pour les juifs de travestir leur état civil ou de vivre sous une fausse identité, une obligation qui les a plongés dans une crise identitaire et le déracinement. Marga Minco fut, avec un de ses oncles paternels, la seule survivante de sa famille. Ses parents, ses frère et sœur aînés ainsi que leur conjoint respectif et nombre de ses proches périrent dans les camps d’extermination nazis (la plupart à Sobibor, dans l’Est de la Pologne). Après la guerre, elle a épousé un résistant non juif, le poète, traducteur et journaliste Bert Voeten (1918-1992). Ce dernier a publié dès 1946 son journal de l’occupation, Doortocht (la Traversée), dans lequel il a intégré des éléments de l’histoire de Marga Minco. Elle, de son côté, a attendu plus de dix ans avant de publier sa relation des années noires, Het bittere kruid (1957, trad. L. Fessard, les Herbes amères, J.C. Lattès, 1977). Portant comme sous-titre « une petite chronique », ce récit a connu et connaît toujours un succès de librairie impressionnant aux Pays-Bas (…) et fait presque figure de concurrent du fameux Journal d’Anne Frank. (…) Rédigé à la première personne, ce texte est raconté par une Anne Frank qui aurait survécu. Le document humain qu’il est incontestablement ne saurait occulter son statut d’œuvre de fiction. Contrairement à la plupart des témoignages néerlandais sur la persécution des juifs et la Shoah, tels les écrits d’Etty Hillesum (2) ou le récit Kinderjaren (Années d’enfance, trad. Ph. Noble, Mercure de France, 1978) de Jona Oberski, les Herbes amères se présentent dès le départ comme une œuvre littéraire ; très largement autobiographique, le texte introduit une subtile distance entre vécu de l’auteur et relation littéraire, une pratique qui est d’ailleurs l’une des caractéristiques majeures de l’ensemble de l’œuvre de Minco. »
À propos de la littérature des Pays-Bas qui traite de la période 1939-1945, D. Cumps distingue trois phases : « Immédiatement après la guerre paraissent surtout des témoignages de première main – journaux, récits de rescapés de l’univers concentrationnaire, dont certains écrits par des Juifs comme Abel Herzberg (Amor Fati, 1946), ainsi que des romans glorifiant des actes de résistance comme ceux du communiste Theun de Vries. Certes, quelques romanciers soulèvent la controverse en apportant des nuances à l’image convenue d’un peuple néerlandais irréprochable dans son opposition à l’occupant. Il faut toutefois attendre la fin des années cinquante pour assister à une problématisation purement littéraire de la guerre, comme dans les grands romans à portée philosophique de Willem Frederik Hermans – De donkere kamer van Damokles (1958, la Chambre noire de Damoclès) (3) – et de Harry Mulisch – Het stenen bruidsbed (1959, Noces de pierre, trad. Mady Buysse & Ph. Noble, Calmann-Lévy, 1984), où la peinture de l’occupation n’est plus que prétexte à une interrogation générale sur la responsabilité de l’individu face aux vicissitudes de l’existence. Bien que de teneur plus intimiste, les premiers romans de Marga Minco appartiennent également à cette seconde vague, au même titre qu’un court roman comme De nacht der Girondijnen (1957, la Nuit des Girondins, trad. S. Margueron, Maurice Nadeau, 1990) de l’historien Jacques Presser, consacré à la prise de conscience de la judéité chez un auxiliaire juif du camp de transit de Westerbork, le Drancy hollandais. Quant à la Chute, troisième œuvre de Minco, on peut considérer qu’elle participe d’une approche ultérieure, telle qu’on la rencontre au même moment dans De aanslag (1982, l’Attentat, trad. Ph. Noble, Calmann-Lévy, 1984) de Harry Mulisch. Les événements ont désormais fait place à leur signification à postériori dans la mémoire des rescapés, l’action de la Chute se situant d’ailleurs à l’époque contemporaine. » (4)
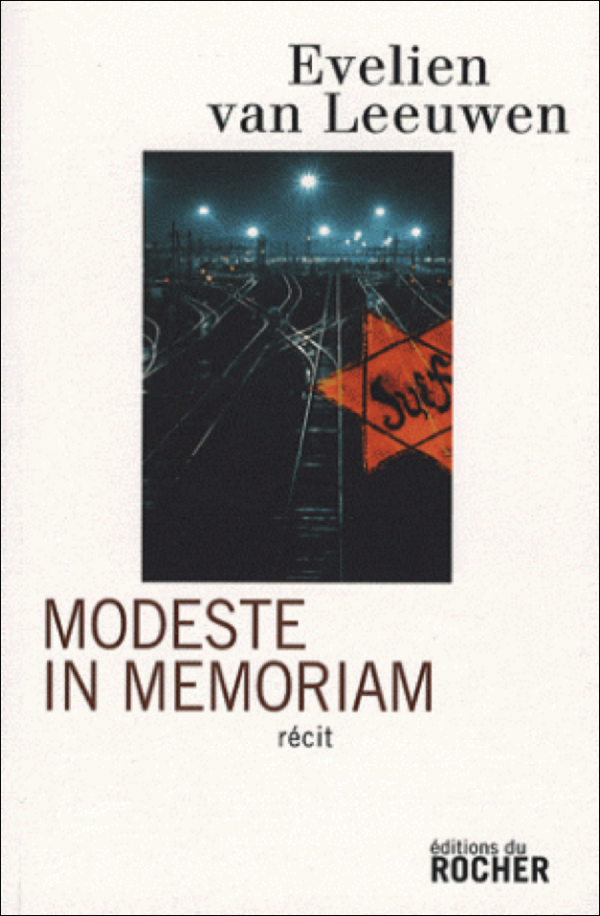
Dans cette production, un livre n’est pas sans rappeler, par sa « sobriété littéraire », les récits de Marga Minco : Klein in memoriam (1983, Modeste in memoriam, Le Rocher, 2007) d’Evelien van Leeuwen, témoignage d’une rescapée, à propos duquel René de Ceccatty écrit : « Les grands livres ont leur temps, comme les justes confidences. Ils attendent le moment opportun, pour être écrits, publiés, traduits. (…) La mémoire obsessionnelle d’Evelien van Leeuwen est, quarante ans plus tard, d’une précision millimétrique. C’est une mémoire blanche et plate : sans reliefs et sans ombres. (…) Les derniers chapitres de ce livre admirable sont peut-être les plus admirables eux-mêmes, parce que, échappant au récit de l’horreur, l’auteur sort du temps de cette mémoire lointaine. » (Le Monde, 11.01.2008)
En lisant les œuvres de Marga Minco (5 courts romans et quelques recueils de nouvelles, soit moins de 1000 pages en tout), on constate que l’auteur réduit la place du persécuteur au strict minimum : les Allemands n’ont jamais la parole ; quand ils ne sont pas réduits au pronom personnel « ils », c’est qu’ils ont disparu de la narration ; les mesures discriminatoires elles aussi subissent une sorte d’effacement en particulier grâce à l’ellipse ; s’il est question de l’Allemagne, c’est uniquement parce qu’il s’agit du pays d’où viennent certains juifs. Cette mise en silence des nazis, mais aussi de l’horreur, fait écho au traumatisme vécu. L’une des rares fois où un nazi est désigné nommément, c’est dans la courte nouvelle la Radio (1967, qui ne figure pas dans T’as une sacrée chance, toi) basée sur un souvenir de l’auteur datant de 1933. La jeune narratrice se voit un jour obligée d’écouter chez des tiers la radio : il s’agit en fait d’un discours d’Hitler, des « beuglements » du « chien mexicain » lui dit-on. Quelques années plus tard, elle entend cette même voix qui envahit toute la maison :
Une après-midi, rentrant du collège, alors que j’accrochais mon manteau dans l’entrée, j’ai entendu quelqu’un qui parlait bruyamment. Le bruit provenait du salon. Aucune voix ne lui répondait. Tout du long un rude monologue. Croyant que quelqu’un nous rendait visite, quelqu’un ayant une conversation peu avenante ou qui était venu dire ses quatre vérités à un membre de ma famille, j’ai ouvert avec précaution la porte et ai regardé par l’entrebâillement.
Dans la pièce, mon père et mon frère étaient debout chacun d’un côté de la cheminée. Ils tenaient la tête un peu penchée, silencieux, les yeux posés sur le haut-parleur de la radio.
- Qui c’est qui hurle comme ça ? j’ai demandé en avançant.
- C’est Hitler, a dit mon père.
De la main, il m’a fait comprendre que je devais me taire.
Je suis restée là quelques instants à écouter. Je venais juste de commencer à apprendre l’allemand à l’école, aussi n’ai-je pas saisi grand-chose. Le seul mot que j’aie compris, c’est Juden, que l’homme prononçait avec une fréquence toujours plus grande et sur un ton toujours plus méprisant, à croire qu’il lui donnait des coups de pied. Dans ma chambre, à l’étage, la voix me parvenait toujours. Elle pénétrait le moindre recoin de la maison.
La collégienne monte ensuite au grenier où la voix continue de lui parvenir. Revenue dans sa chambre, elle est saisie du même sentiment que le jour où elle a entendu cette voix pour la première fois. La nouvelle se termine sur ces mots :
J’ai ressenti la même chose que quelques années plus tôt lorsque […] j’avais pour la première fois écouté la radio. Le chien mexicain. J’ai pressé plus fort encore mes mains sur mes oreilles, comme si je sentais inconsciemment ce que cette voix allait provoquer.
(1) De ce spécialiste du romancier néerlandais F. Bordewijk (1884-1965), on peut lire « La langue et la littérature néerlandaises des origines à nos jours ».
(2) Voir l’édition la plus récente et la plus complète : Les écrits d’Etty Hillesum , Journaux et lettres, 1941-1943, trad. Philippe Noble avec la collaboration d’Isabelle Rosselin, Le Seuil, 2008.
(3) Voir sur cet écrivain et sur ce roman la notice « Chambre noire & Leica » dans la Catégorie : Auteurs néerlandais. W.F. Hermans a écrit d’autres œuvres dont l’action se déroule durant les années de la guerre, en particulier le roman les Larmes des acacias. Par ailleurs, il a suscité une vive polémique en dénonçant dans certains écrits l’attitude et les activités de Friedr ich Weinreb pendant l’occupation.
(4) Signalons encore parmi les nombreuses œuvres littéraires qui traitent de ces événements, celle, marquante, de G.L. Durlacher (1928-1996), un des survivants des « Birkenau Boys », traduite en bonne partie en anglais et en allemand ; Tralievader (Mon père couleur de nuit, trad. Mireille Cohendy, Denoël, 2001, Folio n° 3801) de Carl Friedman ; Montyn (1982), roman-biographie sur le peintre Jan Montyn par Dirk A. Kooiman (traduit en anglais et en allemand) ; diverses œuvres du Parisien d’adoption Robert Franquinet (1915-1979), par exemple le roman Drijfzand (Sables mouvants, 1977) où traitements subis dans les geôles nazies et obsessions érotiques se mêlent ; enfin un roman jeunesse sur le dernier hiver de la guerre : Oorlogswinter de Jan Terlouw, traduit en français par Robert Petit sous le titre Michel (G.P. coll. Grand Aigle, 1976).
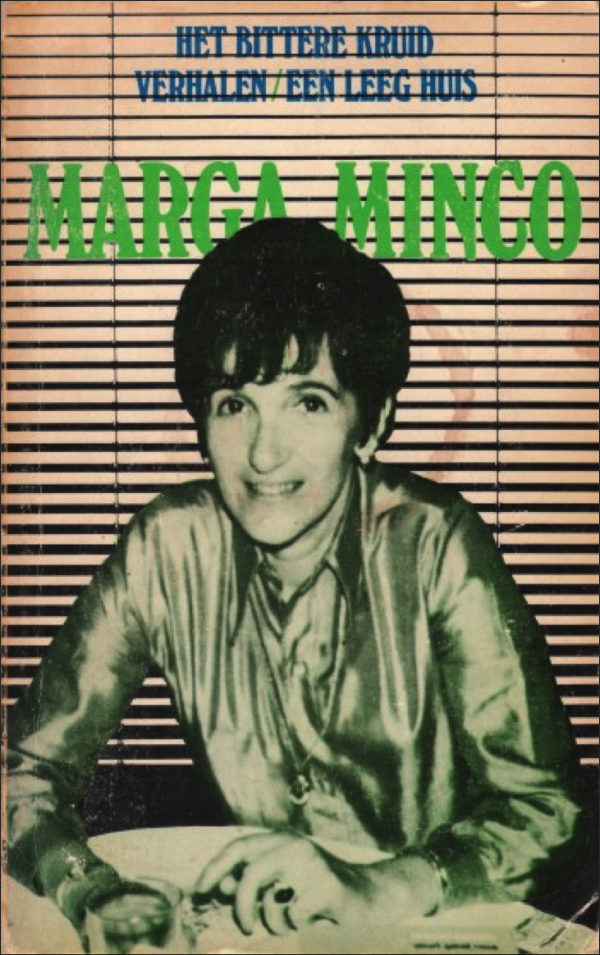
une édition de 1976, Bert Bakker, Amsterdam
Œuvres majeures de Marga Minco
Het bittere kruid (1957, Les Herbes amères)
De andere kant (1959, L’Autre côté)
Het huis hiernaast (1965, La Maison d’à côté)
Een leeg huis (1966, Une Maison vide)
Terugkeer (1968, Retour, nouvelle)
Meneer Frits en andere verhalen uit de vijftiger jaren (1974, M. Frits et autres histoires des années 50, livre jeunesse)
De val (1983 La Chute,)
De glazen brug (1986, Le Pont de verre)
De verdwenen bladzij en andere kinderverhalen (1994, La Page disparue et autres histoires pour enfants)
Nagelaten dagen (1997, Jours posthumes, roman)
Storing (2004, Panne, recueil de nouvelles)
Achter de muur (2010, Derrière le mur, nouvelles)
Les nouvelles ont été réunies à plusieurs reprises en un volume
extrait d'un entretien avec Marga Minco
Les Pays-Bas durant la Deuxième Guerre mondiale
et la persécution des juifs : un aperçu historique
Épargnés de justesse par la Grande Guerre, les Pays-Bas crurent pouvoir préserver une nouvelle fois leur neutralité quelques décennies plus tard. La politique pacifiste menée jusqu’à la moitié des années trente fit en fait du territoire une proie facile pour l’envahisseur nazi. Au petit matin du 10 mai 1940, les troupes allemandes, qui ont pour objectif d’envahir la France par sa frontière septentrionale, entrent dans une Hollande incrédule. Si certains Néerlandais décident de fuir à l’étranger, la grande majorité de la population, surprise par la rapidité de l’attaque, semble, dans sa naïveté, se refuser à croire à la réalité. L’armée locale ne peut pas même opposer un char à la Wehrmacht. Les poches de résistance et l’arrivée de troupes alliées incitent toutefois les Allemands à en finir au plus vite. Le 14 mai, Rotterdam est bombardée ; on dénombre des centaines de morts dans une ville dont le centre historique est autant dire rayé de la carte. Face à la crainte de voir le scénario se renouveler sur une autre ville, les forces néerlandaises capitulent dès le lendemain.
La reine Wilhelmine et le gouvernement se sont réfugiés en Angleterre quelques jours plus tôt. C’est depuis Londres et le Canada que le pouvoir en exil va tenter, non sans de nombreuses divergences, de regagner petit à petit l’estime de ses compatriotes grâce en particulier aux discours de la souveraine diffusés par Radio-Orange. Devant le départ des autorités en place, Hitler, qui avait certainement compté s’appuyer sur un gouvernement de collaboration pour établir un régime militaire, décide de mettre en place une autorité civile allemande à la tête de laquelle il place un Reichskommissar, l’homme de l’Anschluß, Arthur Seyss-Inquart. Ce régime diffère de celui instauré par exemple en France en ceci qu’il laisse beaucoup plus de liberté d’action à la Waffen S.S. ou encore à la police allemande ; il se révèle d’ailleurs plus « efficient » que ceux mis en place en Belgique ou dans l’Hexagone.
L’occupation dure près de cinq ans, ne prenant fin, du moins pour la partie du pays qui se situe au nord du Rhin et de la Meuse, que le 5 mai 1945, après un dernier hiver terrible, resté dans toutes les mémoires comme « l’hiver de la faim » ou « l’hiver de la famine ». Le 5 septembre 1944, du fait de l’avancée des alliés et de la propagation de rumeurs trop optimistes, on a cru dans une grande partie de la Hollande que le pays était déjà libéré ; ce jour, resté célèbre sous le nom de dolle dinsdag (mardi fou), a coûté la vie à de nombreuses personnes sorties dans les rues pour fêter un événement qui n’allait devenir réalité que huit mois plus tard.
Si les confrontations militaires sont restées somme toute limitées – l’offensive alliée en septembre 1944, qui se solde par l’échec de la bataille d’Arnhem, étant la plus marquante –, le pays n’a pas moins terriblement souffert, en particulier du fait de l’effort économique imposé par l’envahisseur, de la pénurie de pratiquement tous les produits de première nécessité (dans un pays à dominante urbaine) et du travail obligatoire en Allemagne auquel plusieurs centaines de milliers d’hommes ont dû se soumettre, à commencer par les nombreux chômeurs. Si la Hollande n’a pas connu les mêmes excès de l’épuration qu’en France, il n’en reste pas moins que plus de 100000 personnes soupçonnées de collaboration sont internées dans des camps après la libération (un mot qui ne prend pas de majuscule en néerlandais non plus d’ailleurs que celui de résistance). Sur 141 condamnations à mort prononcées, 40 seront appliquées dans ce pays qui a aboli la peine de mort dès 1861 (sauf, justement, pour les crimes de guerre). On limoge par ailleurs 500 maires et plus de 10000 fonctionnaires. Bien que condamnés à mort par la justice néerlandaise, quatre des principaux criminels de guerre allemands passeront finalement plusieurs dizaines d’années dans en prison.
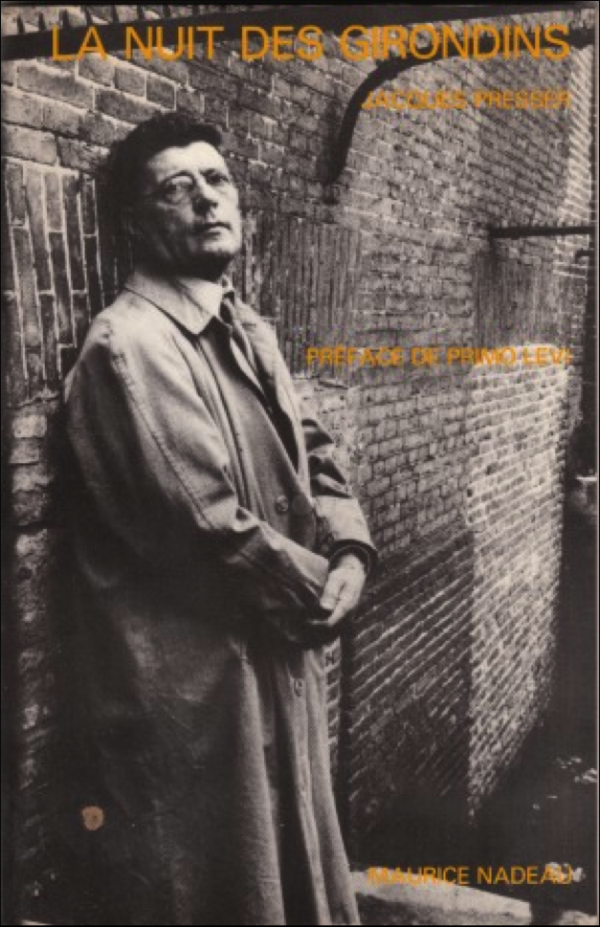
La Nuit des Girondins, préface de Primo Levi, Maurice Nadeau, 1990
Bellicistes à l’occasion dans leur Empire colonial – on songe à ce qui s’est passé en Indonésie –, les Hollandais ont eu en revanche pour habitude de se montrer modérés sur le vieux Continent. L’extrémisme n’a jamais eu chez eux droit de cité. Électoralement, le communisme a toujours été voué à la peau de chagrin. Et malgré quelques succès électoraux, le Mouvement National-Socialiste (NSB, fondé en 1931) est quant à lui resté relativement marginal jusqu’à la guerre – et plus encore à mesure qu’il adoptait des positions antisémites. Au début de l’occupation, ce parti ne se voit dans un premier temps reconnaitre aucun rôle dans la direction du pays. C’est en fait sur l’Union néerlandaise, un mouvement de masse créé peu après l’invasion, qui prônait une sorte de « révolution nationale » et qui compta bientôt plusieurs centaines de milliers de membres, que l’occupant préfère s’appuyer pour nazifier « en douceur » le pays. Le nouveau pouvoir, soucieux de ne pas froisser la sensibilité néerlandaise, et persuadé que le territoire était appelé à être annexé par la Grande Allemagne, puisque peuplé d’aryens germaniques, choisit en effet d’attendre avant de prendre des mesures répressives radicales. Mais dès 1941, les Allemands optent pour la fermeté en créant entre autres, en novembre, une Kultuurkamer (Chambre de culture) – dont par exemple tout écrivain devait devenir membre s’il entendait pouvoir continuer de publier – et un Front du travail ou encore en interdisant, en décembre, tous les partis politiques à l’exception du NSB. Le seul journal juif dont ils autorisent la publication est en fait un organe à leur solde (l’hebdomadaire het Joodsche Weekblad que Marga Minco évoque à plusieurs reprises dans son roman le Pont de verre.)
Dans le même temps, la résistance s’organise tant bien que mal. Elle reste cependant dispersée, à l’image de la société néerlandaise rigoureusement cloisonnée depuis des décennies en pans confessionnels, politiques et idéologiques (les « piliers » du fameux verzuiling : protestants, catholiques, socialistes, « humanistes » ...). Dans cette organisation verticale de la société, la conduite de chacun était en grande partie dictée par une certaine philosophie de vie et les contacts entre personnes prônant des convictions différentes étaient plutôt rares. On peut même avancer que le verzuiling favorisait de fait une certaine discrimination des minorités puisque les groupes ne relevant pas des « piliers » majeurs vivaient finalement isolés dans leur coin. La communauté juive par exemple (1,5 % de la population dans les années 1930), même si elle était installée depuis bien longtemps dans le pays et était composée à 83 % de nationaux, évoluait pour une part, et tout en étant parfaitement intégrée, à l’écart des autres. Pendant la guerre, chaque « pilier » publie ainsi ses propres journaux clandestins dont certains font aujourd’hui encore partie des fleurons de la presse (Trouw, Het Parool). Même si elle a compté quelques figures emblématiques – par exemple le carmélite Titus Bransma –, cette résistance est restée relativement modeste, surtout sur le plan militaire, du fait d’un manque évident de coordination, mais aussi du peu de soutien venant de l’extérieur et plus simplement de la géographie du pays – un pays sans maquis, sans reliefs. Elle s’est essentiellement contentée d’actions sporadiques, par exemple la destruction de registres de l’état civil, capitale pour protéger les personnes vivant dans la clandestinité. On peut dire qu’à partir du printemps 1943, la population, tout en restant dans sa grande majorité passive, ne se soumet plus au diktat nazi.
Si les Allemands prennent la précaution de ne pas édicter des lois raciales dès leur prise de pouvoir, ils ne tardent guère toutefois à concocter des mesures qui vont progressivement acculer les juifs dans une position très précaire. On commence par exclure ceux-ci de l’enseignement, des emplois publics et de la vie économique. On fait signer à tous les fonctionnaires une déclaration d’arianisme. Dès la fin octobre 1940, un arrêté définit ce qu’il faut entendre par le terme Jood (juif), le but étant d’identifier les 140000 juifs vivant aux Pays-Bas. Le 10 janvier 1941, obligation est faite à ceux-ci d’aller se faire enregistrer. C’est cette obligation qu’évoque Marga Minco dans la nouvelle le Jour où ma sœur s’est mariée, à propos de l’un des oncles de la narratrice qui, par mégarde, avait déclaré être « à moitié juif » avant de retourner corriger sa déclaration et confirmer qu’il était bien un Volljuden. Un bureau avait été ouvert spécialement dans les communes. La population juive s’est rendue en masse à cet appel, chaque personne recevant une carte jaune non sans débourser un florin. L’attitude du personnage de la nouvelle illustre la docilité des juifs néerlandais : à l’image de leurs compatriotes, plutôt que d’enfreindre la loi (et d’encourir en l’occurrence une peine de 5 ans de prison), ils avaient tendance à obéir aux autorités dans la mesure où cela n’entraînait pas de conséquences fâcheuses immédiates. Cette docilité des Néerlandais n’a pu qu’être renforcée par l’attitude des hauts fonctionnaires appelés par le gouvernement en exil à obéir à l’occupant tant qu’ils ne contrevenaient pas à la Constitution. L’animosité des juifs néerlandais envers les milliers de juifs allemands réfugiés aux Pays-Bas a pu par ailleurs faire croire à beaucoup des premiers que les nazis n’allaient pas leur faire subir le sort qu’ils avaient réservé à ces derniers dans l’Allemagne des années 30.
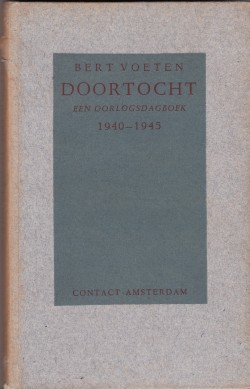 Toujours au début de l’année 1941, les choses s’accélèrent à Amsterdam, depuis toujours la ville où vivait la majorité des israélites. Des groupuscules d’antisémites néerlandais provo- quent la communauté juive ; celle-ci crée des milices pour se défendre. Bientôt, la police alle- mande arrête un certain nombre de ces « terroristes ». La première exécution a lieu, le peloton étant placé sous le commandement d’un certain Klaus Barbie. De- vant l’agitation générée par ces milices, Himmler ordonne d’arrêter 425 jeunes juifs. Il s’agit de la célèbre rafle du 22 février 1941 ; 389 hom- mes allaient finalement être déportés à Buchenwald puis à Mauthausen. Pour protester contre cette première rafle, de nombreux ouvriers d’Amsterdam se mettent en grève les 25 et 27 février. Une grève que l’on commémore encore tous les ans. Suite à ces événements, l’occupant décide de créer la Zentralstelle für jüdische Auswanderung (Bureau central pour l’Émigration juive) ainsi qu’un Conseil juif de manière à disposer d’une courroie de transmission avec la communauté israélite – autrement dit l’UGIF locale. Dirigée par David Cohen et Abraham Asscher, cette institution a offert un emploi à des milliers de leurs coreligionnaires pendant environ deux ans. Après la guerre, tous deux eurent a répondre de leurs actes devant une commission, tant leur attitude conciliante vis à vis de l’occupant avait pu faciliter les mesures de persécution et de déportation. Dès l’automne 1941, ce Conseil remplace les autres instances et, malgré son manque de représentativité, exerce un monopole pour tout ce qui concerne les activités des juifs dans l’ensemble du pays. Il constitue une véritable administration juive au sein d’une administration néerlandaise déjà habituée à travailler avec zèle – très fiables recensements de la population, pièces d’identité de qualité difficiles à falsifier, etc. Aux mains des Allemands, il constitue un instrument qui, dans les premières années de l’occupation, favorise la mise en œuvre des mesures répressives, en particulier à l’encontre des israélites les moins favorisés socialement et économiquement.
Toujours au début de l’année 1941, les choses s’accélèrent à Amsterdam, depuis toujours la ville où vivait la majorité des israélites. Des groupuscules d’antisémites néerlandais provo- quent la communauté juive ; celle-ci crée des milices pour se défendre. Bientôt, la police alle- mande arrête un certain nombre de ces « terroristes ». La première exécution a lieu, le peloton étant placé sous le commandement d’un certain Klaus Barbie. De- vant l’agitation générée par ces milices, Himmler ordonne d’arrêter 425 jeunes juifs. Il s’agit de la célèbre rafle du 22 février 1941 ; 389 hom- mes allaient finalement être déportés à Buchenwald puis à Mauthausen. Pour protester contre cette première rafle, de nombreux ouvriers d’Amsterdam se mettent en grève les 25 et 27 février. Une grève que l’on commémore encore tous les ans. Suite à ces événements, l’occupant décide de créer la Zentralstelle für jüdische Auswanderung (Bureau central pour l’Émigration juive) ainsi qu’un Conseil juif de manière à disposer d’une courroie de transmission avec la communauté israélite – autrement dit l’UGIF locale. Dirigée par David Cohen et Abraham Asscher, cette institution a offert un emploi à des milliers de leurs coreligionnaires pendant environ deux ans. Après la guerre, tous deux eurent a répondre de leurs actes devant une commission, tant leur attitude conciliante vis à vis de l’occupant avait pu faciliter les mesures de persécution et de déportation. Dès l’automne 1941, ce Conseil remplace les autres instances et, malgré son manque de représentativité, exerce un monopole pour tout ce qui concerne les activités des juifs dans l’ensemble du pays. Il constitue une véritable administration juive au sein d’une administration néerlandaise déjà habituée à travailler avec zèle – très fiables recensements de la population, pièces d’identité de qualité difficiles à falsifier, etc. Aux mains des Allemands, il constitue un instrument qui, dans les premières années de l’occupation, favorise la mise en œuvre des mesures répressives, en particulier à l’encontre des israélites les moins favorisés socialement et économiquement.
Le 16 octobre 1941 commence la déportation en masse systématique des juifs allemands vers la Pologne. L’occupant incita les juifs non néerlandais à se faire enregistrer pour « émigrer volontairement ».
Début 1942, la situation devient de plus en plus délicate pour les israélites néerlandais eux-mêmes. À partir de février, un employeur peut licencier comme bon lui semble tout employé juif. Le durcissement des mesures passe en particulier par une obligation faite aux israélites provinciaux de quitter leur domicile pour aller résider à Amsterdam et l’interdiction pour ceux de la capitale (pratiquement 80000 en mai 1941) de déménager. Même si on a pu parler de « quartier juif » (Judenviertel), de « rues juives », il n’a toutefois jamais été question de situation de ghetto. Au tout début du mois de mai, ainsi que l’illustre toujours Le Jour où ma sœur s’est mariée, les juifs se voient dans l’obligation de porter l’étoile jaune – étoile distribuée, ou plutôt vendue par le Conseil juif (4 cents pièce). Début juin 1942, les premières mesures sont prises qui limitent la liberté de déplacement de ces personnes. Toujours en juin, des rafles – la sœur et le beau-frère de la narratrice de cette même nouvelle semblent (et peut-être pas uniquement dans le cadre de la fiction littéraire) avoir été pris dans l’une d’elles – viennent riposter à des sabotages opérés par la résistance : les personnes sont transportées à Mauthausen. En août 1942, tous les israélites doivent faire enregistrer leurs biens auprès d’une ancienne banque juive. (Les nouvelles le Jour où ma sœur s’est mariée et l’Adresse effleurent cette question des biens ayant appartenu aux familles juives : dans la première, la famille a déjà dû quitter sa maison en n’emportant que le strict minimum ; dans la seconde, ces biens sont ramenés à quelques objets de valeur. On estime que 29000 maisons habitées par des juifs ont été vidées - ou comme on le disait à l’époque « pulsées » : une certaine société Puls étant chargée de vider méthodiquement ces habitations.) Enfin, en septembre, interdiction est faite aux israélites de voyager sans autorisation.
À partir de 1942, le commandement allemand aux Pays-Bas doit satisfaire de manière beaucoup plus effective aux exigences de Berlin ; cela passe en particulier par l’observation d’un quota de juifs devant être déportés. Les déportations commencent en juillet 1942. La grande majorité des convois partent entre cette date et septembre 1943 en direction de la Pologne. Quand on évoque le sort de la population juive, on ne peut éviter de revenir aux simples données chiffrées tant elles sont éloquentes pour un pays pourtant épargné dans les années trente par tout antisémitisme virulent. Sur un peu plus de 140000 juifs vivant aux Pays-Bas (dont environ 120000 de nationalité néerlandaise – sur les 30000 juifs réfugiés aux Pays-Bas entre 1933 et 1939, 10000 étaient repartis vers une autre destination), à peu près 107000 ont été déportés et moins de 5000 sont revenus. Ces victimes représentent près de 40% du nombre des disparus durant le conflit aux Pays-Bas. Autrement dit, 73% des juifs de Hollande ont succombé à la terreur nazie.
Berlin voulait qu’il y ait en permanence assez de juifs dans le camp de transit de Westerbork pour alimenter les deux convois hebdomadaires. Le gouvernement néerlandais avait commencé, à la fin des années 30, à mettre les réfugiés, clandestins ou non, dans des camps ; c’est ainsi qu’était né celui de Westerbork, dans une campagne déserte de la province de la Drenthe, peu éloignée de la frontière allemande.
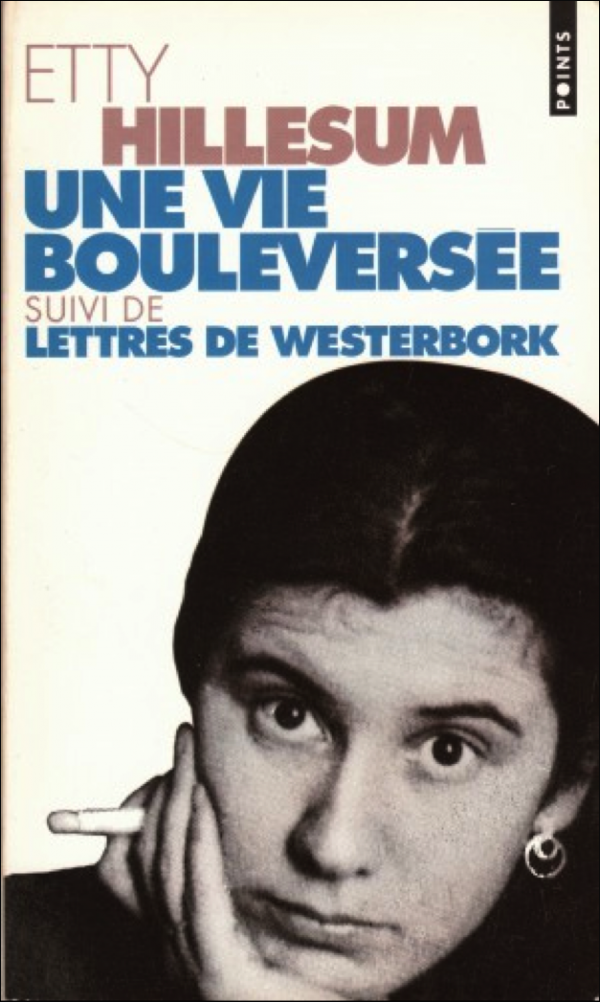
Les premières grandes rafles ont lieu en fait à Amsterdam en juillet 1942 : comme la plupart des gens convoqués par courrier ne se sont pas présentés, les Allemands se rendent directement dans les quartiers ciblés. Peu à peu, à partir de ce même été 1942, se met en place à l’initiative du Conseil juif un système complexe d’immunité qui protège provisoirement plus de 15000 de personnes. Parmi celles-ci, on compte principalement : les employés du Conseil juif (jusqu’à l’été 1943 où le Conseil est supprimé, sauf de rares bureaux) ; les juifs dits « de Calmeyer » (du nom de l’Allemand, assez coulant, chargé de contrôler l’authenticité des documents des gens prétendant ne pas être des Volljuden) ; les séfarades (ils représentaient moins de 5% de la communauté juive ; on avançait qu’ils n’étaient pas d’authentiques juifs) ; les juifs mariés à une personne non juive (laissés en paix jusqu’en mars 1942, ils représentent 8000 à 9000 des survivants ; les Allemands édictèrent à l’encontre des juifs une interdiction de se marier pour éviter ces mariages mixtes, ainsi qu’une interdiction de procréer : un programme de stérilisation fut mis en place qui permettait à toute personne s’y soumettant – environ 3000 au total – de ne plus avoir à porter l’étoile jaune) ; les juifs baptisés avant 1941 échappaient aux camps de travail ; les juifs « étrangers » (ceux qui étaient en fait parvenus à obtenir un passeport sud-américain) ; le groupe dit « groupe Barneveld » (sorte d’élite juive sélectionnée par les Allemands eux-mêmes) ; les juifs occupant certains postes économiques clés (les diamantaires, les employés de Philips).
Le 26 juillet, les autorités religieuses décident de protester contre les déportations. Les textes qu’elles rédigent et qui sont lus le dimanche dans les temples et les églises entraînent une réaction immédiate des Allemands : arrestation dans la nuit du 1er au 2 août 1942 de la plupart des juifs catholiques, soit plusieurs centaines de personnes dont près de cent seront déportées à Auschwitz ; parmi elles, la philosophe et carmélite Edith Stein, mais aussi l’épouse et la plupart des enfants du romancier converti Herman de Man. Soucieux de ne pas s’en prendre frontalement à la communauté dominante, les Allemands ont préféré semble-t-il épargner les églises protestantes en particulier la Nederlands Hervormde Kerk (à l’époque, avant comme pendant le conflit, les catholiques n’occupaient encore que très peu de postes importants dans la société néerlandaise).
Lors des grandes rafles des 2 et 3 octobre 1942, la population ne proteste pas, mais il y a eu incontestablement diverses actions souterraines pour prévenir et aider des israélites. Fin 1942, environ 40000 juifs hollandais avaient déjà été déportés. Pour obtenir les quotas réclamés par Berlin, le régime en place en Hollande décide de déporter les vieillards des maisons de retraite ou encore les enfants des orphelinats ; début 1943, le célèbre hôpital psychiatrique Het Apeldoornse Bos – dont il est question dans le Déclin de la famille Boslowits, l’une des premières œuvres du grand romancier Gerard Reve – puis le Joodse Invalide, plus grand hôpital juif d’Amsterdam, sont ainsi vidés de leurs occupants, non sans que des membres du personnel suivent les malades vers la mort. Une autre mesure « payante » adoptée par l’occupant consista à rémunérer des Néerlandais pour retrouver des israélites qui avaient choisi la clandestinité.
Toujours début 1943, on assiste à la construction d’un vrai camp de concentration dans le pays même, à Vught, pour y enfermer les prisonniers politiques et des criminels détenus dans la prison d’Amersfoort. Jusqu’en mars 1943, les transports partant de Westerbork vont à Auschwitz ; de début mars à juillet, les convois prennent pratiquement tous la direction de Sobibor – sur les 34313 déportés dans ce dernier camp, seuls 19 survivront. La terrible mécanique tourne alors à plein régime : sans doute envoie-t-on au cours de ces semaines plus de juifs néerlandais vers la mort que prévu pour compenser les difficultés que rencontrent les Allemands en Belgique et en France à maintenir les « quotas ».
Il convient sans doute de situer la nouvelle de Marga Minco, le Village de ma mère, juste après : en juillet et août 1943, durant cinq semaines, les convois furent en effet interrompus.
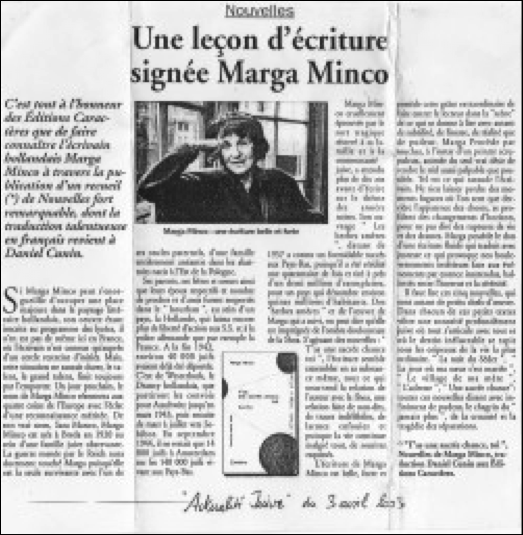
article sur T'as une sacrée chance, toi dans Actualité juive, 3 avril 2003
Au bout du compte, en septembre 1944, il ne reste plus que 14000 juifs à Amsterdam, notamment des personnes mariées à un non juif. Les deux directeurs du Conseil juif finissent à leur tour par être déportés ; certes, ils bénéficient d’un régime de « faveur » à Theresienstadt. En fait, leur organisme était devenu inutile puisque tous les juifs qui pouvaient être déportés l’avaient été ou étaient faciles à interpeller. On peut penser que, vers la fin, les Allemands en place à Amsterdam ont retardé autant que possible les déportations : pour eux, plus le nombre de juifs diminuait, plus le risque d’être envoyés sur le front de l’Est augmentait.
Bien entendu, un certain nombre d’israélites – par exemple des membres du Conseil juif – avaient choisi de vivre dans la clandestinité. Il n’est guère surprenant de constater que la plupart des survivants sont des gens qui se sont cachés. 25000 juifs seulement (environ 1 sur 7) l’ont fait dont d’ailleurs plus de 10000 ont fini par être arrêtés. En tout, c’est plus de 300000 Néerlandais qui ont choisi de se cacher, surtout à partir de 1942 (pour fuir le travail obligatoire). Mais sans argent, sans faux papiers ni cartes de ravitaillement, il était presque impossible de survivre ; or la plupart des juifs, à Amsterdam, ne disposaient que de peu d’argent et d’aucune adresse où se cacher.
Les premiers juifs à l’avoir fait sont certainement ceux qui avaient été appelés dans les camps de travail ainsi que des hommes recherchés pour des motifs politiques, ou encore les rares qui avaient refusé, début 1941, de se faire enregistrer. En fait, il s’agit sans doute pour la plupart d’israélites non néerlandais, beaucoup plus méfiants. S’y ajoutent ceux qui, après avoir bénéficié d’une certaine immunité, ont opté pour la clandestinité quand ils ont senti que leur statut ne les protégeait plus que théoriquement.
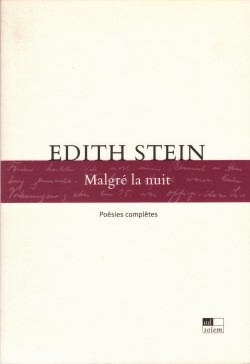 Logés pratiquement à la même enseigne que nombre de Hollandais, les juifs concernés ont trouvé en majorité refuge dans les régions rurales peu peuplées de l’Est et du Nord du pays, autrement dit dans les provinces à dominante protestante de la Frise, de la Drenthe et de Groningue. Outre une adresse, il leur fallait des faux papiers, surtout à partir de janvier 1942, date à laquelle les contrôles devinrent la règle, par exemple dans les gares et les trains (on songe à l’angoisse de la jeune fille de la nouvelle le Village de ma mère). La famille d’Anne Frank n’est pas un cas typique au sens où la plupart de ceux qui se cachaient durent, souvent à la hâte, changer d’adresse à plusieurs reprises, et où ils n’avaient pas l’argent ni les contacts dont disposait cette famille aujourd’hui célèbre. Pour beaucoup valait cette phrase devenue presque proverbiale : « Les pauvres vous procurent un toit, les riches une adresse. »
Logés pratiquement à la même enseigne que nombre de Hollandais, les juifs concernés ont trouvé en majorité refuge dans les régions rurales peu peuplées de l’Est et du Nord du pays, autrement dit dans les provinces à dominante protestante de la Frise, de la Drenthe et de Groningue. Outre une adresse, il leur fallait des faux papiers, surtout à partir de janvier 1942, date à laquelle les contrôles devinrent la règle, par exemple dans les gares et les trains (on songe à l’angoisse de la jeune fille de la nouvelle le Village de ma mère). La famille d’Anne Frank n’est pas un cas typique au sens où la plupart de ceux qui se cachaient durent, souvent à la hâte, changer d’adresse à plusieurs reprises, et où ils n’avaient pas l’argent ni les contacts dont disposait cette famille aujourd’hui célèbre. Pour beaucoup valait cette phrase devenue presque proverbiale : « Les pauvres vous procurent un toit, les riches une adresse. »
Les protestants, et souvent les plus rigoristes d’entre eux, ont joué, proportionnellement au reste de la population, un rôle assez important pour fournir des caches, mais généralement en dehors des institutions religieuses elles-mêmes. Principale organisation étant venue en aide aux gens en quête d’une planque et vivant dans la clandestinité, la Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO, 14000 membres en 1944), a été créée fin 1942 par un pasteur, trop tard malheureusement pour la plupart des juifs. Étant autorisés à se déplacer librement, les pasteurs pouvaient assurer le passage d’informations entre la capitale et les campagnes du Nord et de l’Est. Quatre réseaux importants, créés au cours de l’été 1942 ou début 1943, se sont par ailleurs occupés de cacher des enfants juifs dans des familles d’accueils.
Quant aux possibilités de fuir à l’étranger, elles étaient extrêmement réduites. Quelques centaines de juifs ont pu bénéficier de l’activité d’un groupe sioniste créé durant l’été 1943 suite à l’arrestation de jeunes hommes suivant une formation agricole (c’est le milieu évoqué par Marga Minco à propos du beau-frère de la narratrice dans le Jour où ma sœur s’est mariée ; en fait, il existait au sein de la communauté juive néerlandaise très peu d’attrait pour le sionisme). Un dernier groupe mérite d’être mentionné : le Dutch-Paris créé par Jean Weidner, un membre de l’église adventiste du septième jour, homme né aux Pays-Bas et vivant à Lyon. Certains, enfin, avaient choisi une autre fuite dès l’arrivée des Allemands : on relève en effet un nombre assez élevé de suicides dans la communauté israélite vers le 15 mai 1940.
Commencée dans l’incrédulité, cette guerre a, on peut s’en douter, laissé des traces indélébiles dans la conscience collective néerlandaise. La question de la culpabilité à l’égard de la population juive n’est pas l’une des moindres. La tendance à catégoriser les contemporains du conflit en « goed » et en « fout » (les « bons » et les « collabos ») est un autre symptôme hérité de cette époque ambivalente à plus d’un titre. Longtemps germanophile, la Hollande regarde depuis soixante ans son grand voisin de travers et ose peu à peu se regarder dans les yeux.
D.Cunin
sources