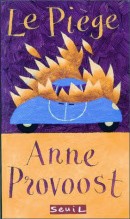En guise de présentation : entretien avec Madeline Roth (2007)
Daniel Cunin
traducteur de littérature néerlandaise

Après des études de droit, Daniel Cunin a quitté la France pour la Hollande où il a vécu de nombreuses années. C'est donc un peu tardivement qu'il a appris la langue néerlandaise, par curiosité pour ce pays si mal connu. Ses premières traductions datent, elles, d’un peu moins de quinze ans : des articles dans des revues, des documents d’entreprise, des travaux universitaires, quelques nouvelles… Mais après le Salon du Livre de Paris de 2003, où la Flandre et les Pays-Bas étaient les invités d’honneur, beaucoup d’éditeurs se sont intéressés à la littérature de langue néerlandaise, et Daniel Cunin travaille beaucoup aujourd’hui pour les éditions du Rouergue, pour lesquelles il traduit albums et romans de la collection doAdo.
- Quel est le premier livre jeunesse que vous ayez traduit ?
- C’est Amourons-nous, de Geert De Kockere, publié en 2003. Avant ce livre Les éditions du Rouergue, me semble-t-il, n’avaient pas fait paraître la moindre traduction. Leur ligne éditoriale consistait très clairement à mettre en avant de jeunes créateurs français. Mais ils ont aimé les illustrations de Sabien Clement, et décidé de faire traduire cet album. Le coup de cœur pour les illustrations commande souvent les choix des éditeurs, surtout quand ils n’ont pas accès au texte original.
- Ce texte présentait-il des difficultés de traductions particulières ?
- Le texte d’Amourons-nous est constitué de petits poèmes qui reposent sur des tas d’allitérations, de jeux de mots sur la langue, le corps, la sensualité. Dans un tel cas, le traducteur risque fort de tomber dans le cliché ou la poésie de quat’sous. On est en présence d’une tradition littéraire très différente de la nôtre, dans laquelle par exemple la rime n’a pas été bannie de la poésie, et d’une culture où les poèmes que nous qualifierions de mièvreries occupent, disons,une certaine place. Aussi cette réécriture n’a-t-elle pu se faire sans modifier bon nombre de choses – raison pour laquelle la mention indiquée dans le livre est "adapté du néerlandais" et non pas "traduit du néerlandais", mais en tenant compte des illustrations, voire en se laissant guider par elles. Quant au titre néerlandais, Jij Lievert, c’est une tournure basée sur d'autres existantes, mais qui n’existe pas elle-même ; elle est grammaticalement impossible. Aussi a-t-il fallu imaginer pour le titre français un mot qui n’existait pas non plus. Et qui soit bien entendu dans le registre de la tendresse.
- Il y a donc un travail de traduction particulier quand le texte est accompagné d'images ?
- Oui, il faut conserver la cohérence entre eux. En ce moment, je travaille entre autres à un livre qui devrait sortir au début de l’année 2008 au Rouergue. C’est un album qui reprend le principe de Margot la folle : un tableau plus ou moins célèbre – reproduit en quatrième de couverture – à partir duquel un auteur et un illustrateur inventent une histoire, une nouvelle œuvre. Là, il s’agit d’un tableau du peintre belge Edgar Tytgat, intitulé Prélude à un amour brisé. Sur le tableau, une femme est allongée, une jambe coupée. Or l’auteur flamand emploie l’expression "op eigen benen staan" (mot à mot : se tenir sur ses propres jambes) qui signifie « être autonome », « voler de ses propres ailes ». Texte et illustrations de l’album jouent sur cette image en évoquant une femme qui est d’avis que se marier, c’est comme se retrouver avec une jambe en moins, c’est être amputé de sa liberté, ne plus pouvoir « se tenir sur ses propres jambes ». Cette métaphore ainsi que les allusions aux bras et aux jambes dans tout l’album rendent le travail de traduction assez délicat : conserver la correspondance entre jeux de mots et illustrations ne va pas forcément de soi quand on passe dans une autre langue ; or, ne pas la conserver dans le cas présent reviendrait à démolir l’album.
- Travaillez-vous en relation avec l’auteur ?
- Souvent, le traducteur entre en contact avec l’auteur pour lui demander des précisions, pour vérifier s’il a lu correctement tel ou tel passage qui pose problème. Cette démarche est bien entendu nécessaire quand on traduit un roman ; dans le cas des albums, on a en général tout au 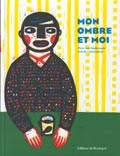 plus deux ou trois questions à poser. Il est très utile aussi d’entendre l’auteur lire quelques pages de son livre. Cela permet de mieux entendre le texte et le ton du texte, d’autant plus que le néerlandais est une langue à accentuation de mot (selon la syllabe qu’on accentue, le mot change de sens) et que là où le français réclame des points d’exclamation et autres points d’interrogation, lui se contente bien souvent d’accentuer une syllabe en jouant avec la place des mots dans la phrase.
plus deux ou trois questions à poser. Il est très utile aussi d’entendre l’auteur lire quelques pages de son livre. Cela permet de mieux entendre le texte et le ton du texte, d’autant plus que le néerlandais est une langue à accentuation de mot (selon la syllabe qu’on accentue, le mot change de sens) et que là où le français réclame des points d’exclamation et autres points d’interrogation, lui se contente bien souvent d’accentuer une syllabe en jouant avec la place des mots dans la phrase.
- L'éditeur intervient-il dans le travail de traduction ?
- Avec Le Rouergue, tout se passe dans des conditions idéales. Danielle Dastugue et ses collaboratrices travaillent sur les traductions comme elles travaillent sur les textes des auteurs français. Elles les relisent avec un vrai regard critique et en faisant des suggestions. Il arrive souvent que le traducteur bloque sur un mot. La plupart du temps, il suffit d’en parler de vive voix au téléphone durant quelques secondes à peine pour trouver la solution. Qui plus est, Le Rouergue me laisse en général des délais importants pour rendre la traduction des romans et des albums ! Si je ne travaille que pour Le Rouergue en jeunesse, c’est parce que je traduis par ailleurs beaucoup pour divers éditeurs de littérature générale. Mais il m’est aussi arrivé de refuser de traduire des romans jeunesse, parce que je n’étais pas assez intéressé par les livres qu'on me proposait. Et surtout parce que je tiens à garder du temps pour traduire les albums publiés par Le Rouergue et les livres de Bart Moeyaert.
- Pouvez-vous nous en dire davantage sur l’œuvre de Bart Moeyaert ?
- Les albums et les romans de Bart Moeyaert sont pour la plupart publiés à Amsterdam, par une vénérable maison d’édition, Querido. Dans les librairies hollandaises et flamandes, on trouve ses textes aussi bien dans les rayons de littérature générale que dans les rayons jeunesse. Cet auteur flamand incarne la volonté de jeter une passerelle pour rapprocher ces deux univers éditoriaux. Son œuvre est évocation, nuance, non-dit. Il écrit beaucoup pour le théâtre, monte souvent lui-même sur scène : ses textes sont vraiment faits pour être en même temps lus et entendus, ce que la traduction se doit de rendre possible en français. Bart Moeyaert creuse, avec une réelle qualité d’écriture, la thématique de la violence des adultes et de ses répercussions sur les enfants et les adolescents. Plus il avance en âge, plus il dépouille, plus il élimine. C’est au lecteur d’ajouter ce qui manque. Le ton de ses albums est moins grave en général. Mais il n’y a pas grande différence entre traduire un album de Bart Moeyaert et traduire l’un de ses romans : cela réclame la même démarche de la part du traducteur. Le texte des albums est en général tout aussi travaillé que celui de certains passages des romans. Les romans étant plus complexes, ils nécessitent simplement un effort de longue haleine, une attention accrue.
- Sur lequel de ses livres travaillez-vous en ce moment ?
- Sur Frères, qui devrait être publié au printemps 2008, toujours aux éditions du Rouergue. C’est un livre très autobiographique, une série d’anecdotes sur l’enfance de l’auteur et de ses six frères. Ils sont sept garçons, Bart étant le petit dernier. En Belgique, le roi est le parrain de tout garçon qui est le cadet de sept frères nés successivement. Voilà pourquoi le livre en question est dédié et aux six frères du romancier et à « feu le roi Baudoin ». Traduire les textes de Bart Moeyaert demande beaucoup de travail : après le premier jet, il convient de peaufiner sans cesse, souvent pour aller au plus court. Il faut éviter de sur-traduire, d’expliciter. Il faut retrouver en français le dépouillement de l’original. Pour ce qui est de Frères, les multiples jeux de mots compliquent encore la tâche.
- Comment définiriez-vous le travail du traducteur ?
- Traduire, c’est d’abord lire. Pour traduire, il faut être un bon lecteur, et maîtriser sa langue maternelle à l’écrit - puisqu’un traducteur traduit par principe une langue étrangère dans sa propre langue. Ensuite, il y a tout un travail d’écriture. Les écoles de traduction enseignent souvent et la traduction et l’interprétariat, mais il s’agit de deux métiers bien différents : un très bon interprète n’est pas forcément quelqu’un qui excelle à écrire dans sa langue maternelle. Chez moi, la tentation de la traduction est venue naturellement à partir du moment où j’ai eu envie de partager certains textes néerlandais avec des amis français. Cela d’autant plus qu’il s’agit d’une littérature encore très mal connue à l’étranger. Très peu de "classiques" néerlandais sont disponibles en langue française. J’ai eu le bonheur d’en traduire un récemment : La Chambre noire de Damoclès, de Willem Frederik Hermans. Au bout du compte, la traduction est devenue pour moi un réel apprentissage de l’écriture. Traduire me permet de concilier mes deux passions : la lecture et l’écriture, et d’en vivre, certes sans rouler sur l’or.
- Un traducteur est-il pour autant un écrivain ?
- Un traducteur est quelqu’un qui écrit, mais il n’a ni le souci de la page blanche - que n’a pas, je pense, le véritable écrivain -, ni le souci de créer à partir de rien. Quelqu’un a emprunté le chemin avant lui. Son travail ne consiste pas pour autant à simplement restituer plus ou moins correctement un texte ; l’essentiel à mon sens est d’obtenir en français un texte vivant, un texte qui dise ce que dit le texte original. La traduction n’affecte en rien l’original, puisque celui-ci continue son existence propre. S’il y a traduction, cela veut dire que le nouveau texte « fait » dans la langue du traducteur ce qu’il « fait » dans la langue de l’auteur. Il faut accepter que la traduction vive une vie autonome. Henri Meschonnic, dans un ouvrage qui s’intitule Poétique du traduire, dit que le fait « que l’on puisse parler du Poe de Baudelaire et de celui de Mallarmé montre que la traduction réussie est une écriture, non une transparence anonyme ».
Propos recueillis par Madeline Roth, librairie L’Eau Vive
Œuvres traduites par Daniel Cunin
publiées aux Editions du Rouergue
Embrasse-moi, de Bart Moeyaert, coll. doAdo
Frères, de Bart Moeyaert, coll. doAdo
Le Maître de tout, de Bart Moeyaert
Prélude à un amour brisé, de Geert De Kockere & Isabelle Vandenabeele
La fille sans cœur, de Pieter van Oudheusden & Goele Dewanckel
Frisson de fille, de Edward van de Vendel & Isabelle Vandenabeele
Waouw ! Petit Navire!, de Geert De Kockere & Noke Van den Elsacker
Olek a tué un ours, de Bart Moeyaert, Wolf Erlbruch & Wim Henderickx (musique)
Mon ombre et moi, de Pieter van Oudheusden & Isabelle Vandenabeele
 Oreille d’homme, de Bart Moeyaert, coll. doAdo
Oreille d’homme, de Bart Moeyaert, coll. doAdo
C’est l’amour que nous ne comprenons pas, de Bart Moeyaert, coll. doAdo
On se reverra ?, de Ed Franck & Carll Cneut
Pagaille, de Edward van de Vendel & Carll Cneut
Nid de guêpes, de Bart Moeyart, coll. doAdo
Moi, Dieu et la Création, de Bart Moeyaert & Wolf Erlbruch
Rouge Rouge Petit Chaperon rouge, de Edward van de Vendel & Isabelle Vandenabeele
Amourons-nous, de Geert De Kockere & Sabien Clement
source : Citrouille, n° 48, novembre 2007
Une liste tenue à jour des traductions figure sur le site de l'ATLF
(Association des Traducteurs Littéraires de France) : www.atlf.org




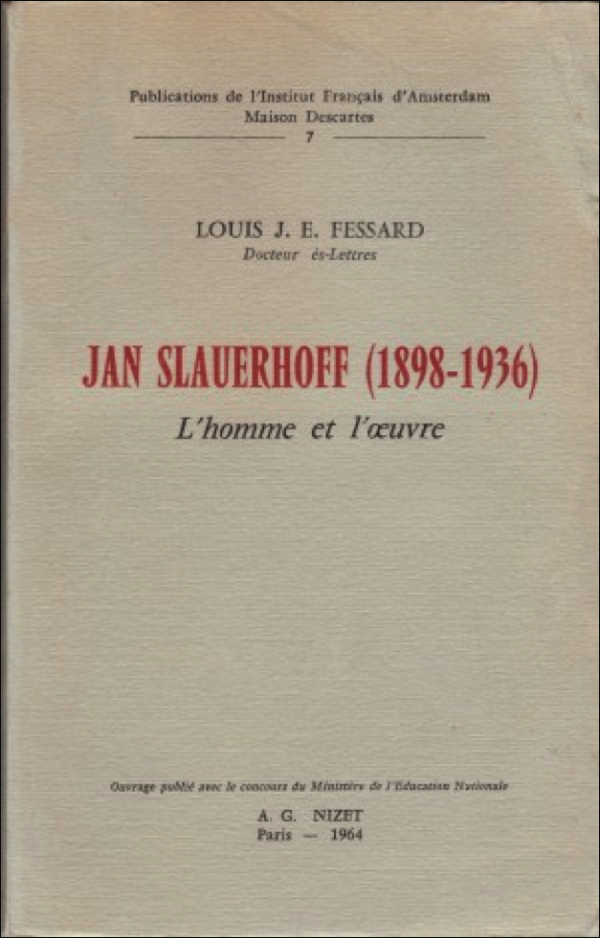
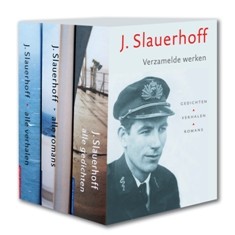
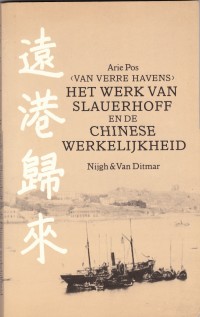


 VvdM.
VvdM.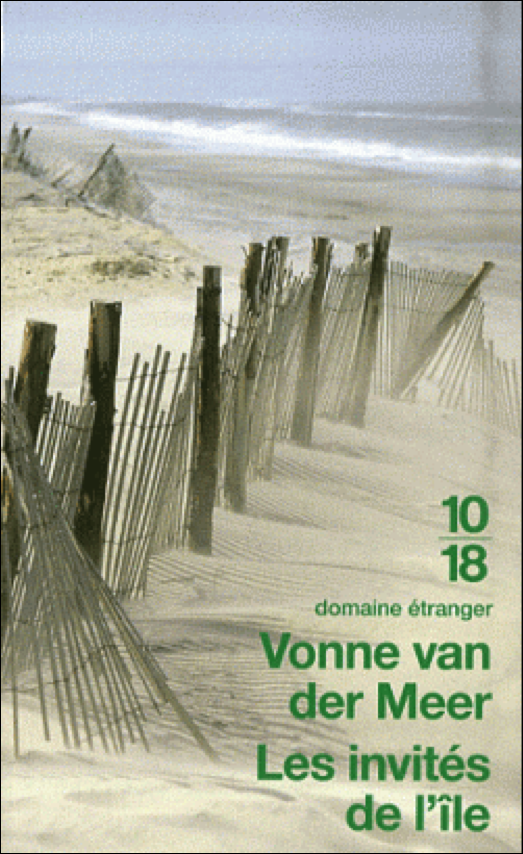

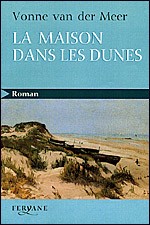

 Dans ce roman magnifique, Gerbrand Bakker narre une histoire par touches, sans précipitation, dans une langue belle et en apparence simple. L’écriture est en harmonie avec le paysage décrit et le quotidien de la ferme. De cet ensemble mélancolique se dégage une réelle attention pour l’austérité et la rudesse de la vie paysanne d’aujourd’hui. Mais aussi pour la solitude et l’absence d’affection qui mine le personnage. L’auteur n’explique rien, il se contente, au fil des 56 chapitres, de décrire sobrement le peu qui se déroule. Le titre original (Boven is het stil) souligne l’omniprésence du « calme » mais aussi du silence. Quelques motifs permettent d’articuler les évolutions majeures du livre : la corneille mantelée annonciatrice de mort ; la carte du Danemark qu’Helmer accroche dans sa chambre (le Danemark est un pays où de nombreux paysans hollandais s’exilent) ; les paires (les jumeaux, les deux ânes, les deux rameurs, les deux Henk)…
Dans ce roman magnifique, Gerbrand Bakker narre une histoire par touches, sans précipitation, dans une langue belle et en apparence simple. L’écriture est en harmonie avec le paysage décrit et le quotidien de la ferme. De cet ensemble mélancolique se dégage une réelle attention pour l’austérité et la rudesse de la vie paysanne d’aujourd’hui. Mais aussi pour la solitude et l’absence d’affection qui mine le personnage. L’auteur n’explique rien, il se contente, au fil des 56 chapitres, de décrire sobrement le peu qui se déroule. Le titre original (Boven is het stil) souligne l’omniprésence du « calme » mais aussi du silence. Quelques motifs permettent d’articuler les évolutions majeures du livre : la corneille mantelée annonciatrice de mort ; la carte du Danemark qu’Helmer accroche dans sa chambre (le Danemark est un pays où de nombreux paysans hollandais s’exilent) ; les paires (les jumeaux, les deux ânes, les deux rameurs, les deux Henk)…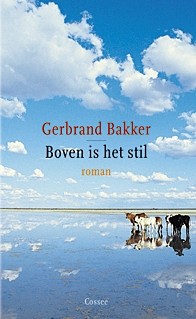


 À côté du thème du deuil, le roman s’intéresse essentiel- lement au regard, mais le regard qui est en danger – comme l’annonce le titre du livre « regarder dans le soleil » (ce que fait la mère, à travers les négatifs de photos) : tant le regard de la mère en deuil qui perd la vue que celui de la très jeune narratrice solitaire qui voit ce que sa mère ne voit plus, mais sans vraiment comprendre ce qu’elle voit. La relation mère-fille doit sans doute beaucoup aux romans d’Alice Munro : la mère se reconnaît dans sa fille mais elle tente en même temps de se retrouver elle-même en s’éloignant mentalement de son enfant. Ce qui (dés)uni mère et fille trouve sans doute sa formulation la plus marquante dans la scène où Linda prend le volant à la tombée de la nuit, contre l’avis de Chloé : peu après, elle écrase un wombat femelle : la femme qui devient aveugle écrase un marsupial lui-même plus ou moins aveugle ; son premier souci est alors de voir si elle a également écrasé le petit que la mère porte en principe dans sa poche.
À côté du thème du deuil, le roman s’intéresse essentiel- lement au regard, mais le regard qui est en danger – comme l’annonce le titre du livre « regarder dans le soleil » (ce que fait la mère, à travers les négatifs de photos) : tant le regard de la mère en deuil qui perd la vue que celui de la très jeune narratrice solitaire qui voit ce que sa mère ne voit plus, mais sans vraiment comprendre ce qu’elle voit. La relation mère-fille doit sans doute beaucoup aux romans d’Alice Munro : la mère se reconnaît dans sa fille mais elle tente en même temps de se retrouver elle-même en s’éloignant mentalement de son enfant. Ce qui (dés)uni mère et fille trouve sans doute sa formulation la plus marquante dans la scène où Linda prend le volant à la tombée de la nuit, contre l’avis de Chloé : peu après, elle écrase un wombat femelle : la femme qui devient aveugle écrase un marsupial lui-même plus ou moins aveugle ; son premier souci est alors de voir si elle a également écrasé le petit que la mère porte en principe dans sa poche.